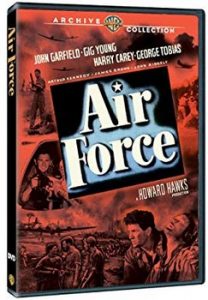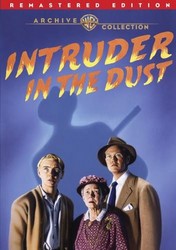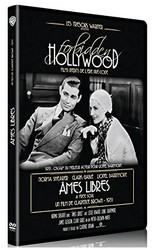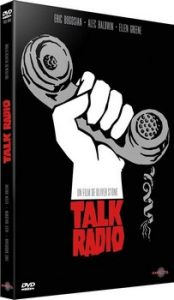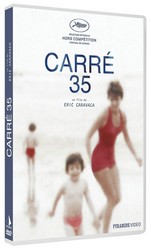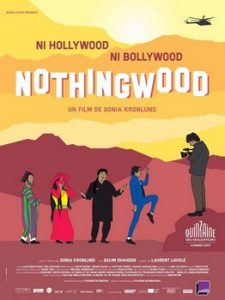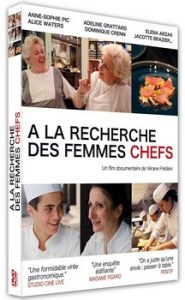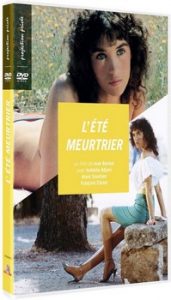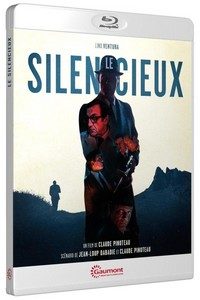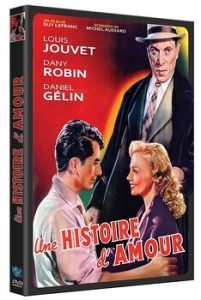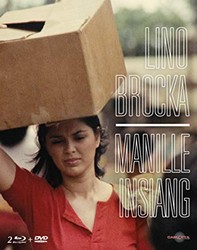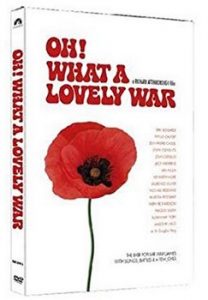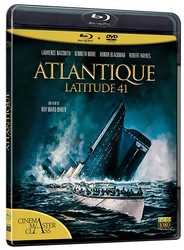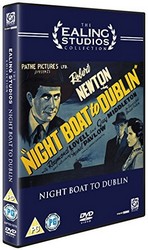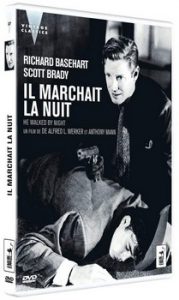 Revu enfin dans une belle copie, HE WALKED BY NIGHT nous a semblé meilleur que dans notre souvenir. Grace à la photo très inventive d’Alton et à l’interprétation de Richard Basehart qui arrive à préserver l’opacité de son personnage tout en le rendant intéressant. On ne sait pas très bien ce qu’il cherche, sinon de l’argent, ni ce qui le motive vraiment. Le scénario ne se préoccupe guère de psychologie ni pour lui ni pour les flics. Aucun effort n’est fait pour approfondir le personnage de Scott Brady et le film y gagne car on nous épargne les habituelles séquences de vie domestiques. Le récit procède par brusque à coups que relie un commentaire pléonastique et solennel, asséné plutôt que lu par Reed Hadley. Les scènes nocturnes sont les plus réussies. On a beaucoup glosé sur les séquences se déroulant dans les égouts où Alton exécute une série de variations sur des lampes torche sans doute très renforcées qui s’éloignent ou se rapprochent dans les conduits très obscurs, créant de spectaculaires effets, notamment dans les plans très larges : on voit la lumière cascader puis décroître sur les murs. Mais nous avons été davantage impressionné par toute la scène où Basehart arrive en avance au rendez-vous fixé par Mr Reeves, déjouant le piège tendu par les policiers. Là, plus que dans la scène célèbre où il s’opère lui même, on se dit que le découpage, les angles, les rapports des personnages dans l’espace portent la trace (l’influence ?) d’Anthony Mann. Mais John Alton, au festival de Telluride, avait maintenu que la part de Mann avait été minime contrairement à ce qui a été écrit ici et là.
Revu enfin dans une belle copie, HE WALKED BY NIGHT nous a semblé meilleur que dans notre souvenir. Grace à la photo très inventive d’Alton et à l’interprétation de Richard Basehart qui arrive à préserver l’opacité de son personnage tout en le rendant intéressant. On ne sait pas très bien ce qu’il cherche, sinon de l’argent, ni ce qui le motive vraiment. Le scénario ne se préoccupe guère de psychologie ni pour lui ni pour les flics. Aucun effort n’est fait pour approfondir le personnage de Scott Brady et le film y gagne car on nous épargne les habituelles séquences de vie domestiques. Le récit procède par brusque à coups que relie un commentaire pléonastique et solennel, asséné plutôt que lu par Reed Hadley. Les scènes nocturnes sont les plus réussies. On a beaucoup glosé sur les séquences se déroulant dans les égouts où Alton exécute une série de variations sur des lampes torche sans doute très renforcées qui s’éloignent ou se rapprochent dans les conduits très obscurs, créant de spectaculaires effets, notamment dans les plans très larges : on voit la lumière cascader puis décroître sur les murs. Mais nous avons été davantage impressionné par toute la scène où Basehart arrive en avance au rendez-vous fixé par Mr Reeves, déjouant le piège tendu par les policiers. Là, plus que dans la scène célèbre où il s’opère lui même, on se dit que le découpage, les angles, les rapports des personnages dans l’espace portent la trace (l’influence ?) d’Anthony Mann. Mais John Alton, au festival de Telluride, avait maintenu que la part de Mann avait été minime contrairement à ce qui a été écrit ici et là.
GORDON DOUGLAS
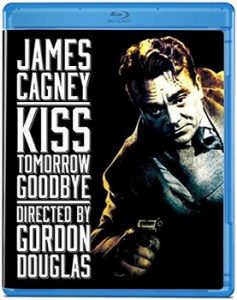 LE FAUVE EN LIBERTÉ – Les pressions sans doute de la censure et le choix de James Cagney transforment le Ralph Cotter du roman : du jeune lettré devenu psychopathe criminel, les auteurs ne retiennent que le psychopathe, assez proche du héros de WHITE HEAT. Mais le film surprend encore par sa violence dès la séquence d’évasion où Cagney tue son compagnon blessé, d’une balle dans la tête. Douglas réunit une distribution mythique, qui comprend des piliers du film noir, dans des rôles juteux qui les mettent particulièrement en valeur : Neville Brand, le compagnon d’évasion, Steve Brodie, John Litel. La palme revient au spectaculaire couple de flics véreux et assez stupides que forment Ward Bond et Barton McLane et à Luther Adler qui fignole un des avocats corrompus les plus marquants du genre. La mise en scène nerveuse, précise, utilisant à merveille l’espace (dans les meilleurs moments on pense à Walsh même si le film n’a pas la grandeur, la démesure cosmique de WHITE HEAT), ne flotte que dans deux ou trois scènes du dernier tiers même si Helena Carter se tire honorablement d’un personnage conventionnel. Il est intéressant de voir comment les rapports de Cagney avec Barbara Payton qui est ici excellente, sexy et crédible, inversent les schémas traditionnels du film noir. Cagney joue plutôt le rôle de la femme fatale qui sème le trouble et le mal et Payton représente celle que l’on corrompt. Une séquence, particulièrement remarquable, constitue un sommet du genre : Holiday (Payton) furieuse de la conduite de Ralph, lui lance un couteau qui érafle son oreille. Il surgit dans la salle de bain, mouille une serviette et nettoie sa plaie, puis se rue sur elle la battant sauvagement avec la serviette mouillée. Acculée contre le mur, le suppliant d’arrêter, elle se jette dans ses bras, se sentant seule après la mort de son frère, ignorant que c’est lui qui l’a tué. Douglas filme avec fluidité ce changement d’attitude et le rend crédible.
LE FAUVE EN LIBERTÉ – Les pressions sans doute de la censure et le choix de James Cagney transforment le Ralph Cotter du roman : du jeune lettré devenu psychopathe criminel, les auteurs ne retiennent que le psychopathe, assez proche du héros de WHITE HEAT. Mais le film surprend encore par sa violence dès la séquence d’évasion où Cagney tue son compagnon blessé, d’une balle dans la tête. Douglas réunit une distribution mythique, qui comprend des piliers du film noir, dans des rôles juteux qui les mettent particulièrement en valeur : Neville Brand, le compagnon d’évasion, Steve Brodie, John Litel. La palme revient au spectaculaire couple de flics véreux et assez stupides que forment Ward Bond et Barton McLane et à Luther Adler qui fignole un des avocats corrompus les plus marquants du genre. La mise en scène nerveuse, précise, utilisant à merveille l’espace (dans les meilleurs moments on pense à Walsh même si le film n’a pas la grandeur, la démesure cosmique de WHITE HEAT), ne flotte que dans deux ou trois scènes du dernier tiers même si Helena Carter se tire honorablement d’un personnage conventionnel. Il est intéressant de voir comment les rapports de Cagney avec Barbara Payton qui est ici excellente, sexy et crédible, inversent les schémas traditionnels du film noir. Cagney joue plutôt le rôle de la femme fatale qui sème le trouble et le mal et Payton représente celle que l’on corrompt. Une séquence, particulièrement remarquable, constitue un sommet du genre : Holiday (Payton) furieuse de la conduite de Ralph, lui lance un couteau qui érafle son oreille. Il surgit dans la salle de bain, mouille une serviette et nettoie sa plaie, puis se rue sur elle la battant sauvagement avec la serviette mouillée. Acculée contre le mur, le suppliant d’arrêter, elle se jette dans ses bras, se sentant seule après la mort de son frère, ignorant que c’est lui qui l’a tué. Douglas filme avec fluidité ce changement d’attitude et le rend crédible.
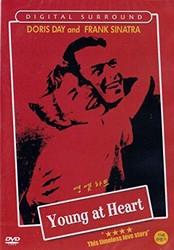 Mais Douglas s’est essayé à tous les genres. On connaît ses succès dans le western (LA MAÎTRESSE DE FER, RIO CONCHOS, LE GÉANT DU GRAND NORD, FORT DOBBS) mais beaucoup moins dans le film sentimental, voire le mélodrame et la comédie musicale, deux genres qui co existent dans l’inclassable YOUNG AT HEART qu’Olive a enfin restauré (DVD zone 1 sans sous-titres). Ce dernier film, remake de l’excellent FOUR DAUGHTERS de Michael Curtiz, a la sagesse de rester très fidèle à l’original (les scénaristes sont les mêmes, Julius Epstein et Lenore Coffee), bien que les quatre filles soient, sans dommage appréciable, réduites à trois. Le choix de Frank Sinatra pour le rôle du musicien malchanceux et fataliste qui avait lancé John Garfield est judicieux, mais les chansons, excellentes (on y entend de bonnes versions de « Just One of Those Things »et de « Someone Watched Over Me » sans parler de la chanson titre qui triompha) ou médiocres, sont la cerise un peu encombrante sur un gâteau déjà très riche au départ. Refusant les conventions du musical, Douglas s’efforce de justifier diégétiquement les intermèdes musicaux mais il faut alors accepter une convention différente : Sinatra chante et joue du piano dans un restaurant-bar (c’est son gagne-pain), dans le vacarme et l’indifférence totale des clients, ce qui paraît plausible. Saisi par l’interprétation intérieure et poignante de « One For My Baby », Douglas décide d’isoler Sinatra, d’oublier tous les bruits d’ambiance, transformant la chanson en une sorte de monologue dramatique qui deviendra un des moments phares de tous les futurs récitals de Sinatra. Sans avoir l’énergie de la mise en scène de Curtiz, celle de Douglas organise efficacement les évolutions de nombreux personnages dans un espace restreint. L’usage de la couleur, les cadrages, souvent derrière une fenêtre, font parfois penser à Sirk (impression peut-être renforcée par le fait que Robert Keith et Dorothy Malone sont père et fille comme dans WRITTEN ON THE WIND). Ainsi, à l’arrivée, YOUNG AT HEART, écrit Rauger, est sans doute un des films hollywoodiens les plus authentiques et les plus conscients jamais fait sur la dépression. C’est Sinatra qui imposa une fin heureuse contestable même si elle donne lieu à au seul duo entre Sinatra et Doris Day durant les dernières 16 mesures de « You My Love » de Jimmy Van Heusen.
Mais Douglas s’est essayé à tous les genres. On connaît ses succès dans le western (LA MAÎTRESSE DE FER, RIO CONCHOS, LE GÉANT DU GRAND NORD, FORT DOBBS) mais beaucoup moins dans le film sentimental, voire le mélodrame et la comédie musicale, deux genres qui co existent dans l’inclassable YOUNG AT HEART qu’Olive a enfin restauré (DVD zone 1 sans sous-titres). Ce dernier film, remake de l’excellent FOUR DAUGHTERS de Michael Curtiz, a la sagesse de rester très fidèle à l’original (les scénaristes sont les mêmes, Julius Epstein et Lenore Coffee), bien que les quatre filles soient, sans dommage appréciable, réduites à trois. Le choix de Frank Sinatra pour le rôle du musicien malchanceux et fataliste qui avait lancé John Garfield est judicieux, mais les chansons, excellentes (on y entend de bonnes versions de « Just One of Those Things »et de « Someone Watched Over Me » sans parler de la chanson titre qui triompha) ou médiocres, sont la cerise un peu encombrante sur un gâteau déjà très riche au départ. Refusant les conventions du musical, Douglas s’efforce de justifier diégétiquement les intermèdes musicaux mais il faut alors accepter une convention différente : Sinatra chante et joue du piano dans un restaurant-bar (c’est son gagne-pain), dans le vacarme et l’indifférence totale des clients, ce qui paraît plausible. Saisi par l’interprétation intérieure et poignante de « One For My Baby », Douglas décide d’isoler Sinatra, d’oublier tous les bruits d’ambiance, transformant la chanson en une sorte de monologue dramatique qui deviendra un des moments phares de tous les futurs récitals de Sinatra. Sans avoir l’énergie de la mise en scène de Curtiz, celle de Douglas organise efficacement les évolutions de nombreux personnages dans un espace restreint. L’usage de la couleur, les cadrages, souvent derrière une fenêtre, font parfois penser à Sirk (impression peut-être renforcée par le fait que Robert Keith et Dorothy Malone sont père et fille comme dans WRITTEN ON THE WIND). Ainsi, à l’arrivée, YOUNG AT HEART, écrit Rauger, est sans doute un des films hollywoodiens les plus authentiques et les plus conscients jamais fait sur la dépression. C’est Sinatra qui imposa une fin heureuse contestable même si elle donne lieu à au seul duo entre Sinatra et Doris Day durant les dernières 16 mesures de « You My Love » de Jimmy Van Heusen.
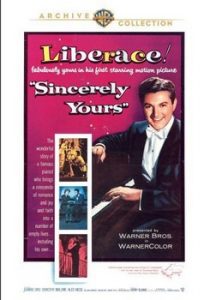 YOUNG AT HEART n’est pas un accident isolé dans la carrière de Douglas. Il a dirigé plusieurs autres drames féminins (« women’s pictures ») comme le rappelle Dave Kehr dont HARLOW qui nous avait laissé de glace. Quand on assigna Douglas à SINCERELY YOURS (DVD Warner on demand zone 1), premier film de fiction joué par Liberace, le pianiste virtuose dont Soderbergh évoqua la personnalité tourmentée dans le remarquable BEHIND THE CANDELABRA, il dut se dire mauvaise pioche, tant le scénario d’Irving Wallace commence par juxtaposer une série de séquences prétexte qui permettent au héros d’étaler une virtuosité purement technique, passant de Chopin à une chanson sud-américaine, de Tchaikovsky à une polka sans oublier une variation assez réjouissante sur « Pinetop’s Boogie Woogie » de Pinetop Perkins. La trame connaissant la personnalité du pianiste flirte avec l’imaginaire en brodant autour d’une rivalité amoureuse, entre Joanne Dru la fidèle secrétaire et une Dorothy Malone (que Douglas sait une fois encore très bien photographier et diriger), corsetée et boutonnée jusqu’au cou mais qui irradie une vivacité, une sexualité tout à fait improbables quand on connaît le contexte. On a le droit à des répliques gratinées comme « Vous ne pourrez pas rivaliser avec un concerto ». Le propos bascule ensuite dans le mélodrame quand Harry Warren/Liberace devient sourd, apprend à lire sur les lèvres et sauve un petit garçon handicapé et une femme âgée méprisée par sa fille. Ce film a une réputation catastrophique aussi bien chez Maltin (Bomb), chez les Medved qui l’incluent dans leur liste infamante que chez Paul Mavis dans DVDTalk qui se moque des gros plans ridicules d’un Liberace avec des mèches crantées murmurant « merci mon Dieu » en pleurant après son opération. Il est vrai que le pianiste avec ses yeux globuleux, son allure onctueuse est un acteur calamiteux (notamment dans cette séquence) mais même dans ces péripéties kitsch, on finit par comprendre que son ingénuité calculée ou réelle, sa bonhomie chaleureuse ait attiré des milliers de fans Nous avons néanmoins trouvé le film non pas meilleur (un tel adjectif ne conviendrait pas) mais plus regardable, plus gracieux qu’on l’aurait pensé. Certains plans sont joliment coloriés par William Clothier et Douglas utilise avec élégance la couleur rouge, celle du manteau que porte Joanne Dru quand elle part qui renvoie à la robe rouge de Dorothy Malone, rappel élégant qui unit les deux femmes. On pense à Sirk tout comme dans la scène où Liberace incite à retrouver Alex Nicol qui l’attend dans le parc. L’échec commercial bloqua la seconde réalisation, Warner préférant payer son contrat à Liberace plutôt que de produire le film. A noter, preuve que c’est une œuvre de fiction, que l’on ne voit jamais le célèbre candélabre.
YOUNG AT HEART n’est pas un accident isolé dans la carrière de Douglas. Il a dirigé plusieurs autres drames féminins (« women’s pictures ») comme le rappelle Dave Kehr dont HARLOW qui nous avait laissé de glace. Quand on assigna Douglas à SINCERELY YOURS (DVD Warner on demand zone 1), premier film de fiction joué par Liberace, le pianiste virtuose dont Soderbergh évoqua la personnalité tourmentée dans le remarquable BEHIND THE CANDELABRA, il dut se dire mauvaise pioche, tant le scénario d’Irving Wallace commence par juxtaposer une série de séquences prétexte qui permettent au héros d’étaler une virtuosité purement technique, passant de Chopin à une chanson sud-américaine, de Tchaikovsky à une polka sans oublier une variation assez réjouissante sur « Pinetop’s Boogie Woogie » de Pinetop Perkins. La trame connaissant la personnalité du pianiste flirte avec l’imaginaire en brodant autour d’une rivalité amoureuse, entre Joanne Dru la fidèle secrétaire et une Dorothy Malone (que Douglas sait une fois encore très bien photographier et diriger), corsetée et boutonnée jusqu’au cou mais qui irradie une vivacité, une sexualité tout à fait improbables quand on connaît le contexte. On a le droit à des répliques gratinées comme « Vous ne pourrez pas rivaliser avec un concerto ». Le propos bascule ensuite dans le mélodrame quand Harry Warren/Liberace devient sourd, apprend à lire sur les lèvres et sauve un petit garçon handicapé et une femme âgée méprisée par sa fille. Ce film a une réputation catastrophique aussi bien chez Maltin (Bomb), chez les Medved qui l’incluent dans leur liste infamante que chez Paul Mavis dans DVDTalk qui se moque des gros plans ridicules d’un Liberace avec des mèches crantées murmurant « merci mon Dieu » en pleurant après son opération. Il est vrai que le pianiste avec ses yeux globuleux, son allure onctueuse est un acteur calamiteux (notamment dans cette séquence) mais même dans ces péripéties kitsch, on finit par comprendre que son ingénuité calculée ou réelle, sa bonhomie chaleureuse ait attiré des milliers de fans Nous avons néanmoins trouvé le film non pas meilleur (un tel adjectif ne conviendrait pas) mais plus regardable, plus gracieux qu’on l’aurait pensé. Certains plans sont joliment coloriés par William Clothier et Douglas utilise avec élégance la couleur rouge, celle du manteau que porte Joanne Dru quand elle part qui renvoie à la robe rouge de Dorothy Malone, rappel élégant qui unit les deux femmes. On pense à Sirk tout comme dans la scène où Liberace incite à retrouver Alex Nicol qui l’attend dans le parc. L’échec commercial bloqua la seconde réalisation, Warner préférant payer son contrat à Liberace plutôt que de produire le film. A noter, preuve que c’est une œuvre de fiction, que l’on ne voit jamais le célèbre candélabre.
 On retrouve Max Steiner au générique de THE SINS OF RACHEL CADE qui sortit dans un double programme très Nickel Odéon avec GOLD OF THE SEVEN SAINTS et sa musique épouse frontalement les péripéties, voire les conventions du scénario d’Edward Anhalt d’après un roman obscur, notamment lors des dernières scènes où un contrepoint religieux vient se fondre dans le thème d’amour. Rachel Cade est en effet une missionnaire venue du Kansas pour soigner et bien sûr évangéliser les habitants d’une région perdue du Congo Belge. Elle va tomber amoureuse de deux hommes, l’officier agnostique qui administre le district (Peter Finch reprend un personnage qu’il avait joué dans A NUN’S STORY) et un jeune et brillant aviateur (Roger Moore). Disons le tout de suite, l’histoire d’amour même traitée avec sobriété et concision est ce qu’il y a de moins intéressant dans le film. Comme l’écrit le rédacteur de Coffee, Coffee and more Coffee : « Ce film doit être aimé et chéri pour les gros plans d’Angie Dickinson… On ne parle pas seulement des plans très serrés mais de ceux où ses lèvres délimitent le bas du cadre et ses sourcils le haut. Et où les couleurs sont comme adoucies, peut-être à cause du tirage, mais cela marche. Je n’ai jamais vu Angie Dickinson aussi amoureusement photographiée que dans ce film. » Nous sommes assez d’accord avec cet admirateur enthousiaste. On a l’impression que Gordon Douglas et son chef opérateur Peverell Marley sont tombés amoureux d’Angie Dickinson et avec elle, son visage avec quelques gouttes de sueur, on accepte avec un certain plaisir pervers ce Congo Belge reconstitué à Burbank, ces rebondissements éculés qui auraient pu être beaucoup plus gênants (l’enfant malade qu’on va sauver, les rivalités avec le sorcier local joué par Woody Strode, la pseudo malédiction des dieux) d’autant que Douglas les traite avec une vraie conviction, une franchise dans l’approche, le regard, glissant ici et là de petites surprises, une fin de scène occultée, une maladie qu’on ne peut guérir, un échec qui fait douter l’héroïne. Il filme plusieurs scènes sous la pluie, dans la brume, ce qui les rend plus denses, plus réalistes ou de nuit, pour casser le côté trop poli du décor en studio et le crédibiliser, fait parler les acteurs doucement, ce qui convient parfaitement à Peter Finch. Rachel Cade affiche certes ses convictions mais sans les imposer et plusieurs fois on lui oppose des arguments recevables : la paix que prétend imposer le christianisme est mis à mal par cette guerre (l’action se passe durant le conflit de 39-45) entre des nations chrétiennes. Le film réunit de très nombreux acteurs noirs, de Rafer Johnson à Errol John (remarquable de force) en passant par Juano Hernandez, Scatman Crothers que Douglas filme avec plus d’empathie et de respect que le scénario le laissait supposer. Revenons à Coffee, Coffee and more Coffee : « On pourrait couper tout le reste et obtenir un poème visuel encore plus beau que ce qu’avait réussi Joseph Cornell en supprimant tout ce qui était superflu dans EAST OF BORNEO pour ne garder que Rose Hobart. »
On retrouve Max Steiner au générique de THE SINS OF RACHEL CADE qui sortit dans un double programme très Nickel Odéon avec GOLD OF THE SEVEN SAINTS et sa musique épouse frontalement les péripéties, voire les conventions du scénario d’Edward Anhalt d’après un roman obscur, notamment lors des dernières scènes où un contrepoint religieux vient se fondre dans le thème d’amour. Rachel Cade est en effet une missionnaire venue du Kansas pour soigner et bien sûr évangéliser les habitants d’une région perdue du Congo Belge. Elle va tomber amoureuse de deux hommes, l’officier agnostique qui administre le district (Peter Finch reprend un personnage qu’il avait joué dans A NUN’S STORY) et un jeune et brillant aviateur (Roger Moore). Disons le tout de suite, l’histoire d’amour même traitée avec sobriété et concision est ce qu’il y a de moins intéressant dans le film. Comme l’écrit le rédacteur de Coffee, Coffee and more Coffee : « Ce film doit être aimé et chéri pour les gros plans d’Angie Dickinson… On ne parle pas seulement des plans très serrés mais de ceux où ses lèvres délimitent le bas du cadre et ses sourcils le haut. Et où les couleurs sont comme adoucies, peut-être à cause du tirage, mais cela marche. Je n’ai jamais vu Angie Dickinson aussi amoureusement photographiée que dans ce film. » Nous sommes assez d’accord avec cet admirateur enthousiaste. On a l’impression que Gordon Douglas et son chef opérateur Peverell Marley sont tombés amoureux d’Angie Dickinson et avec elle, son visage avec quelques gouttes de sueur, on accepte avec un certain plaisir pervers ce Congo Belge reconstitué à Burbank, ces rebondissements éculés qui auraient pu être beaucoup plus gênants (l’enfant malade qu’on va sauver, les rivalités avec le sorcier local joué par Woody Strode, la pseudo malédiction des dieux) d’autant que Douglas les traite avec une vraie conviction, une franchise dans l’approche, le regard, glissant ici et là de petites surprises, une fin de scène occultée, une maladie qu’on ne peut guérir, un échec qui fait douter l’héroïne. Il filme plusieurs scènes sous la pluie, dans la brume, ce qui les rend plus denses, plus réalistes ou de nuit, pour casser le côté trop poli du décor en studio et le crédibiliser, fait parler les acteurs doucement, ce qui convient parfaitement à Peter Finch. Rachel Cade affiche certes ses convictions mais sans les imposer et plusieurs fois on lui oppose des arguments recevables : la paix que prétend imposer le christianisme est mis à mal par cette guerre (l’action se passe durant le conflit de 39-45) entre des nations chrétiennes. Le film réunit de très nombreux acteurs noirs, de Rafer Johnson à Errol John (remarquable de force) en passant par Juano Hernandez, Scatman Crothers que Douglas filme avec plus d’empathie et de respect que le scénario le laissait supposer. Revenons à Coffee, Coffee and more Coffee : « On pourrait couper tout le reste et obtenir un poème visuel encore plus beau que ce qu’avait réussi Joseph Cornell en supprimant tout ce qui était superflu dans EAST OF BORNEO pour ne garder que Rose Hobart. »
Revu aussi AIR FORCE et la séquence qu’écrivit William Faulkner (le reste du scénario est de Hawks et Dudley Nichols) – la mort du commandant de la super forteresse – se remarque par sa puissance dramatique. La première moitié du film où l’on prend peu à peu conscience de la raclée subit par les Américains, où l’on passe d’un aérodrome dévasté à un champ de ruines, vous empoigne et n’a pas pris une ride. Malheureusement le dernier tiers bascule dans la fiction la plus extravagante et l’on a du mal à s’intéresser à des péripéties qui même à l’époque passaient les bornes de la propagande. Le scénario n’avait pas été achevé et toute cette fin fut bâclée parfois sans Hawks qui reconnaît ces manques. La vision du film est quand même moins ample, moins généreuse, moins humaniste que celle de Ford dans les SACRIFIÉS.
J’ai déjà dit tout le bien que je pensais de A 23 PAS DU MYSTERE de Henry Hathaway, intrigue policière traitée avec une sèche rigueur, un découpage tranchant.
Parmi mes découvertes dans les films Pré-Code, je tiens à signaler CENTRAL AIRPORT, un Wellman de tout premier ordre (Warner on demand), jamais cité quand on parle de ses films d’aviation. Pourtant la séquence de sauvetage finale dans la nuit, dans le brouillard et en hydravion, justifie à elle seule la vision de ce film mené à cent à l’heure.
LE BARBARE ET LA GEISHA a été réhabilité ici et là, ce qui me paraît incompréhensible. Certes, il ne fait pas partie des quelques films que Huston a ouvertement bâclés parce qu’il s’en désintéressait dès le début ou qu’il perdait foi dans le projet (SINFUL DAVEY). Il y a de vraies recherches visuelles, inspirées par les estampes et la calligraphie japonaise, un travail parfois intéressant sur ces murs en papier et les ombres portées. La photographie de Charles Clarke est fort belle mais tout cela n’anime pas une dramaturgie amorphe, léthargique pointée par le producteur Buddy Adler et par John Wayne qui envoya dix pages de notes que Huston ne regarda pas. Elles paraissaient pourtant assez sensées. Le film est totalement dépourvu de tension dramatique. On admire des plans et on baille.
Mieux vaut voir IN THIS OUR LIFE (WARNER ARCHIVE), sa seconde mise en scène, mélodrame décrié qui vaut mieux que sa réputation. Certes, l’intrigue est prévisible mais Howard Koch dont le script est parfois lourd, signe ici et là des séquences fortes, âpres, bien écrites : toutes celles qui opposent Bette Davis qui en fait des tonnes (mais campe finalement un terrifiant personnage d’égoïste, irresponsable, psychopathe) et un splendide Charles Coburn, oncle gâteau qui la pourrit, lui passe ses caprices en lui expliquant cyniquement comment il a ruiné son père. Portrait aigu d’un capitaliste doucereux et impitoyable, réactionnaire et aveugle. Ces scènes riches en sous entendus troubles sont fort bien dirigées par Huston qui impose un ton rapide. A l’actif du film, un personnage de jeune noir, intelligent, éduqué qui veut devenir avocat qui bat en brèche tous les stéréotypes raciaux et racistes. Il s’agit de l’un des personnages les plus progressistes, les plus audacieux du cinéma américain de l’époque. Il faut voir aussi comment Huston filme avec décence, dignité sa mère (Hattie McDaniels à des années lumière d’AUTANT EN EMPORTE LE VENT) en éliminant tous les maniérismes raciaux si gênants. Tous les moments où il est accusé d’avoir écrasé une mère et son enfant par Bette Davis, qui est la vraie coupable, sont extrêmement forts. Et notamment quand il déclare dans la prison que la parole d’un jeune noir ne sera pas prise en compte par les jurés blancs. Ernest Anderson est excellent dans ce rôle. Olivia de Havilland est fort belle (Huston avait une romance très forte avec elle) et Dennis Morgan est correct dans un personnage de convention. Beaucoup d’excellents seconds rôles dont Billie Burke et Frank Craven.
FILMS PRÉ-CODE : VOYAGE SANS RETOUR (Warner)
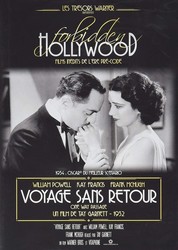 Une des plus belles histoires d’amour qui se perpétue après la mort, un sujet de mélodrame traité en comédie romantique, ONE WAY PASSAGE tourne le dos à tous les clichés du genre dès son scénario relativement épuré des gags redondants comme parfois chez Garnett. Le personnage de Powell n’a pas de rival, la jalousie ne vient jamais entraver l’amour qu’éprouvent les deux personnages principaux. La mise en scène fluide, inventive, avec une caméra extrêmement mobile, impose un ton léger, intime alors que le destin des deux protagonistes est tragique : William Powell songe souvent à se débarrasser du policier qui le surveille, Kay Francis (dont la sexualité élégante ne survécut pas à l’imposition du Code) se sait condamnée par la maladie. Garnett transcende ce que le sujet pouvait avoir de morbide en lui insufflant un optimisme qui semble aller de soi. Le premier plan donne le la : on y voit des chanteurs de bar récupérer des pièces jusque dans le crachoir (le pianiste a coincé une cigarette entre les touches) et s’interrompre pour désigner les toilettes. Un régal et ceux qui le boudent doivent abandonner ce site.
Une des plus belles histoires d’amour qui se perpétue après la mort, un sujet de mélodrame traité en comédie romantique, ONE WAY PASSAGE tourne le dos à tous les clichés du genre dès son scénario relativement épuré des gags redondants comme parfois chez Garnett. Le personnage de Powell n’a pas de rival, la jalousie ne vient jamais entraver l’amour qu’éprouvent les deux personnages principaux. La mise en scène fluide, inventive, avec une caméra extrêmement mobile, impose un ton léger, intime alors que le destin des deux protagonistes est tragique : William Powell songe souvent à se débarrasser du policier qui le surveille, Kay Francis (dont la sexualité élégante ne survécut pas à l’imposition du Code) se sait condamnée par la maladie. Garnett transcende ce que le sujet pouvait avoir de morbide en lui insufflant un optimisme qui semble aller de soi. Le premier plan donne le la : on y voit des chanteurs de bar récupérer des pièces jusque dans le crachoir (le pianiste a coincé une cigarette entre les touches) et s’interrompre pour désigner les toilettes. Un régal et ceux qui le boudent doivent abandonner ce site.
CLARENCE BROWN
Je ne crois pas que l’on ait beaucoup évoqué ce réalisateur dans ce blog et c’est un peu dommage car on lui doit pas mal de films réussis ou importants (il fut pendant des années un des réalisateurs de prestige de la MGM). Je me souviens de la rétrospective que lui consacra la Cinémathèque. En l’inaugurant, il rendit un long hommage émouvant à Maurice Tourneur qui lui avait tout appris. Et quand, vers la fin de sa vie, Tourneur connut des difficultés financières, Brown, nous apprend Christine Leteux, vint plusieurs fois à son secours. C’était un homme généreux et loyal, bienveillant, ce qui se traduit dans ses meilleurs films dont le très émouvant JODY ET LE FAON (THE YEARLING) (DVD Warner en France), œuvre beaucoup plus dure et noire qu’on l’aurait cru, piégé par le côté chronique familiale.
En le revoyant, j’ai été frappé par la maturité de la description du personnage de Jane Wyman, cette femme meurtrie par la mort prématurée de ses enfants et qui s’est réfugiée derrière un mur d’indifférence. Les scènes de chasse sont foudroyantes avec des travellings à couper le souffle et un nombre considérable de véritables extérieurs (arrachés par Brown) pour une production Metro. Le film sobre, tenu, subtil (Peck est très juste même s’il ne fait pas très sudiste) est de plus d’une très grand beauté visuelle avec un lyrisme qui vous prend le cœur.
Ce que l’on retrouve dans le très puissant INTRUDER IN THE DUST (DVD Warner ARCHIVE sans sous-titres) adaptation fidèle du roman de Faulkner, qui gagne à chaque révision. Brown et Ben Maddow se contentent d’élaguer les longues digressions (passionnantes) de Gavin Stevens sur la métaphysique du Sud. L’interprétation de Juano Hernandez est inoubliable et le romancier noir Ralph Ellison pouvait écrire qu’INTRUDER IN THE DUST était « le seul film qu’un public de Harlem pouvait prendre au sérieux, le seul qui contenait l’image d’un Noir avec qui on pouvait s’identifier ».
Parmi les autres Brown on peut se procurer en zone 1 WIFE VERSUS SECRETARY, une très bonne comédie écrite par John Lee Mahin et Norman Krasna où Jean Harlow joue une fille intelligente, rapide, efficace, secrètement amoureuse de son patron Clark Gable. Le film semble une réponse morale aux audaces des productions Pré-Code mais le ton est intelligent, vif et l’interprétation du trio (Myrna Loy a le moins bon rôle) est magistrale. On frôle quand même le drame et les changements de ton sont négociés avec brio et un vrai sens des nuances par Clarence Brown : les séquences dans les chambres d’hôtel à Cuba dégagent une vraie tension sexuelle et la dernière confrontation entre l’épouse et la secrétaire est filmée avec une retenue, une délicatesse rare.
En zone 2, on peut se procurer des vrais films Pré-Code : la période semble avoir été bénéfique pour Brown et A FREE SOUL (ÂMES LIBRES) en est une nouvelle preuve. L’intrigue et la morale fondée sur le rachat, l’expiation de deux (ou trois) transgressions peuvent paraître datées mais le traitement réserve bien des surprises. Le ton rapide, la narration nerveuse, le dialogue souvent brillant et inventif mettent en valeur de nombreux détails audacieux à commencer par la première scène où une jeune femme exhibe ses sous-vêtements avec un dialogue osé devant un homme qui se révèle être son père. La dernière intervention de Barrymore au tribunal lui fit, dit-on, gagner l’Oscar. Cette scène mérite de figurer parmi les péripéties judiciaires les plus extravagantes : Barrymore reprend à la dernière minute la défense du fiancé de sa fille, interroge cette dernière afin qu’elle avoue sa liaison cachée avec Gable, qu’il a accepté, inconscience décuplée par l’alcool, ce qui lui permet d’endosser la responsabilité de tout ce qui est arrivé.
SADIE MCKEE, comédie sociale souvent incisive est du même niveau et Edward Arnold est formidable en milliardaire ivrogne. Nous défendions fortement déjà FASCINATION (POSSESSED) dans 50 ANS, louant les extraordinaires premières séquences, la confrontation entre Joan Crawford, modeste ouvrière et un train de luxe qui passe lentement devant elle. Ce mélodrame inspiré contenait des plans quasi-wellesiens. Je signale parmi ses films muets le fort bon TRAIL OF 98 (zone 1), LA CHAIR ET LE DIABLE avec Garbo et John Gilbert, LE DERNIER DES MOHICANS qu’il co-réalisa avec Maurice Tourneur et chez Kino, LORNA DOONE dont il dirigea l’une des premières séquences, la poursuite d’un carrosse sur une plage.
En revanche je reste toujours assez réticent devant une bonne partie de CAPITAINE SANS LOI, récit figé, académique, pourtant l’un des très rares consacré aux pèlerins du Mayflower dont on peut sauver pourtant une fort belle scène de tempête, très réussie et bien filmée. Mais l’histoire d’amour rajoutée et fausse historiquement entre Spencer Tracy et Gene Tierney, peu convaincante plombe le film.
Parmi mes découvertes dans les films Pré-Code, je tiens à signaler CENTRAL AIRPORT un Wellman de tout premier ordre (Warner on demand), jamais cité quand on parle de ses films d’aviation. Pourtant la séquence de sauvetage finale dans la nuit, dans le brouillard et en hydravion, justifie à elle seule la vision de ce film mené à cent à l’heure.
OLIVER STONE
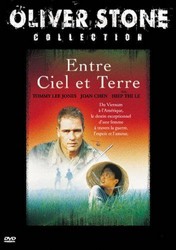 Je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de parler d’Oliver Stone dont j’ai revu pourtant avec une vraie émotion PLATOON qui tient très bien le coup et les deux autres volets de sa trilogie vietnamienne. Avec HEAVEN & EARTH (ENTRE CIEL ET TERRE, d’après l’autobiographie de l’héroïne, Le Ly Hayslip), Stone se lance de nouveaux défis : centrer son récit non plus autour d’un monde d’hommes mais sur un personnage féminin, une petite paysanne vietnamienne, Le Ly, que l’on va voir grandir durant toute cette guerre ce qui oblige à prendre un angle diamétralement opposé. Ce film est, à notre connaissance, le seul, qui donne le point de vue des Vietnamiens, décrivant la vie de l’héroïne, de sa famille (un frère part rejoindre les Viet Cong QUI SONT TOUT AUSSI DOGMATIQUES, L’UN D’EUX VIOLERA L’HÉROÏNE) et de son village durant toute la première partie (ce qui nous vaut des plans élégiaques, un montage calme). Une vie saccagée par la guerre, les violences commises par les deux camps, les bombardements, les attentats. Stone montre que si le jour le pays appartient aux Américains, la nuit ce sont les Nord Vietnamiens qui contrôlent la situation. On sent que la stratégie américaine est vouée à l’échec malgré ces irruptions tonitruantes, ces hélicoptères. ENTRE CIEL ET TERRE souffre durant la première moitié de ce que tout le monde s’exprime en anglais (diktat du studio). Dans la seconde partie, avec l’arrivée de Tommy Lee Jones, remarquable, tout s’arrange et plusieurs séquences sont très puissantes. NÉ UN QUATRE JUILLET est le plus polémique, le plus engagé et il contient des scènes inoubliables, une dénonciation terrible du traitement des blessés dans des hôpitaux sans moyens, sans matériel avec un personnel débordé. L’accusation porte fort. Tom Cruise est magnifique.
Je n’ai pas eu beaucoup l’occasion de parler d’Oliver Stone dont j’ai revu pourtant avec une vraie émotion PLATOON qui tient très bien le coup et les deux autres volets de sa trilogie vietnamienne. Avec HEAVEN & EARTH (ENTRE CIEL ET TERRE, d’après l’autobiographie de l’héroïne, Le Ly Hayslip), Stone se lance de nouveaux défis : centrer son récit non plus autour d’un monde d’hommes mais sur un personnage féminin, une petite paysanne vietnamienne, Le Ly, que l’on va voir grandir durant toute cette guerre ce qui oblige à prendre un angle diamétralement opposé. Ce film est, à notre connaissance, le seul, qui donne le point de vue des Vietnamiens, décrivant la vie de l’héroïne, de sa famille (un frère part rejoindre les Viet Cong QUI SONT TOUT AUSSI DOGMATIQUES, L’UN D’EUX VIOLERA L’HÉROÏNE) et de son village durant toute la première partie (ce qui nous vaut des plans élégiaques, un montage calme). Une vie saccagée par la guerre, les violences commises par les deux camps, les bombardements, les attentats. Stone montre que si le jour le pays appartient aux Américains, la nuit ce sont les Nord Vietnamiens qui contrôlent la situation. On sent que la stratégie américaine est vouée à l’échec malgré ces irruptions tonitruantes, ces hélicoptères. ENTRE CIEL ET TERRE souffre durant la première moitié de ce que tout le monde s’exprime en anglais (diktat du studio). Dans la seconde partie, avec l’arrivée de Tommy Lee Jones, remarquable, tout s’arrange et plusieurs séquences sont très puissantes. NÉ UN QUATRE JUILLET est le plus polémique, le plus engagé et il contient des scènes inoubliables, une dénonciation terrible du traitement des blessés dans des hôpitaux sans moyens, sans matériel avec un personnel débordé. L’accusation porte fort. Tom Cruise est magnifique.
Dans TALK RADIO, surgit au fil des appels radiophoniques une Amérique pleine de rancœurs antisémites, suprémacistes, où fleurissent les pire discours extrémistes. Avec le recul, on s’aperçoit que Stone et son scénariste Eric Bogosian avaient repéré de manière prophétique la naissance de tout un électorat populaire, frustré, abruti par la télévision, oublié par les politiques, qui allait se venger 25 ans plus tard en faisant élire Trump.
L’ENFER DU DIMANCHE
Voilà une des œuvres les plus révélatrices du talent réel, des qualités évidentes d’Oliver Stone, autant sinon plus que WALL STREET, BORN ON THE 4th of JULY, THE DOORS et aussi de ce qui mine parfois certains films, effets visuels voyants, idées préconçues, symbolisme appuyé avec risques de manipulation, les deux étant parfois indissociables comme les deux faces d’une même pièce. Ici, on retrouve surtout les qualités, la fureur – il n’y a pas d’autres mots – narrative, kinésique avec lesquels il plonge dans certains milieux, la Bourse, la politique. Le regard qu’il pose sur le football américain est évidemment des plus décapants. Il n’épargne rien ni personne, pointe la publicité qui a tout gangrené (« La TV a changé notre manière de penser, tout a été ruiné dès la première interruption publicitaire. C’est notre concentration qui comptait pas celle d’un connard vendant des corn flakes », dit le coach Tony D’Amato que joue Al Pacino), les autorités sportives qui couvrent les pires malversations, le côté épouvantablement machiste de cet univers, cette débauche de testostérone aussi bien durant les matches, festivals d’injures raciste et homophobes, que dans les fêtes où l’alcool et la drogue coulent à flot, l’obsession de l’argent qui transforme les joueurs en prima donna obsédées par les primes et pousse Christina Pagniacci (Cameron Diaz), la propriétaire de l’équipe, à vouloir la vendre comme une franchise, la médecine sportive totalement corrompue au point de renvoyer sur le terrain un joueur qui peut y laisser sa peau. Le tout filmé avec une énergie incroyable.