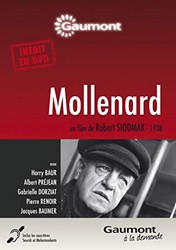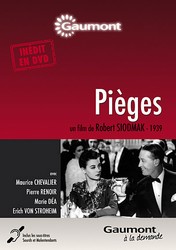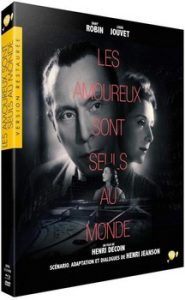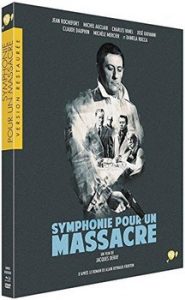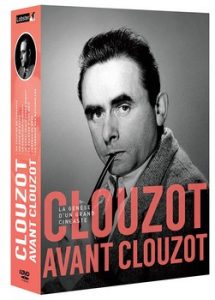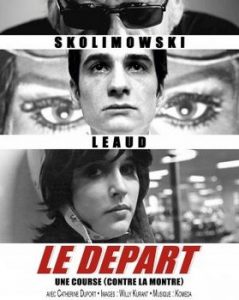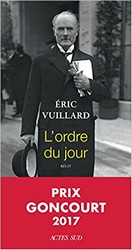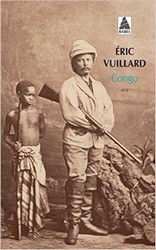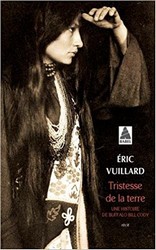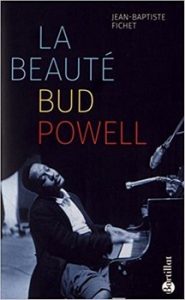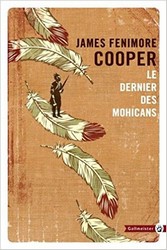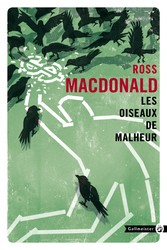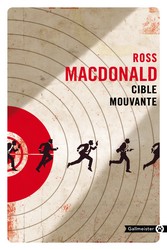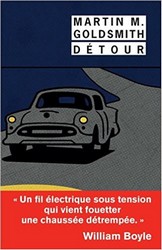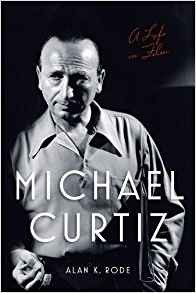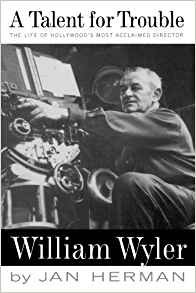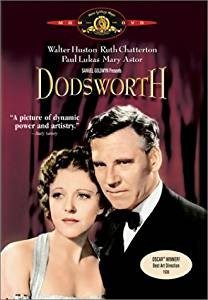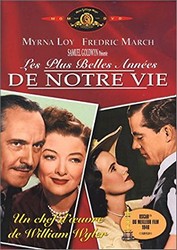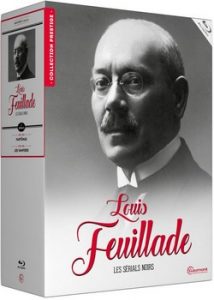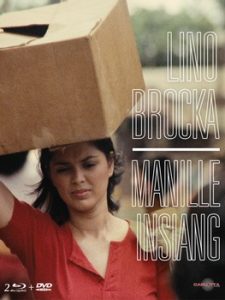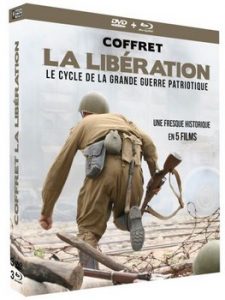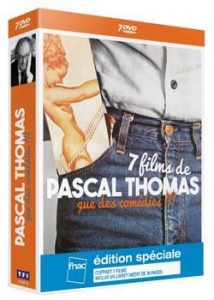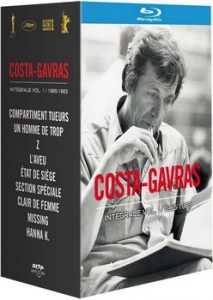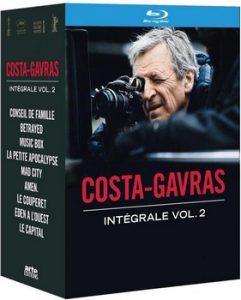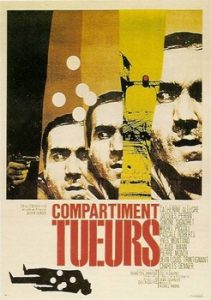MUETS
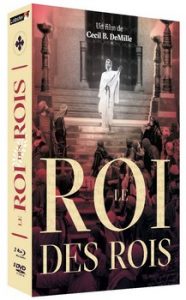 LE ROI DES ROIS a déjà suscité des commentaires élogieux et, du coup, je l’ai revu : sa réalisation avec ses folles exigences faillit ruiner DeMille qui dut à la fin s’associer avec Pathé, ce qu’il considérait comme un déshonneur. Il faut dire qu’il utilisa une partie de l’argent qu’il avait récolté pour moderniser ses studios (le coût réel de fabrication était moitié moindre que celui annoncé, écrit Scott Eyman). Le résultat est parfois moins poussiéreux que nous l’écrivions et on a trouvé ici et là des moments inspirés : la première apparition du Christ filmée du point de vue d’un enfant aveugle à qui il vient de rendre la vue, un travelling suivant la croix que porte le Christ qui traîne sur le sol, le début de la crucifixion, le décor stylisé de l’arbre où se pend Judas. Et quelques intertitres juteux, ponctuant les ordres de Marie Madeleine : « Apportez moi mes parfums les plus riches, harnachez mes zèbres, cadeaux du roi de Nubie ! Ce Charpentier apprendra qu’’il ne peut pas voler un homme à Marie Madeleine. » L’attelage est étonnant et l’utilisation des animaux sauvages surprend. Il faut dire que DeMille imagine que Judas est passionnément amoureux de Marie Madeleine et que sa conversion va provoquer sa trahison, idée assez colorée. Quand on lui dit que Jésus a guéri des aveugles, elle répond avec superbe : « J’en ai aveuglé plus qu’il n’en a guéri. » Jacqueline Logan en fait malheureusement des tonnes dans ce rôle et l’interprétation générale, en dehors de H.B. Warner, (comédien qu’il fallait sans cesse empêcher de boire et de séduire les filles) dans le rôle de Jésus, est souvent théâtrale (même si les visages sont bien choisis) et les plans parfois sulpiciens. Mais on a récemment découvert grâce a David Pierce les scènes en Technicolor, procédé qu’il utilise pour l’ouverture, flamboyante, luxuriante avec ce chatoiement inouï des étoffes et des costumes qui transfigure la séquence, ce repas donné en l’honneur de Marie Madeleine, et pour la Résurrection, dont seule la première partie provient de la copie d’origine. La seconde a été restaurée numériquement. Au début, les couleurs sont plus sombres, plus retenues, plus dramatique jusqu’à l’apparition du Christ où certains plans frôlent le chromo mais l’ensemble reste tout aussi spectaculaire et on doit remercier Lobster de ces découvertes. Dans les bonus, on découvre des images magnifiques où l’on voit Griffith rendre visite à DeMille à côté de Jeanie McPherson, une des maîtresses du cinéaste qui écrivit 34 de ses films.
LE ROI DES ROIS a déjà suscité des commentaires élogieux et, du coup, je l’ai revu : sa réalisation avec ses folles exigences faillit ruiner DeMille qui dut à la fin s’associer avec Pathé, ce qu’il considérait comme un déshonneur. Il faut dire qu’il utilisa une partie de l’argent qu’il avait récolté pour moderniser ses studios (le coût réel de fabrication était moitié moindre que celui annoncé, écrit Scott Eyman). Le résultat est parfois moins poussiéreux que nous l’écrivions et on a trouvé ici et là des moments inspirés : la première apparition du Christ filmée du point de vue d’un enfant aveugle à qui il vient de rendre la vue, un travelling suivant la croix que porte le Christ qui traîne sur le sol, le début de la crucifixion, le décor stylisé de l’arbre où se pend Judas. Et quelques intertitres juteux, ponctuant les ordres de Marie Madeleine : « Apportez moi mes parfums les plus riches, harnachez mes zèbres, cadeaux du roi de Nubie ! Ce Charpentier apprendra qu’’il ne peut pas voler un homme à Marie Madeleine. » L’attelage est étonnant et l’utilisation des animaux sauvages surprend. Il faut dire que DeMille imagine que Judas est passionnément amoureux de Marie Madeleine et que sa conversion va provoquer sa trahison, idée assez colorée. Quand on lui dit que Jésus a guéri des aveugles, elle répond avec superbe : « J’en ai aveuglé plus qu’il n’en a guéri. » Jacqueline Logan en fait malheureusement des tonnes dans ce rôle et l’interprétation générale, en dehors de H.B. Warner, (comédien qu’il fallait sans cesse empêcher de boire et de séduire les filles) dans le rôle de Jésus, est souvent théâtrale (même si les visages sont bien choisis) et les plans parfois sulpiciens. Mais on a récemment découvert grâce a David Pierce les scènes en Technicolor, procédé qu’il utilise pour l’ouverture, flamboyante, luxuriante avec ce chatoiement inouï des étoffes et des costumes qui transfigure la séquence, ce repas donné en l’honneur de Marie Madeleine, et pour la Résurrection, dont seule la première partie provient de la copie d’origine. La seconde a été restaurée numériquement. Au début, les couleurs sont plus sombres, plus retenues, plus dramatique jusqu’à l’apparition du Christ où certains plans frôlent le chromo mais l’ensemble reste tout aussi spectaculaire et on doit remercier Lobster de ces découvertes. Dans les bonus, on découvre des images magnifiques où l’on voit Griffith rendre visite à DeMille à côté de Jeanie McPherson, une des maîtresses du cinéaste qui écrivit 34 de ses films.
SHOES vu sur Arte donne envie de découvrir d’autres films de Lois Weber comme THE BLOT (disponible en zone 1) et HYPOCRITES, le premier film à montrer une femme nue de face (Kino Lorber).
SORTIES ET RESSORTIES
FILMS FRANÇAIS
 En France, Gaumont a sorti en Blu-ray LE MARIAGE DE CHIFFON, film que j’adore et que j’ai revu des dizaines de fois. Dialogue étincelant, délicat, cocasse, tendre de Jean Aurenche avec cette sublime réplique lancée par Claude Marcy qui refuse de croire que les aéroplanes puissent voler puisqu’ils sont plus lourds que l’air, ce à quoi Jacques Dumesnil répond avec bon sens que les oiseaux aussi sont plus lourds que l’air : « Les oiseaux plus lourds que l’air ? Quelle sottise ! », admirable condensé de bêtise auto-satisfaite et d’ignorance revendiquée. (Bonne occasion pour signaler aussi la biographie magistrale de Jean-Pierre Bleys sur Autant-Lara chez Actes Sud).
En France, Gaumont a sorti en Blu-ray LE MARIAGE DE CHIFFON, film que j’adore et que j’ai revu des dizaines de fois. Dialogue étincelant, délicat, cocasse, tendre de Jean Aurenche avec cette sublime réplique lancée par Claude Marcy qui refuse de croire que les aéroplanes puissent voler puisqu’ils sont plus lourds que l’air, ce à quoi Jacques Dumesnil répond avec bon sens que les oiseaux aussi sont plus lourds que l’air : « Les oiseaux plus lourds que l’air ? Quelle sottise ! », admirable condensé de bêtise auto-satisfaite et d’ignorance revendiquée. (Bonne occasion pour signaler aussi la biographie magistrale de Jean-Pierre Bleys sur Autant-Lara chez Actes Sud).
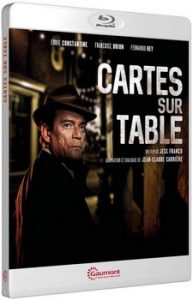 Sortent aussi LE FRANCISCAIN DE BOURGES que je vais essayer de revoir (musique d’Antoine Duhamel) même si j’en ai un très mauvais souvenir ; UN HOMME À ABATTRE de Philippe Condroyer, un beau film dont j’ai parlé (là encore, musique d’Antoine Duhamel) ; ADHEMAR OU LE JOUET DE LA FATALITÉ de Fernandel, écrit par Sacha Guitry, et torpillé par Fernandel dont la mise en scène aplatit toutes les trouvailles cocasses de Guitry comme cette fausse et cocasse tragédie classique perturbée par le souffleur ; CARTES SUR TABLES, une sorte de serial de Jésus Franco, adapté et dialogué par Jean-Claude Carrière avec tueurs robotiques auxquels des lunettes donnent une force surnaturelle, extermination des chefs d’état, vamp ténébreuse. Difficile de dire s’il y a un VRAI second degré allant au-delà des Constantine à la Borderie. La mise en scène respire souvent sinon le bâclage, du moins le tournage très rapide tant les raccords, l’enchaînement des plans semble incertain. Constantine s’en sort plutôt pas mal (quand on lui demande son poids, il répond toujours 318 kilos, ce qui n’étonne personne ; est-ce un clin d’œil de Carrière ?). Le son est typique des VF, tous les acteurs espagnols dont Fernando Rey étant doublés. La charmante Sophie Hardy (qu’on avait vu dans 3 HATS FOR LISA de Sidney Hayers) exécute un numéro assez suggestif en collant chair moulant, révélant des formes agréables mais ses plans de réaction sont surlignés. Certains parlent de chef d’œuvre improbable.
Sortent aussi LE FRANCISCAIN DE BOURGES que je vais essayer de revoir (musique d’Antoine Duhamel) même si j’en ai un très mauvais souvenir ; UN HOMME À ABATTRE de Philippe Condroyer, un beau film dont j’ai parlé (là encore, musique d’Antoine Duhamel) ; ADHEMAR OU LE JOUET DE LA FATALITÉ de Fernandel, écrit par Sacha Guitry, et torpillé par Fernandel dont la mise en scène aplatit toutes les trouvailles cocasses de Guitry comme cette fausse et cocasse tragédie classique perturbée par le souffleur ; CARTES SUR TABLES, une sorte de serial de Jésus Franco, adapté et dialogué par Jean-Claude Carrière avec tueurs robotiques auxquels des lunettes donnent une force surnaturelle, extermination des chefs d’état, vamp ténébreuse. Difficile de dire s’il y a un VRAI second degré allant au-delà des Constantine à la Borderie. La mise en scène respire souvent sinon le bâclage, du moins le tournage très rapide tant les raccords, l’enchaînement des plans semble incertain. Constantine s’en sort plutôt pas mal (quand on lui demande son poids, il répond toujours 318 kilos, ce qui n’étonne personne ; est-ce un clin d’œil de Carrière ?). Le son est typique des VF, tous les acteurs espagnols dont Fernando Rey étant doublés. La charmante Sophie Hardy (qu’on avait vu dans 3 HATS FOR LISA de Sidney Hayers) exécute un numéro assez suggestif en collant chair moulant, révélant des formes agréables mais ses plans de réaction sont surlignés. Certains parlent de chef d’œuvre improbable.
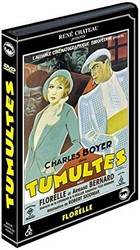 Je recommande très chaleureusement TUMULTES de Robert Siodmak qui fut tourné en double version, allemande avec Emil Jannings et Anna Sten qui reste difficilement trouvable et française avec Charles Boyer et Florelle dans une adaptation d’Yves Mirande. La mise en scène de Siodmak regorge d’inventions, de trouvailles, tant dans les mouvements d’appareils que dans les cadrages très composés (beaucoup de plongées, d’angles inhabituels) sans que cela fige le récit. Elle impose un ton grinçant, noir, caustique qui par moment tire le propos – un truand qui risque de replonger après être sorti de prison – vers un apologue à la Brecht, celui de Baal. Boyer saisissant de gouaille populaire, d’ironie donne une couleur mélancolique à son personnage (on pense au LILLIOM de Lang) et Florelle, toujours d’une justesse confondante (souvenez vous du CRIME DE MONSIEUR LANGE) apporte une fragilité, une vulnérabilité à ce qui n’aurait pu être qu’un archétype de la garce manipulatrice. Elle a une manière si poignante de dire « Mon cœur » à tous ses amants qu’on finit par croire à ses sincérités successives. Elle chante de manière sublime la magnifique goualante « Qui j’aime », écrite par Friedrich Hollander et Jean Boyer. Oui Jean Boyer, parolier très talentueux (« Un Mauvais Garçon », « Prends la route », « Comme de Bien Entendu », « Totor t’as tort, tu t’uses et tu te tues’). Il faut la voir parler entre deux vers, plaisanter puis reprendre la chanson avec un naturel foudroyant. Essayez de l’écouter chanter du Kurt Weil : « le Roi d’Aquitaine », sublime chanson dont elle donne une version quasi définitive même si j’aime bien celle de Marie Desgranges dans LAISSEZ PASSER, « Le Grand Lustucru » tout aussi magnifique, « Les Filles de Bordeaux » (c’étaient des airs tirés de MARIE GALANTE écrit par Jacques Deval), « La chanson de Barbara », « J’attends un navire ». Vive Florelle !
Je recommande très chaleureusement TUMULTES de Robert Siodmak qui fut tourné en double version, allemande avec Emil Jannings et Anna Sten qui reste difficilement trouvable et française avec Charles Boyer et Florelle dans une adaptation d’Yves Mirande. La mise en scène de Siodmak regorge d’inventions, de trouvailles, tant dans les mouvements d’appareils que dans les cadrages très composés (beaucoup de plongées, d’angles inhabituels) sans que cela fige le récit. Elle impose un ton grinçant, noir, caustique qui par moment tire le propos – un truand qui risque de replonger après être sorti de prison – vers un apologue à la Brecht, celui de Baal. Boyer saisissant de gouaille populaire, d’ironie donne une couleur mélancolique à son personnage (on pense au LILLIOM de Lang) et Florelle, toujours d’une justesse confondante (souvenez vous du CRIME DE MONSIEUR LANGE) apporte une fragilité, une vulnérabilité à ce qui n’aurait pu être qu’un archétype de la garce manipulatrice. Elle a une manière si poignante de dire « Mon cœur » à tous ses amants qu’on finit par croire à ses sincérités successives. Elle chante de manière sublime la magnifique goualante « Qui j’aime », écrite par Friedrich Hollander et Jean Boyer. Oui Jean Boyer, parolier très talentueux (« Un Mauvais Garçon », « Prends la route », « Comme de Bien Entendu », « Totor t’as tort, tu t’uses et tu te tues’). Il faut la voir parler entre deux vers, plaisanter puis reprendre la chanson avec un naturel foudroyant. Essayez de l’écouter chanter du Kurt Weil : « le Roi d’Aquitaine », sublime chanson dont elle donne une version quasi définitive même si j’aime bien celle de Marie Desgranges dans LAISSEZ PASSER, « Le Grand Lustucru » tout aussi magnifique, « Les Filles de Bordeaux » (c’étaient des airs tirés de MARIE GALANTE écrit par Jacques Deval), « La chanson de Barbara », « J’attends un navire ». Vive Florelle !
Je n’avais eu que peu de retour sur des Siodmak que j’avais défendus sur ce blog à commencer par MOLLENARD, un de ses deux ou trois plus grands films et l’un des plus grands rôles de Harry Baur, l’acteur français le plus sous-estimé. Je consacre un long passage à ce film, voulu, imposé par Siodmak (musique de Darius Milhaud) ainsi qu’à PIÈGES, plus mineur mais où on doit saluer la première interprétation dramatique de Maurice Chevallier et la présence mutine de la délicieuse Marie Dea dont le charme, le piquant, le jeu très moderne gomment ce que son personnage peut avoir d’improbable.
Vu les commentaires élogieux et justifiés écrits ici même sur plusieurs Cayatte, après de nouvelles visions, je me contenterai de rappeler ces titres presque tous chez Gaumont : AVANT LE DÉLUGE (le personnage joué par Balpétré prend un relief très actuel, hélas et Marina Vlady est hyper craquante) ; l’excellent et très original PASSAGE DU RHIN ; JUSTICE EST FAITE que défendait Lourcelles ; NOUS SOMMES TOUS DES ASSASSINS ; sans oublier son sketch de RETOUR A LA VIE, d’une audace glaçante. Bonne occasion aussi de saluer Charles Spaak.
Dans la même collection rouge, TOÂ de Guitry est une plaisante surprise bien que le budget ait dû être ultra-serré et la caméra semble presque plus paralysée dans l’appartement de l’auteur que dans le décor sur scène censé le représenter. Mais le sujet, cette variation ironique sur la vie et le théâtre (un écrivain est pris à partie par une femme qui s’estime diffamée et pense le tuer), est si original, si drolatique qu’on est constamment charmé.
CLUB DE FEMMES, premier film de Jacques Deval, vaut pour son sujet (cet hôtel réservé aux femmes), son ton un peu féministe et surtout pour l’interprétation exquise de Danielle Darrieux.
Pathé vient de sortir l’une des grandes réussites de Henri Decoin, merveilleusement écrite par Henri Jeanson, LES AMOUREUX SONT SEULS AU MONDE, où, comme on l’a dit ici même, Jouvet et la merveilleuse et fine Renée Devillers sont éblouissants (Dany Robin en paraît étriquée). Comme l’écrit Clara Laurent, la biographe de Darrieux sur le site L’Oeil du Témoin :
« Le 15 septembre 1948 sort sur les écrans un nouveau film d’Henri Decoin, Les Amoureux sont seuls au monde. La critique fait alors la fine bouche, le public boude le film. Didier Decoin, romancier et fils du réalisateur, se souvient pourtant que son père aimait beaucoup ce film avec Louis Jouvet, Renée Devillers et Dany Robin. Une œuvre profonde et très personnelle, dont la nouvelle édition Blu-ray chez Pathé (avril 2018) permet la redécouverte et la réévaluation. Analyse d’une pépite.
Un titre programmatique, une phrase prononcée par un des personnages du film, Monelle, incarnée par la jeune Dany Robin: « Les amoureux sont seuls au monde ». D’amour, il est bien question de bout en bout dans ce film qui débute comme une comédie sophistiquée et finit en tragédie. C’est Henri Jeanson qui est crédité au scénario mais il semble, d’après les recherches de Christophe Moussé, qu’Henri Decoin ait mis plus que la main à la pâte pour concocter cette histoire solidement charpentée. Il faut dire que Jeanson était plus doué pour les dialogues (brillants, parfois trop…) que pour la structure narrative des scénarios. Il faut remarquer aussi qu’Henri Decoin avait de quoi nourrir cette histoire de sa sensibilité et de son expérience personnelle. »
Sortie aussi de SYMPHONIE POUR UN MASSACRE de Jacques Deray, coécrit avec José Giovanni et Claude Sautet. Revu à Lyon, avec à coté de moi, Michelle Mercier qui insultait Jean Rochefort dès qu’il apparaissait sur l’écran. Il avait dit ou écrit que c’était une des plus mauvaises actrices avec qui il avait tourné, faisant allusion non à ce film où son rôle est minime mais à un des Angélique.
Lobster vient de sortir un fascinant coffret : CLOUZOT AVANT CLOUZOT dans lequel je vais me plonger.
FILMS DE L’EUROPE DE L’EST
 Malavida a tant fait pour le cinéma tchèque (voyez ou revoyez L’AS DE PIQUE, LES AMOURS D’UNE BLONDE en hommage à Milos Forman, DU COURAGE POUR CHAQUE JOUR, TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS, ALOUETTES, LE FIL A LA PATTE de Jiri Menzel, ce cinéaste funambule, ECLAIRAGE INTIME) et hongrois (le remarquable JOURS GLACÉS, 10 000 SOLEILS, LES GARÇONS DE LA RUE PAUL de Zoltan Fabbri, L’AGE DES ILLUSIONS et LES FAUCONS de Gaal et tant d’autres). Et l’éditeur vient de faire ressortir – en tout cas chez Gibert (car je n’arrive pas à les trouver sur leur site qui n’est pas très pratique) – plusieurs films du grand cinéaste polonais Jerzy Kawalerowicz dont MÈRE JEANNE DES ANGES et TRAIN DE NUIT que j’ai vanté ici-même et qu’il est bon de découvrir, ainsi qu’AUSTERIA que Philippe Haudiquet considérait comme un chef d’oeuvre.
Malavida a tant fait pour le cinéma tchèque (voyez ou revoyez L’AS DE PIQUE, LES AMOURS D’UNE BLONDE en hommage à Milos Forman, DU COURAGE POUR CHAQUE JOUR, TRAINS ÉTROITEMENT SURVEILLÉS, ALOUETTES, LE FIL A LA PATTE de Jiri Menzel, ce cinéaste funambule, ECLAIRAGE INTIME) et hongrois (le remarquable JOURS GLACÉS, 10 000 SOLEILS, LES GARÇONS DE LA RUE PAUL de Zoltan Fabbri, L’AGE DES ILLUSIONS et LES FAUCONS de Gaal et tant d’autres). Et l’éditeur vient de faire ressortir – en tout cas chez Gibert (car je n’arrive pas à les trouver sur leur site qui n’est pas très pratique) – plusieurs films du grand cinéaste polonais Jerzy Kawalerowicz dont MÈRE JEANNE DES ANGES et TRAIN DE NUIT que j’ai vanté ici-même et qu’il est bon de découvrir, ainsi qu’AUSTERIA que Philippe Haudiquet considérait comme un chef d’oeuvre.
On peut aussi trouver ces trois films restaurés en coffret dont voici la description : 1. TRAIN DE NUIT – Une place dans un wagon-lit à destination de Varsovie achetée à la sauvette lie d une manière inattendue une jeune femme et un homme. Martha cherche à rompre tandis que Jerzy, chirurgien, est bouleversé par la mort d’une adolescente sur sa table d’opération. La nouvelle d’un meurtre et de la présence de l’assassin dans le train vont venir troubler leur voyage… L’obsession plastique de Kawalerowicz se marie à merveille à une trame policière quasi hitchcockienne. Le huis clos est manié avec virtuosité, Zbigniew Cybulski trouve une nouvelle fois un rôle à sa mesure, et la copie restaurée permet d’apprécier un travail fabuleux sur le noir et blanc. 2. MÈRE JEANNE DES ANGES – Dans un cloître aux confins de la Pologne du XVIIIème siècle, Mère Jeanne et d’autres sœurs sont possédées par des démons. Le Père Suryn est envoyé au couvent pour les exorciser. Naît alors entre lui et Mère Jeanne une violente passion qu’aucun d’eux ne peut, ne sait et ne veut reconnaître. Sans doute le film le plus connu et le plus abouti de Kawalerowicz. Malgré sa condamnation par le Vatican à sa sortie, il ne concerne que très peu les problèmes de la foi. Ce qui intéresse Kawalerowicz, c’est la nature humaine, la liberté individuelle, les contraintes imposées ou acceptées volontairement. Une interrogation exprimée sous une forme assez virtuose et fascinante. 3. AUSTERIA – Le premier jour de la 1ère Guerre Mondiale, les Juifs d’une petite ville de Galicie, fuyant les Cosaques, passent par l’auberge du vieux Tag, juif lui aussi, esprit libre et frondeur, mais qui ne veut pas fuir une nouvelle fois. Mais dans cette nuit de tous les dangers, les réfugiés d’origines diverses qui arrivent successivement ont de plus en plus de mal à cohabiter entre eux… et avec le corps sans vie d’une jeune femme victime d’une balle perdue.
Parmi les autres films polonais, je veux encore rappeler LE DÉPART et FAUX SEMBLANT de Skolimowski.
Lire la suite »