Autres titres : Echec au Roi (1945) de Jean-Paul Paulin, où Gabrielle Dorziat joue Mme de Maintenon et Maurice Escande Louis XIV (!), Napoléon à Sainte-Helène (1929) de Lupu Pick, que Langlois programmait cinq fois par an. Et surtout le sublime Marie Légende Hongroise (1932) de Paul Fejos, qui je l’espère sortira bientôt en DVD.
 |
 |
 |
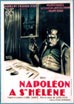 |
En DVD, on peut se procurer L’Espoir (1939) de Malraux, Mais où est donc Ornicar (1979) de Bertrand Van Effenterre, Farrebique (1946) et Biquefarre (1983) de Georges Rouquier ainsi que Lourdes et ses Miracles documentaire de 1955 en trois parties.
 |
 |
 |
 L’Esclave Blanc (1936) de Jean-Paul Paulin adapte un scénario de Dreyer que l’on découvre, illustré et « joué » dans les bonus. Lors du prologue Henri de Monfreid vante l’authenticité du film, tourné en Somalie Italienne en 1934. Mais lorsque après 20 minutes, Jeannette Ferney se met à roucouler une ritournelle près d’un lac où se baigne l’homme qu’elle convoite, le réalisme prend un coup plutôt rude… En dehors d’une ou deux séquences bien filmées (un repas entre les protagonistes, et de quelques beaux plans de panique dans un village attaqué par les nomades), le traitement paraît conventionnel et terne, le dialogue parfois ridicule, le jeu guindé. Le meilleur vient de quelques scènes intimes avec la jeune indigène qui évolue avec un grand naturel. On la voit nue, ce qui est impensable dans les films Hollywoodiens de l’époque traitant de ce genre de sujet. Ce que l’on entend et voit du scénario de Dreyer nous révèle un ton plus âpre, plus noir avec des personnages d’Italiens ; mais dans la deuxième partie, le dialogue semble identique et le regard porté sur le contexte racial tout aussi discutable.
L’Esclave Blanc (1936) de Jean-Paul Paulin adapte un scénario de Dreyer que l’on découvre, illustré et « joué » dans les bonus. Lors du prologue Henri de Monfreid vante l’authenticité du film, tourné en Somalie Italienne en 1934. Mais lorsque après 20 minutes, Jeannette Ferney se met à roucouler une ritournelle près d’un lac où se baigne l’homme qu’elle convoite, le réalisme prend un coup plutôt rude… En dehors d’une ou deux séquences bien filmées (un repas entre les protagonistes, et de quelques beaux plans de panique dans un village attaqué par les nomades), le traitement paraît conventionnel et terne, le dialogue parfois ridicule, le jeu guindé. Le meilleur vient de quelques scènes intimes avec la jeune indigène qui évolue avec un grand naturel. On la voit nue, ce qui est impensable dans les films Hollywoodiens de l’époque traitant de ce genre de sujet. Ce que l’on entend et voit du scénario de Dreyer nous révèle un ton plus âpre, plus noir avec des personnages d’Italiens ; mais dans la deuxième partie, le dialogue semble identique et le regard porté sur le contexte racial tout aussi discutable.
 Les Otages (1939) figure parmi les réussites de Raymond Bernard. C’était même l’un de ses films préférés. Le scénario, co-écrit par Victor Trivas (auteur du pacifiste No Man’s Land) et Jean Anouilh, porte la marque de ce dernier jusque dans l’histoire des deux jeunes amoureux, prisonniers de la rivalité entre leurs familles, celle du maire (Charpin) et du hobereau (Saturnin Fabre). On est en août 1914. Le ton évoque d’abord Pagnol puis devient, après l’assassinat d’un militaire allemand, plus dramatique, plus grinçant. Le village doit fournir 5 otages s’il ne veut pas être rasé. Vont alors ressurgir toutes les mesquineries, les lâchetés et aussi les petits actes d’héroïsme. Charpin est splendide et Saturnin Fabre éblouissant. Il faut le voir demander, parlant des exigences allemandes « Est ce qu’ils vont soulever les lames de parquets ? » – « Pourquoi » – « Pour rien… Cela m’intéresse ». Il donne à ces quelques mots une portée vertigineuse tout comme au « Ne m’appelle pas Kiki dans un moment pareil ».
Les Otages (1939) figure parmi les réussites de Raymond Bernard. C’était même l’un de ses films préférés. Le scénario, co-écrit par Victor Trivas (auteur du pacifiste No Man’s Land) et Jean Anouilh, porte la marque de ce dernier jusque dans l’histoire des deux jeunes amoureux, prisonniers de la rivalité entre leurs familles, celle du maire (Charpin) et du hobereau (Saturnin Fabre). On est en août 1914. Le ton évoque d’abord Pagnol puis devient, après l’assassinat d’un militaire allemand, plus dramatique, plus grinçant. Le village doit fournir 5 otages s’il ne veut pas être rasé. Vont alors ressurgir toutes les mesquineries, les lâchetés et aussi les petits actes d’héroïsme. Charpin est splendide et Saturnin Fabre éblouissant. Il faut le voir demander, parlant des exigences allemandes « Est ce qu’ils vont soulever les lames de parquets ? » – « Pourquoi » – « Pour rien… Cela m’intéresse ». Il donne à ces quelques mots une portée vertigineuse tout comme au « Ne m’appelle pas Kiki dans un moment pareil ».
 Dans la première séquence de La Table aux Crevés (1952) d’Henri Verneuil d’après Marcel Aymé, Fernandel trouve sa femme pendue et se borne à constater : « Je ne savais pas que la poutre était aussi solide ».
Dans la première séquence de La Table aux Crevés (1952) d’Henri Verneuil d’après Marcel Aymé, Fernandel trouve sa femme pendue et se borne à constater : « Je ne savais pas que la poutre était aussi solide ».
On peut aussi trouver, en DVD, plusieurs films d’Henri Calef et enfin commencer à se faire une idée sur ce metteur en scène français peu étudié, oublié. Il connut pourtant un moment de célébrité avec Jéricho (1946) que Jacques Lourcelles salue comme l’un des rares exemples de film épique français, ajoutant « Calef a le sens du portrait individuel autant que celui de l’action collective ».
 Qualités que l’on trouve de manière différente dans les quatre films que j’ai vus : La Maison sous la Mer, tourné en 1946 est un intéressant, mélange de chronique prolétarienne antérieure au Point du Jour, ce documentaire formaliste (photo de Claude Renoir) sur les mines sous marine de Diélette et de l’éternelle intrigue sentimentale tournant autour du ménage à trois. Il y a de très beaux plans (le début entièrement muet), des recherches stylistiques (abondance de plafonds) et de moments un peu éculés, accentués par la présence de Clément Duhour. Les maquettes de Wilcke sont impressionnantes (la mine avait fermé au moment du tournage), mais les transparences laissent à désirer de même que les deux ou trois moments d’action (la chute du chien, la fin). Dialogues talentueux de Georges Neveu (« elle se promène, elle a peut-être un cousin ; c’est gentil les cousins, c’est comme les moustiques, cela fait de la musique la nuit »)… Il y a des bonus nous montrant un Calef très chaleureux, très sympathique et – summum du bonus de DVD – une pittoresque conversation téléphonique avec Viviane Romance, laquelle est magnifique dans le film. Saluons aussi le premier rôle d’Anouk Aimée qui a 14 ans, créditée Anouk au générique. Elle me confirma que c’est Calef qui la repéra dans la rue.
Qualités que l’on trouve de manière différente dans les quatre films que j’ai vus : La Maison sous la Mer, tourné en 1946 est un intéressant, mélange de chronique prolétarienne antérieure au Point du Jour, ce documentaire formaliste (photo de Claude Renoir) sur les mines sous marine de Diélette et de l’éternelle intrigue sentimentale tournant autour du ménage à trois. Il y a de très beaux plans (le début entièrement muet), des recherches stylistiques (abondance de plafonds) et de moments un peu éculés, accentués par la présence de Clément Duhour. Les maquettes de Wilcke sont impressionnantes (la mine avait fermé au moment du tournage), mais les transparences laissent à désirer de même que les deux ou trois moments d’action (la chute du chien, la fin). Dialogues talentueux de Georges Neveu (« elle se promène, elle a peut-être un cousin ; c’est gentil les cousins, c’est comme les moustiques, cela fait de la musique la nuit »)… Il y a des bonus nous montrant un Calef très chaleureux, très sympathique et – summum du bonus de DVD – une pittoresque conversation téléphonique avec Viviane Romance, laquelle est magnifique dans le film. Saluons aussi le premier rôle d’Anouk Aimée qui a 14 ans, créditée Anouk au générique. Elle me confirma que c’est Calef qui la repéra dans la rue.
Plus réussi encore est L’Heure de la Vérité (1965). Le scénario est d’Edgar Morin et l’adaptation de Morin, Maurice Clavel et Calef qui signe aussi le montage. Cela explique parfois le ton un peu emphatique, rhétorique, mais le sujet est tellement fort et original que ces défauts ajoutent à l’originalité d’un propos peu abordé dans le cinéma français de l’époque, plus tourné vers l’autobiographie que vers le monde. Calef et Morin nous racontent l’histoire d’un nazi qui, après s’être fait tatouer un numéro de déporté sur le bras, est devenu citoyen israélien et va être rattrapé par son passé qu’on lui demande d’évoquer en tant que victime, d’un autre point de vue… La mise en scène témoigne d’une réelle invention (au début notamment) avec de belles trouvailles de découpage (le recadrage sur Corinne Marchand dans la jeep), de plan (la sortie de la classe de Corinne Marchand qui court vers Karl Heinz Boehm, filmée à travers la fenêtre sur les enfants et en reflet). Même le formalisme des cadrages qui paraît bloquer certains acteurs renforce le côté personnel, insolite, non naturaliste du film…
Les extérieurs israéliens donnent une vraie force au propos (malgré une bande son maigrelette et une post-synchronisation typique année 60). Bonne musique d’Henri Sauguet.
 La première demi-heure de Les Eaux Troubles (1949 – d’après une nouvelle de Roger Vercel) confirme le talent de Calef : le choix des extérieurs, le refus du dialogue, la direction d’une Ginette Leclerc tout en retenue imposent un ton original. Avec une belle photo de Claude Renoir (le film selon Calef est entièrement tourné en décors réels, près du Mont Saint-Michel). Delmont joue un marin breton dont le fils est Mouloudji. Le propos se dilue et devient pâteux, défaut de certains films français ambitieux de cette époque. Et les moments d’action (l’arrivée de la marée qui risque d’engloutir les personnages) sont toujours aussi maladroitement filmés.
La première demi-heure de Les Eaux Troubles (1949 – d’après une nouvelle de Roger Vercel) confirme le talent de Calef : le choix des extérieurs, le refus du dialogue, la direction d’une Ginette Leclerc tout en retenue imposent un ton original. Avec une belle photo de Claude Renoir (le film selon Calef est entièrement tourné en décors réels, près du Mont Saint-Michel). Delmont joue un marin breton dont le fils est Mouloudji. Le propos se dilue et devient pâteux, défaut de certains films français ambitieux de cette époque. Et les moments d’action (l’arrivée de la marée qui risque d’engloutir les personnages) sont toujours aussi maladroitement filmés.
Les Violents (1957) est une histoire policière avec de beaux plans (le début une fois de plus) dilués dans une intrigue aussi nébuleuse voire incompréhensible que peu intéressante. Certains coups de théâtre sont évoqués hors champ – problèmes de budget -, dans des titres de journaux, des annonces radiophoniques et le retournement final trahit une rouerie qui laisse rêveur. Françoise Fabian, très belle en danseuse nue, domine la distribution.
 |
Quelques films majeurs viennent de sortir : L’Epouvantail (1973) de Jerry Schatzberg qui n’a pas pris une ride et reste toujours aussi bouleversant, All Fall Down (1962 – L’Ange de la Violence), chronique familiale de John Frankenheimer, très bien écrite par William Inge (La Fièvre dans le Sang d’Elia Kazan) et filmée avec une grande sensibilité. Comme toujours chez Frankenheimer, l’interprétation est formidable, de Warren Beatty à Eva Marie Saint, d’Angela Lansbury à Brandon de Wilde. Ce film qui fut très sous estimé lors de sa présentation à Cannes est à redécouvrir et il annonce les magnifiques chroniques provinciales que sont The Gypsy Moths (1969) et I Walk the Line (1970), tous deux disponibles en zone 1.
 |
 |
 Le Fleuve Sauvage (1960), d’Elia Kazan est une œuvre bouleversante qui nous fait toucher du doigt, nous permet de comprendre de manière concrète, intime, profonde tout ce qui sépare l’Amérique de Bush de celle de Kerry. C’est dire la force, la modernité de cette histoire qui se passe à l’époque de Roosevelt, pendant le New Deal. Le scénario qui s’inspire notamment d’un livre de William Bradford Huie (auteur dont on devrait lire les livres) évoque l’affrontement entre ces deux Amériques : celle qui privilégie l’état, l’individualisme, les préjugés raciaux, la tradition, la bigoterie, l’attachement – parfois héroïque comme c’est le cas ici – à certaines valeurs contre celle qui met en avant l’Etat Fédéral, le progrès, l’éducation, le Service Public.
Le Fleuve Sauvage (1960), d’Elia Kazan est une œuvre bouleversante qui nous fait toucher du doigt, nous permet de comprendre de manière concrète, intime, profonde tout ce qui sépare l’Amérique de Bush de celle de Kerry. C’est dire la force, la modernité de cette histoire qui se passe à l’époque de Roosevelt, pendant le New Deal. Le scénario qui s’inspire notamment d’un livre de William Bradford Huie (auteur dont on devrait lire les livres) évoque l’affrontement entre ces deux Amériques : celle qui privilégie l’état, l’individualisme, les préjugés raciaux, la tradition, la bigoterie, l’attachement – parfois héroïque comme c’est le cas ici – à certaines valeurs contre celle qui met en avant l’Etat Fédéral, le progrès, l’éducation, le Service Public.
Ce sujet inspire à Kazan ses plus belles scènes d’amour, entre Montgomery Clift et Lee Remick, tous deux admirables, miracle de lyrisme, d’émotion fiévreuse où abondent faux pas, hésitations, trébuchements, moments de culpabilité et d’abandon.
Autre œuvre essentielle et très méconnue, Promenade avec l’Amour et la Mort (1969) de John Huston. Jacques Le Goff le considère comme l’un des plus beaux films sur le Moyen Âge, l’un des plus justes aussi. Cette histoire d’amour lyrique, passionnée entre un jeune étudiant qui quitte Paris en plein hiver (« l’encre gelait encore dans les encriers ») et la très jeune fille d’un seigneur dans une France ravagée par la guerre, la misère, les épidémies, donne lieu à une évocation âpre, qui paraît extrêmement réaliste, de la Guerre de Cent Ans. On assiste à des quantités d’affrontements. Tout le monde se bat contre tout le monde sauf les anglais et les français : soldats contre les gens du peuple, mercenaires contre les pillards et les villageois, seigneurs contre les paysans sans oublier tous les clans religieux qui s’étripent et s’excommunient…Le ton fait penser à Bunuel (on sait que Huston admirait passionnément Nazarin). Certains moments sont des sommets de l’œuvre de Huston : Assaf Dayan découvrant que la personne qu’il a tuée est un très jeune garçon et marchant en titubant, hébété, dans la rivière ; Anjelica Huston envahie par une peur panique qui balaie sa fausse assurance et qu’elle avoue brusquement en se serrant contre le jeune homme.
Opening vient également de sortir Les Gens de Dublin (1987 – The Dead), miraculeuse adaptation de Joyce, tournée dans un hangar californien par un Huston sous perfusion, sur une chaise roulante et qui pourtant maîtrise totalement son film d’une incroyable liberté de ton, et Mamma Roma (1962) de Pasolini. Tandis que les Editions Montparnasse sortent en même temps Le Pont des Arts (2004) et Le Monde Vivant (2003) pour moi le film le plus intéressant de Eugène Green.
 |
 |
 |
 |
Dans le livre remarquable, passionnant, riche en découvertes et en surprises (Editions Léo Scheer) que Tag Gallagher a consacré à Roberto Rosselini (Les aventures de Roberto Rossellini), on découvre que La Prise du Pouvoir par Louis XIV (1966 – Mk2) est le seul film que ce fondateur du néo-réalisme tourna en son direct. A son habitude, il abandonna certaines séquences qui furent dirigées par ses assistants ou des membres de sa famille. Ce sont les plus statiques, les plus conventionnelles (les scènes de chasse), ce qui conforte la politique des auteurs. Il dirigea de très près la plus belle scène du film, la mort de Mazarin, moment très fort, bouscula le scénario pour réussir cette formidable partie de cartes, digne du Renoir de la Marseillaise (1938). Je continue à regretter la singulière bévue qui a amené l’auteur de Paisa (1946) à choisir Katarina Renn qui a un fort accent allemand pour jouer Anne d’Autriche dont tous les lecteurs de Dumas savaient qu’on la surnommait l’Espagnole. C’est regrettable quand on veut mettre en avant le pouvoir didactique du cinéma.
 |
 |
En Angleterre le BFI vient de restaurer Sons and Lovers (1960) de Jack Cardiff d’après D.H. Lawrence que je n’ai pas eu le temps de voir mais qui a une excellente réputation, et Brighton Rock (1947) l’un des meilleurs films des frères Boulting. Le scénario, d’après le roman de Graham Greene, est signé Greene et Terence Rattigan dont on a pu voir une pièce mise en scène par Didier Bezace, La Version de Browning.
C’est Roy Boulting qui signe Thunder Rock (1943) d’après la pièce de Robert Ardrey où l’on voit Michael Redgrave se cloîtrer dans un phare, dégoûté par la mollesse de ses concitoyens qui n’ont pas réagi à ses cris d’alerte sur la montée du fascisme. Dans ce phare, il se confrontera à des fantômes : des hommes et des femmes qui ont péri dans un naufrage plus de deux siècles auparavant. Cette œuvre statique, féministe et très engagée serait, selon son auteur, la première où l’on passe du présent au passé dans le même plan.
La plupart des DVD anglais n’ont pas de sous-titres même pour sourds et malentendants mais Sons and Lovers nous offre une interview de Jack Cardiff.
 |
 |
 Autre adaptation de Graham Greene que je vais enfin voir, The Heart of the Matter (1953 – Le Fond du Problème) du mystérieux George More O’Ferrall.
Autre adaptation de Graham Greene que je vais enfin voir, The Heart of the Matter (1953 – Le Fond du Problème) du mystérieux George More O’Ferrall.
Rayons série B, une compagnie sans doute hollandaise (pirate ?) vient de distribuer Machine-Gun Kelly (1958), l’un des meilleurs Roger Corman avec Charles Bronson, et The Bonnie Parker Story (1958) de William Witney (le metteur en scène favori de Quentin Tarantino), très intéressante version de l’histoire de Bonnie (sans Clyde) très bien jouée par Dorothy Provine qui insiste sur les origines prolétariennes du personnage, la manière dont elle domine les hommes qui l’entourent. Le ton est sec, dépourvu de lyrisme, d’une grande rapidité avec un premier plan très réussi. Bonne musique de Ronald Stein. Malheureusement le format n’est pas respecté et les acteurs sont souvent décadrés. On a le droit en bonus à une interview audio de Sam Arkoff, l’un des dirigeants de American International qui énumère les recettes des films.
 L’événement de ces derniers mois est la sortie en version restaurée de The Savage Innocents (1960 – Les Dents du Diable avec sous-titres anglais pour sourds et malentendants) de Nicholas Ray écrit par le cinéaste d’après une adaptation de Franco Solinas et Hans Ruesch du livre de ce dernier. La photographie est d’Aldo Tonti avec de nombreux plans de seconde équipe et des raccords épineux en studio. On se moqua de la distribution cosmopolite qui regroupait plusieurs nationalités : Anna May Wong y côtoyait Yoko Tani. Mais Anthony Quinn m’a paru très bon et Peter O’Toole fait des débuts fracassants.
L’événement de ces derniers mois est la sortie en version restaurée de The Savage Innocents (1960 – Les Dents du Diable avec sous-titres anglais pour sourds et malentendants) de Nicholas Ray écrit par le cinéaste d’après une adaptation de Franco Solinas et Hans Ruesch du livre de ce dernier. La photographie est d’Aldo Tonti avec de nombreux plans de seconde équipe et des raccords épineux en studio. On se moqua de la distribution cosmopolite qui regroupait plusieurs nationalités : Anna May Wong y côtoyait Yoko Tani. Mais Anthony Quinn m’a paru très bon et Peter O’Toole fait des débuts fracassants.
 Signalons la version anglaise de Mon Oncle (1958) de Tati, assez étonnante, ne serait-ce que dans son principe d’aller au bout de la logique. Tati fait des prises alternatives français-anglais, adaptant chaque fois le décor (le panneau « école » devient « school »), plaçant un livre en anglais dans les mains du petit garçon, parfois des choses très apparentes, d’autres beaucoup moins. Il adapte surtout certains gags. Par exemple tout ce qui concerne la satire de l’hygiène au foyer est plutôt occulté dans la version française que nous connaissions. Dans la version anglaise, la mère passe de longs moments dans sa cuisine à nettoyer les verres avec des machines extravagantes qui font des bruits singuliers, ce que nous n’avions pas vu.
Signalons la version anglaise de Mon Oncle (1958) de Tati, assez étonnante, ne serait-ce que dans son principe d’aller au bout de la logique. Tati fait des prises alternatives français-anglais, adaptant chaque fois le décor (le panneau « école » devient « school »), plaçant un livre en anglais dans les mains du petit garçon, parfois des choses très apparentes, d’autres beaucoup moins. Il adapte surtout certains gags. Par exemple tout ce qui concerne la satire de l’hygiène au foyer est plutôt occulté dans la version française que nous connaissions. Dans la version anglaise, la mère passe de longs moments dans sa cuisine à nettoyer les verres avec des machines extravagantes qui font des bruits singuliers, ce que nous n’avions pas vu.






 Crossfire
Crossfire Deux autres films très intéressants de
Deux autres films très intéressants de 




 Dans les beaux coffrets consacrés à
Dans les beaux coffrets consacrés à 














 En revanche, je reste toujours réticent devant
En revanche, je reste toujours réticent devant 





 Tous les spectateurs qui ont adoré, à juste titre,
Tous les spectateurs qui ont adoré, à juste titre, 


 Dans un autre registre, je voudrais souligner les qualités des
Dans un autre registre, je voudrais souligner les qualités des 
 Chez Kino (
Chez Kino (

 Autre nouveauté chez Kino :
Autre nouveauté chez Kino : 



 Dans la catégorie curiosité, on peut voir avec plaisir
Dans la catégorie curiosité, on peut voir avec plaisir 





 On peut se procurer via Internet (
On peut se procurer via Internet ( I Walk the Line
I Walk the Line
 Criterion (
Criterion (