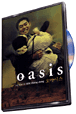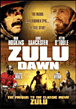|
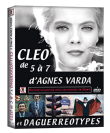 Je regrettais la dernière fois que la seule version de Cléo de 5 à 7 (1961) soit celle de Criterion. Voilà qui est réparé. Cléo vient de sortir en zone 2, dans un coffret somptueux, une belle copie restaurée avec des suppléments remarquables comme le magnifique Daguerréotypes (1978), le plan des trajets de Cléo et de superbes dessins de Sempé. Revoir ce film m’a beaucoup ému. Il n’a pas pris une ride. Le regard que pose Agnès Varda sur son héroïne, sur tous les personnages qu’elle côtoie ou rencontre, est fraternel, chaleureux, amusé, tendrement ironique, pudique. Roger Tailleur dans un article très élogieux saluait le plus beau film français depuis Hiroshima mon Amour (1959) de Resnais et Le Trou (1960) de Becker et soulignait les « recherches narratives, le carcan temporel, les préoccupations vitales, l’élégance de ton et plastique, et, deux par deux, l’humour et l’angoisse, la gravité et la poésie ».
Je regrettais la dernière fois que la seule version de Cléo de 5 à 7 (1961) soit celle de Criterion. Voilà qui est réparé. Cléo vient de sortir en zone 2, dans un coffret somptueux, une belle copie restaurée avec des suppléments remarquables comme le magnifique Daguerréotypes (1978), le plan des trajets de Cléo et de superbes dessins de Sempé. Revoir ce film m’a beaucoup ému. Il n’a pas pris une ride. Le regard que pose Agnès Varda sur son héroïne, sur tous les personnages qu’elle côtoie ou rencontre, est fraternel, chaleureux, amusé, tendrement ironique, pudique. Roger Tailleur dans un article très élogieux saluait le plus beau film français depuis Hiroshima mon Amour (1959) de Resnais et Le Trou (1960) de Becker et soulignait les « recherches narratives, le carcan temporel, les préoccupations vitales, l’élégance de ton et plastique, et, deux par deux, l’humour et l’angoisse, la gravité et la poésie ».
Tout de suite un regret. Comment se fait-il qu’Adieu Philippine (1962 – dont j’avais été l’attaché de presse comme pour Cléo) de Jacques Rozier, autre titre majeur de cette époque, soit introuvable en dvd et quand on tape Jacques Rozier, on ne nous renvoie qu’à 56 rue Pigalle (1949) film de Willy Rozier, très prisé par notre président Francis Girod, mais que je ne connais pas.
Autre admirable coffret, La Maison des Bois (1971), pour moi le film le plus bouleversant, le plus accompli de Maurice Pialat. Pierre Doris y trouvait le rôle de sa vie et Pialat lui-même était magnifique en instituteur. S’inspirant d’un sujet de René Wheeler qu’il s’appropria au point de lui conférer un vrai côté autobiographique, Pialat nous remue autant que dans L’Enfance Nue (1968) ou A nos Amours (1983), et confère à cette sublime chronique une sérénité jusque dans la douleur. Chacun des épisodes est présenté par la monteuse Martine Giordano. Question bonus justement, il est très intéressant de comparer ceux des versions américaines et françaises de Quai des Orfèvres (1947), le chef d’œuvre de Clouzot. Tous les deux partent de la même source : des entretiens filmés de Panigel avec le metteur en scène, Simone Renant, Bernard Blier, Suzy Delair. Dans les deux bonus, le montage est différent, l’ordre des questions n’est pas le même. Dans la version StudioCanal on supprime une partie des questions de Panigel et quelques échanges. On perd un peu le côté idées très arrêtées qu’avait Panigel, sa vision univoque du film, son obstination à faire dire à Clouzot qu’il méprise ses personnages, les considère comme des larves. Le cinéaste se défend avec calme, fait remarquer que le regard qu’il porte sur Pierre Larquey est chaleureux, qu’il aime le personnage de Jouvet, celui de Simone Renant et de Delair. À Panigel, qui peint le rôle de Blier de manière très péjorative, il rétorque doucement « c’est un faible ».
 |
 |
En tapant Claude Miller sur amazon.fr, on découvre avec plaisir que l’excellent La Meilleure Façon de Marcher (1976) va sortir prochainement (j’ai gardé un souvenir très fort de ce film et de tous les acteurs de Dewaere à Christine Pascal en passant par Michel Blanc dans son premier rôle dramatique et Piéplu avec sa boite à idées), ce qui s’ajoutera à Dites-lui que je l’aime (1977), Garde à Vue (1981 – ce dernier contient juste comme bonus un reportage médiocre, au son défectueux, sur le tournage, avec des interviews navrantes des acteurs). Le dialogue de Michel Audiard n’a rien perdu de son mordant, de son intelligence, de son invention (« certains couples sont séparés par la maladie, le divorce. Nous c’était un couloir, un couloir de 15 mètres. Un désert ». Je cite de mémoire). La mise en scène de Miller brillante et fluide sait créer une tension qui ne se relâche pas. Après ces titres, après La Petite Lili (2003), on obtient brusquement Lawrence d’Arabie !!! « Ici rien n’est suspect, tout est étrange », disait Carette dans Sylvie et le Fantôme (1946) d’Autant-Lara.
 |
 |
 J’ai revu récemment cette réussite exemplaire qu’est la 317ème Section (1965) Pierre Schoendoerffer, autre titre majeur des années 60, que l’on trouve chez tous les soldeurs, dans un beau transfert qui rend justice à la magnifique photographie de Raoul Coutard. Jacques Perrin et Bruno Cremer sont inoubliables et la sobriété dépouillée du ton, sa sécheresse prennent encore plus de force aujourd’hui. Malheureusement, il n’y a aucune interview de Pierre Schoendoerffer et dieu sait s’il a des choses à raconter sur ce film. Juste la bande-annonce dont je suis l’auteur. C’était mon premier travail cinématographique. Le commentaire est dit par mon monteur Armand Psenny.
J’ai revu récemment cette réussite exemplaire qu’est la 317ème Section (1965) Pierre Schoendoerffer, autre titre majeur des années 60, que l’on trouve chez tous les soldeurs, dans un beau transfert qui rend justice à la magnifique photographie de Raoul Coutard. Jacques Perrin et Bruno Cremer sont inoubliables et la sobriété dépouillée du ton, sa sécheresse prennent encore plus de force aujourd’hui. Malheureusement, il n’y a aucune interview de Pierre Schoendoerffer et dieu sait s’il a des choses à raconter sur ce film. Juste la bande-annonce dont je suis l’auteur. C’était mon premier travail cinématographique. Le commentaire est dit par mon monteur Armand Psenny.
Sur une autre guerre, il FAUT voir La Question (1977) de Laurent Heynemann d’après le témoignage de Henri Alleg. Notamment au moment où l’on parle des tortures américaines et anglaises en Irak. Jacques Denis y était sensationnel dans ce film très bien joué (Nicole Garcia, Jean-Pierre Sentier, Jean Benguigui, Michel Beaune…) et qui met à mal le cliché selon lequel les cinéastes français n’ont pas abordé la guerre d’Algérie. Cléo le faisait, tout comme Adieu Philippine et Muriel (1972) d’Alain Resnais, et Avoir 20 Ans dans les Aurès (1972) de René Vautier. Le vrai problème est que certains de ces films ont été peu diffusés, ou rarement sinon jamais repris par les chaînes de télé, notamment publiques. Avez-vous vu La Question sur la 2 ou la 3 ? A ma connaissance, le film d’Autant-Lara, Tu ne Tueras Point (1961) consacré à l’objection de conscience et contemporain de la guerre d’Algérie reste toujours inédit (et introuvable en dvd tout comme R.A.S. – 1973, l’un des meilleurs films d’Yves Boisset avec Allons Z’enfants – 1981).
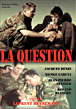 |
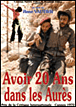 |
 |
 Le premier et remarquable film de Jean-Jacques Annaud, La Victoire en Chantant (1976), écrit par Georges Conchon, qui se déroulait en Afrique durant la première guerre mondiale, avait été consacré par les Américains et sous-estimé ici. Je n’ai jamais oublié le moment où le génial Jean Carmet à qui Jacques Spiesser demandait s’il avait un plan, déclarait fièrement : « Bien sûr que j’ai un plan…Oui, j’ai un plan…Ben oui, j’ai un plan » pour finalement admettre piteusement : « j’ai pas de plan ».
Le premier et remarquable film de Jean-Jacques Annaud, La Victoire en Chantant (1976), écrit par Georges Conchon, qui se déroulait en Afrique durant la première guerre mondiale, avait été consacré par les Américains et sous-estimé ici. Je n’ai jamais oublié le moment où le génial Jean Carmet à qui Jacques Spiesser demandait s’il avait un plan, déclarait fièrement : « Bien sûr que j’ai un plan…Oui, j’ai un plan…Ben oui, j’ai un plan » pour finalement admettre piteusement : « j’ai pas de plan ».
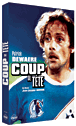 Tout aussi jubilatoire est Coup de Tête (1979) sur les magouilles du monde du football, très bien écrit par Francis Veber, avec une verve satirique qui aurait plu à Jeanson. Le sujet, prémonitoire, prend encore plus de force à l’heure actuelle, tout comme cette scène d’interrogatoire dans un commissariat où Gérard Hernandez cherche sa chevalière qu’il a perdue en frappant Patrick Dewaere. « Elle a dû glisser sous un classeur » lui susurre l’un de ses subordonnées.
Tout aussi jubilatoire est Coup de Tête (1979) sur les magouilles du monde du football, très bien écrit par Francis Veber, avec une verve satirique qui aurait plu à Jeanson. Le sujet, prémonitoire, prend encore plus de force à l’heure actuelle, tout comme cette scène d’interrogatoire dans un commissariat où Gérard Hernandez cherche sa chevalière qu’il a perdue en frappant Patrick Dewaere. « Elle a dû glisser sous un classeur » lui susurre l’un de ses subordonnées.
Parmi les autres répliques mémorables, j’adore : « C’est pas mon truc…Le viol, c’est pas mon truc » de Dewaere et de nombreuses interventions fulgurantes de Jean Bouise qui les distille dans le plus pur style Jouvet : « Je fais jouer 11 imbéciles pour en calmer 800 ».
Le commentaire audio de Jean-Jacques Annaud rend justice à tous ses collaborateurs et notamment à Francis Veber. A saluer le concept graphique du DVD. A revoir d’urgence.
En zone anglaise (chez http://www.amazon.co.uk/) 10 Rillington Place (1971 – L’Etrangleur de la Place Rillington), l’un des chefs-d’œuvre de Richard Fleischer vient enfin de sortir en dvd, sans sous-titres français (juste avec sous-titres anglais pour sourds et malentendants). Cette autopsie d’un fait divers authentique permet à Richard Attenborough de fignoler une composition hallucinante dans le rôle de John Reginald Christie. Citons Jacques Lourcelles : « Aucun film, peut-être, n’a été capable depuis les débuts du cinéma de mettre les spectateurs dans un tel état d’accablement. Quinze années de violences et d’horreurs cinématographiques n’ont pas atténué l’éclat insoutenable de ce film, au demeurant très sobre visuellement… Ici, à juste titre, on peut parler de « voyage au bout de la nuit »… Comme tous les grands cinéastes, Fleischer a d’abord le génie du lieu. Une description hyper réaliste (au sens pictural du terme, de cette ruelle londonienne, mêlant studio et extérieurs, tournés sur place) va cerner l’espace où agit le tueur… Génial dans son interprétation, dans sa recréation d’une atmosphère, le film appréhende l’espace (le gouffre), qui sépare notre monde de la civilisation. Il laisse sans garde fou le spectateur devant son propre vertige ». (Dictionnaire du Cinéma)
 |
En Zone 1, citons deux ressorties majeures de deux des chefs-d’œuvre du western : 7 Men from Now (1956 – 7 Hommes à Abattre) de Budd Boetticher et Ride the High Country (1962 – Coup de Feu dans la Sierra) de Sam Peckinpah. Revoir le premier, qui avait disparu depuis au moins 30 ans, a été un immense plaisir. Son ton, son style incroyablement ramassé, compact, dense, la rapidité elliptique, fulgurante des dialogues de Burt Kennedy, lui permettent, en moins de 80 minutes, d’accumuler les péripéties, de donner vie à au moins quatre personnages, extrêmement bien dessinés, de suggérer pour chacun d’entre eux un passé, des rapports relativement complexes. La séquence à l’intérieur du chariot durant laquelle Lee Marvin fait du charme à Gail Russell devant son mari et sous l’œil de Randolph Scott est exemplaire. Boetticher déclare d’ailleurs dans l’un des excellents bonus qui accompagnent le film (témoignages de Tarantino et, plus terne, d’Eastwood, interview de Boetticher, documentaire sur Burt Kennedy où l’on découvre qu’il fut un vrai héros de la dernière guerre) que c’est la scène dont il est le plus fier.
 |
 |
7 Men lança Lee Marvin qui est inoubliable dans le film. Le voir s’entraîner à dégainer dans un saloon désert (moment ajouté par Boetticher) est jubilatoire tout comme sa mort, son air surpris, incrédule avant de tomber foudroyé. Mais lors de cette nouvelle vision, j’ai été extrêmement touché par Gail Russel. C’est John Wayne, le producteur du film, qui fit appel à elle en souvenir de Angel and The Badman (1947) de James Edward Grant (une bonne version va bientôt sortir) et du Réveil de la Sorcière Rouge (1948 – Wake of the Red Witch) de Edward Ludwig, l’un de mes films favoris. Son visage marqué (l’alcoolisme l’avait écartée des plateaux depuis au moins 5 ans et elle mourra quelque temps plus tard à l’âge de 36 ans) donne à sa beauté, à ses yeux verts une fragilité, une fêlure bouleversante. Boetticher déclare qu’elle reste la meilleure actrice parmi celles qui jouèrent dans ses westerns.
La copie est somptueuse (meilleure dit-on que la 35 mm). Les couleurs possèdent un éclat qui avait disparu de tout ce que l’on pouvait voir depuis 35 ans, qui rend justice à la photo de William Clothier. Mais pour quelles raisons Robert Gist a-t-il choisi un format panoramique au lieu du 1/33 ? J’aimerais connaître les raisons de ce choix. C’est pour lui que fut écrit Ride the High Country ; mais retenu au Mexique par le tournage de son documentaire sur Carlos Arruza, il refusa et Sam Peckinah hérita du projet. 44 ans après, Ride reste toujours éblouissant, un mélange inspiré du respect de la tradition (le film tourne autour des thèmes archétypaux du double itinéraire et de l’apprentissage) et de modernité : la course du début, gagnée par un chameau, la description du camp de mineurs, de la famille de James Drury, ce ramassis de demeurés criminels. Là encore, la copie est magnifique et rend justice à la photographie de Lucien Ballard










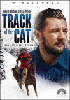

















 Bonne occasion de revoir ce film ainsi que
Bonne occasion de revoir ce film ainsi que  Le DVD permet parfois de réhabiliter des injustices, de revoir des films qui n’ont pas connu le succès qu’ils méritaient. Je pense à
Le DVD permet parfois de réhabiliter des injustices, de revoir des films qui n’ont pas connu le succès qu’ils méritaient. Je pense à 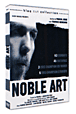



 Autre sortie capitale, la sublime
Autre sortie capitale, la sublime 

 Justement de
Justement de