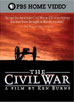Commençons par ce que l’on appelle un repentir : dans ma chronique N° 6 d’Octobre 2006, je mentionnais deux coffrets consacrés à Lucian Pintilie et à Shohei Imamura, mais je ne m’étendais pas assez sur les films. Je n’en disais pas assez la force et l’importance.
Commençons par ce que l’on appelle un repentir : dans ma chronique N° 6 d’Octobre 2006, je mentionnais deux coffrets consacrés à Lucian Pintilie et à Shohei Imamura, mais je ne m’étendais pas assez sur les films. Je n’en disais pas assez la force et l’importance.
Alors répétons le, Trop Tard (1996) et L’Après midi d’un tortionnaire(1998 – qui sont analysés par Michel Ciment – MK2) sont des œuvres magnifiques, mélanges très personnels d’analyse politique et sociale décapante, désenchantée et de comédie farceuse. Deux enquêtes, la première sur des meurtres commis dans une mine, la seconde sur le passé horrifique d’un fonctionnaire attaché au régime de Ceausescu. Devenu apiculteur, il est interrogé dans sa cour, près de l’arbre où il aurait tué son père, par une jeune journaliste qui a des problèmes avec son magnétophone et une de ses victimes qui s’endort périodiquement. Leurs questions sont perturbées par le fils du tortionnaire qui estime que rechercher la vérité, c’est salir la Roumanie et vient perturber la discussion avec ses amis supporters de l’équipe de foot. Comme dans Trop Tard qui frappe aussi par l’originalité de ses scènes d’amour, Pintilie dénonce avec une ironie mordante l’alliance incongrue des anciens bourreaux communistes et des nouveaux nationalistes ultra conservateurs qui s’entendent sur le dos de la vérité
A côté de La vengeance est à moi (1979), la plupart des films d’horreur actuels font figure de bluettes. La description des deux premiers meurtres notamment nous prend de plein fouet. Leur réalisme évite tout voyeurisme, tout sentiment d’exploitation, ce qui décuple son intensité et le rend vraiment dérangeant. Les réactions des personnages secondaires, des témoins qui découvrent le corps sont filmées de manière fulgurante et toujours inattendue. Par la suite, Imamura devient plus elliptique dans la description des meurtres commis par son « héros », personnage terrifiant dans son opacité, mais dont on finit par comprendre certains ressorts, sans jamais l’excuser.
Le DVD reste un monde mystérieux. Après avoir revu au Quartier Latin un de ces films qui vous ont marqué, Le mépris (1963) de Jean-Luc Godard (dont j’avais été l’attaché de presse), l’un de ses grands chefs-d’œuvre, on découvre que la meilleure édition, et de loin, est l’Américaine (Contempt chez Criterion). Idem pour Bande à part (1964 – Band of outsiders, toujours chez Criterion). Seuls les dvddophiles américains peuvent vraiment apprécier la photo de Raoul Coutard et l’interprétation sublime de Bardot, Piccoli et de Fritz Lang impressionnant, « La mort n’est pas une conclusion », dit-il, phrase qu’il faut se répéter après la disparition de Francis Girod, Robert Altman, Philippe Noiret.
 Il faut évidemment aussi citer la magnifique musique de Delerue. À propos de Delerue, signalons le CD qui groupe les musiques de Delerue pour Godard dans l’indispensable et magnifique collection dirigée par Stéphane Lerouge. On trouve également des CD d’Antoine Duhamel, de Philippe Sarde (pour Claude Sautet, Alain Corneau, Granier-Deferre, et moi-même), de Georges Van Parys etc …
Il faut évidemment aussi citer la magnifique musique de Delerue. À propos de Delerue, signalons le CD qui groupe les musiques de Delerue pour Godard dans l’indispensable et magnifique collection dirigée par Stéphane Lerouge. On trouve également des CD d’Antoine Duhamel, de Philippe Sarde (pour Claude Sautet, Alain Corneau, Granier-Deferre, et moi-même), de Georges Van Parys etc …
 Autre coffret important, celui qui regroupe deux des meilleurs films de Jean-Claude Brisseau (dont j’avais bien aimé Choses Secrètes – 2002 et son parfum érotico libertaire). On retrouve Un jeu brutal (1983) et De bruit et de fureur (1988) toutes les obsessions brissaldiennes, la description d’une école (déjà) minée, gangrenée par des problèmes dont on prendra conscience avec deux décennies de retard. Dans les bonus, L’Echangeur (1982) court-métrage bouleversant qui décrit sans moralisme ni commentaire un jeune garçon, un mineur qui parvient à survivre en se livrant à toutes sortes de trafics. Brisseau met à nu avec un regard incroyablement juste une réalité niée à l’époque par les politiques, les édiles, les institutions. Il n’avait que 20 ans d’avance. Ce film justifie à lui seul l’achat du coffret.
Autre coffret important, celui qui regroupe deux des meilleurs films de Jean-Claude Brisseau (dont j’avais bien aimé Choses Secrètes – 2002 et son parfum érotico libertaire). On retrouve Un jeu brutal (1983) et De bruit et de fureur (1988) toutes les obsessions brissaldiennes, la description d’une école (déjà) minée, gangrenée par des problèmes dont on prendra conscience avec deux décennies de retard. Dans les bonus, L’Echangeur (1982) court-métrage bouleversant qui décrit sans moralisme ni commentaire un jeune garçon, un mineur qui parvient à survivre en se livrant à toutes sortes de trafics. Brisseau met à nu avec un regard incroyablement juste une réalité niée à l’époque par les politiques, les édiles, les institutions. Il n’avait que 20 ans d’avance. Ce film justifie à lui seul l’achat du coffret.
J’ai revu avec beaucoup de plaisir L’amour c’est gai, l’amour c’est triste (1971) de Jean-Daniel Pollet, comédie douce amère épatamment écrite par un Remo Forlani aussi en forme que dans sa meilleure pièce, Guerre et paix au café Sneffle. On y retrouve Claude Melki que personne, hélas, ne sut filmer et mettre en valeur comme Pollet. Qui fait une fois encore de son héros, Léon, une sorte d’Harry Langdon. Un ingénu aérien, martyrisé par l’amant de sa sœur, une brute imbécile, un proxénète borné qui aurait aimé « être facteur s’il ne fallait pas monter les étages », rôle en or pour le génial Jean-Pierre Marielle, lequel débite une litanie d’aphorismes stupides, de clichés (« tous les Anglais sont homosexuels. Sauf Winston Churchill »), de jeux de mots débiles : mets la nappe, oh Léon. Léon qui n’a jamais compris le vrai travail de sa sœur, inénarrable Bernadette Laffont, et qui va être touché par une jeune fille, jouée, eh oui, par Chantal Goya, toute aussi maladroitement charmante que dans le Godard.
J’ai aussi revu Betty Fischer et autres histoires (2001) de Claude Miller, un de ses meilleurs films (Edouard Baer et Mathilde Seigner sont particulièrement remarquables dans une distribution épatante) et Demonlover (2002) d’Assayas qui avait été sous estimé à Cannes.
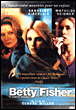 |
 |
MK2 vient de sortir dans la catégorie découverte deux œuvres remarquables : Forty shades of blue (2005) de Ira Sachs qui se déroule à Memphis. Ce portrait doux amer d’une jeune femme russe mariée à un producteur de musique, magnifiquement joué par Rip Torn dont la vie se fissure, est filmé avec beaucoup de délicatesse et de tendresse. Tout comme Be with me (2005), première œuvre d’un cinéaste de Singapour, Eric Khoo. Impossible d’oublier les personnages de ce film, ces jeunes filles qui à force d’utiliser toute les technologies les plus modernes pour se parler, ne se disent plus rien. Contrairement à ces infirmes qui vont réussir à communiquer avec un minimum de mots. Tout ce qui touche à la cuisine comme lien émotionnel est formidable.
 Dans le rayon patrimoine, signalons la sortie chez René Château d’un coffret Eddie Constantine avec deux de ses meilleurs films, Ca va barder (1955) de John Berry, Cet homme est dangereux (1953) de Jean Sacha et une nullité, L’homme et l’enfant (1956) de Raoul André où l’on voit pourtant la future Nadine de Rothschild se faire fesser. Chez Pathé où l’on s’intéresse enfin au patrimoine, sortie des Disparus de Saint-Agil (1938) d’après Pierre Véry, l’un des meilleurs Christian-Jaque. Et, enfin, une édition que l’on dit bonne des Enfants du paradis (1945) de Marcel Carné.
Dans le rayon patrimoine, signalons la sortie chez René Château d’un coffret Eddie Constantine avec deux de ses meilleurs films, Ca va barder (1955) de John Berry, Cet homme est dangereux (1953) de Jean Sacha et une nullité, L’homme et l’enfant (1956) de Raoul André où l’on voit pourtant la future Nadine de Rothschild se faire fesser. Chez Pathé où l’on s’intéresse enfin au patrimoine, sortie des Disparus de Saint-Agil (1938) d’après Pierre Véry, l’un des meilleurs Christian-Jaque. Et, enfin, une édition que l’on dit bonne des Enfants du paradis (1945) de Marcel Carné.
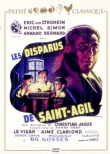 |
 |
J’ai enfin vu Jéricho de Henri Calef qui est un fort bon film, tout à fait fascinant. Il fut distribué en 1945 et tourné à la fin de 44, dans une vraie proximité avec les évènements qui l’inspirèrent (le bombardement, qui est le clou du film, se déroula fin 1943. Dans le film, Spaak et Calef le placent juste avant le débarquement). La plupart des pilotes anglais qui furent engagés dans le film, nous dit Calef dans le livre que lui consacrent Philippe Esnault et Marie Calef, participèrent au raid.
Le film grouille de personnages. Il y en a plus de 40, tous différents. La plupart d’entre eux sont très bien écrits par Charles Spaak et bien joués. Jean Brochard en chef de gare, Pasquali en conseiller municipal pleutre qui pour ne pas devenir un otage, démissionne sous prétexte d’un désaccord sur le stade, Jacques Charon en aristocrate, emprisonné pour avoir chanté la Marseillaise et qui veut tout le temps convaincre ses co-détenus d’entonner des hymnes.
La vision de Jéricho détruit un bon nombre de clichés : voilà un film qui ne montre pas que tous les Français sont des héros ou des résistants. On y voit des attentistes, des lâches, des égoïstes. Pierre Brasseur joue un personnage d’une rare abjection, anti-sémite, peureux, prêt à trahir tout le monde. Il s’agit moins d’un film sur la résistance que d’une étude sur différentes attitudes, prises de position qu’on a pu trouver durant l’occupation. Et aussi sur 50 personnes qui vont mourir. La scène où ils doivent écrire leur dernière lettre en se partageant les trois crayons donnés par les Allemands (souvenir des crayons qu’on donna à Spaak dans sa cellule pour écrire Les caves du Majestic) est tout à fait forte. Rappelons que Calef dut se cacher durant toutes ces années et qu’il refusa de porter l’étoile Jaune.
La photographie de Claude Renoir est spectaculaire, notamment dans les scènes de nuit et la réalisation de Calef inventive, avec de très nombreux mouvements d’appareil. J’aime beaucoup qu’il ait coupé le dialogue de la scène d’amour avec Pellegrin qu’il filme derrière une fenêtre.
 Les films de Calef et la lecture du livre Henri Calef, cinéma sans étoile (Pilote 24 édition) de Philippe Esnault et Marie Calef m’ont donné envie de revoir L’alibi (1937) de Pierre Chenal (chez René Château, copie correcte aucun chapitrage ni bonus), excellent metteur en scène, hélas oublié des DVD. Où sont La maison du Maltais (1938), Le dernier tournant (1939), excellente adaptation du Facteur sonne toujours deux fois, L’homme de nulle part (1937) d’après Pirandello ? Dans L’alibi,Stroheim est formidable. (C’est même peut être le film français où il est le mieux), tout comme Préjean, Jany Holt et Jouvet. Il faudra un jour revenir sur le soi disant divorce entre Jouvet et le cinéma, car il existe une bonne quinzaine de films où il est formidable. Chenal dirigeait bien les acteurs, à l’américaine, sans les laisser commenter leurs rôles. La fin, imposée par le producteur et que Chenal regretta toute sa vie, est un cran en dessous mais le rythme, la mise en scène, la photo en font un vrai film noir qui mérite d’être redécouvert…
Les films de Calef et la lecture du livre Henri Calef, cinéma sans étoile (Pilote 24 édition) de Philippe Esnault et Marie Calef m’ont donné envie de revoir L’alibi (1937) de Pierre Chenal (chez René Château, copie correcte aucun chapitrage ni bonus), excellent metteur en scène, hélas oublié des DVD. Où sont La maison du Maltais (1938), Le dernier tournant (1939), excellente adaptation du Facteur sonne toujours deux fois, L’homme de nulle part (1937) d’après Pirandello ? Dans L’alibi,Stroheim est formidable. (C’est même peut être le film français où il est le mieux), tout comme Préjean, Jany Holt et Jouvet. Il faudra un jour revenir sur le soi disant divorce entre Jouvet et le cinéma, car il existe une bonne quinzaine de films où il est formidable. Chenal dirigeait bien les acteurs, à l’américaine, sans les laisser commenter leurs rôles. La fin, imposée par le producteur et que Chenal regretta toute sa vie, est un cran en dessous mais le rythme, la mise en scène, la photo en font un vrai film noir qui mérite d’être redécouvert…
 Deux découvertes grâce une fois de plus, aux Documents Cinématographiques et ce dans de beaux tirages : Brazza, ou l’épopée du Congo, épopée colonialiste filmée par Léon Poirier, au pittoresque parfois involontaire, qu’il est bon de revoir dans le cadre du débat sur les bienfaits de la colonisation. À signaler un des cartons les plus amusants de l’histoire des génériques français : après avoir vu défiler les noms des acteurs, on peut lire « Monsieur XXX, secrétaire personnel de Savorgnan de Brazza viendra dire quelques mots à la fin du film ».
Deux découvertes grâce une fois de plus, aux Documents Cinématographiques et ce dans de beaux tirages : Brazza, ou l’épopée du Congo, épopée colonialiste filmée par Léon Poirier, au pittoresque parfois involontaire, qu’il est bon de revoir dans le cadre du débat sur les bienfaits de la colonisation. À signaler un des cartons les plus amusants de l’histoire des génériques français : après avoir vu défiler les noms des acteurs, on peut lire « Monsieur XXX, secrétaire personnel de Savorgnan de Brazza viendra dire quelques mots à la fin du film ».
Et surtout Lourdes et ses miracles (1955), documentaire en trois partie de Georges Rouquier (assistant Jacques Demy). Rouquier intervient dans deux parties : l’enquête sur les miracles, qui nous vaut trois interviews très pittoresques de miraculés et la conclusion. Il reste silencieux pendant l’épisode central durant lequel il filme sans commentaire une journée de pèlerinage, avec plusieurs plans impressionnants. À la fin, il revient sur deux guérisons qui se seraient produites durant cette journée. À ne pas manquer.
 Dans le coffret Billy Wilder, j’ai découvert avec un immense plaisir Les 5 secrets du désert (1943 – Five graves to Cairo chez Carlotta. Copie magnifique), film tout à fait divertissant et très inventif. La photo de John Seitz est presque aussi impressionnante que dans le génial Assurance sur la mort (1944), toujours chez Carlotta. Le dialogue de Wilder et Brackett fait mouche à de nombreuses reprises aussi bien dans le sérieux (l’évocation précise de Dunkerque et du ressentiment des Français, sujet peu abordé à l’époque) que dans la cocasserie qui repose toujours sur une approche juste. J’adore le général italien dont les Allemands ont volé la brosse à dents à Benghazi et qui essaie de chanter des airs d’opéra, provoquant des réactions courroucées de ses « alliés ». Il déclare d’ailleurs « une nation qui rote ne peut pas comprendre une nation qui chante ». Rommel, lui, exige que quand il sera à Alexandrie, on joue « Aïda en allemand, en coupant le second acte qui est trop long et pas très bon ». Il ajoute qu’on ne peut compter sur les italiens qu’on soit avec ou contre eux…
Dans le coffret Billy Wilder, j’ai découvert avec un immense plaisir Les 5 secrets du désert (1943 – Five graves to Cairo chez Carlotta. Copie magnifique), film tout à fait divertissant et très inventif. La photo de John Seitz est presque aussi impressionnante que dans le génial Assurance sur la mort (1944), toujours chez Carlotta. Le dialogue de Wilder et Brackett fait mouche à de nombreuses reprises aussi bien dans le sérieux (l’évocation précise de Dunkerque et du ressentiment des Français, sujet peu abordé à l’époque) que dans la cocasserie qui repose toujours sur une approche juste. J’adore le général italien dont les Allemands ont volé la brosse à dents à Benghazi et qui essaie de chanter des airs d’opéra, provoquant des réactions courroucées de ses « alliés ». Il déclare d’ailleurs « une nation qui rote ne peut pas comprendre une nation qui chante ». Rommel, lui, exige que quand il sera à Alexandrie, on joue « Aïda en allemand, en coupant le second acte qui est trop long et pas très bon ». Il ajoute qu’on ne peut compter sur les italiens qu’on soit avec ou contre eux…
Au rayon des westerns, Warner vient de sortir le dernier film de Raoul Walsh, La charge de la 8ème brigade (1964). On aurait aimé que notre génial borgne, auteur de tant de chefs-d’œuvre (L’enfer est à lui – 1949, La charge fantastique – 1941, Gentleman Jim – 1942, La grande évasion – 1941) termine sa carrière comme Altman ou John Huston. Ce n’est pas tout à fait le cas. Walsh commit l’erreur de choisir, comme scénariste, un de ses vieux complices, John Twist, auteur conventionnel, peu inventif. Et surtout la Warner l’obligea à prendre des jeunes acteurs, Troy Donahue, Susanne Pleshette, dont le moins qu’on puisse dire est qu’ils ne sont guère inspirants. Walsh tente par tous les moyens d’animer son héros et finit par le filmer en plan large. Il se rattrape avec James Gregory en général qui cite les auteurs latins et Claude Akins, escroc proxénète de la plus belle eau, et les scènes d’action sont remarquablement filmées. Walsh n’a rien perdu de son sens de la composition et sa collaboration avec le génial chef opérateur de Ford, William Clothier, donne de remarquables résultats. Dans le dernier tiers, la bataille (et tout ce qui précède, notamment les rapports avec le scout indien), la recherche des Indiens, l’exode dans le désert possèdent même un ton épique, une majesté, une grandeur tout à fait magnifique. Walsh parvient à intégrer plusieurs actions dans de nombreux plans de bataille, jouant sur la profondeur de champ (on voit des soldats mourir dans le lointain) et l’on comprend la tactique des uns et des autres… Dans sa dernière partie, il réussit plus de plans denses, tragiques, aigus qui font regretter qu’il n’ait pas pu tourner un autre film.
Les implacables (1955) est plus égal, mieux écrit, du moins superficiellement, mieux tenu, bien joué par Gable et Jane Russel (dont j’adore les chansons). Et bien sûr Robert Ryan dont la dernière réplique donne une nouvelle couleur à son personnage : parlant de Gable, il dit : « C’est le genre d’homme que l’on rêve de devenir quand on est petit et que l’on serait content d’avoir été quand on devient vieux ». La phrase qui ouvre le film est toute aussi fulgurante ; arrivant devant un pendu, Gable constate : « nous approchons de la civilisation… » Ce n’est pas pourtant un Walsh majeur dont les meilleurs moments ne rivalisent pas avec les beautés éparses que l’on trouve dans cette 8ème Brigade.


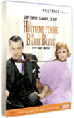

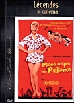
 L’homme au Masque de Cire (1953) d’André de Toth fut le premier film en 3D (et l’un des meilleurs) avec Bwana Le Diable (1952) de Arch Oboler. De Toth utilise le relief de manière astucieuse, jouant avec le brouillard, la couleur, des rentrées de champ inattendues (Alain Resnais se souvenait du surgissement de Charles Bronson qui rentre par le bas de l’image). Le relief donne un côté presque mystique au film qui vient d’être refait de manière calamiteuse.
L’homme au Masque de Cire (1953) d’André de Toth fut le premier film en 3D (et l’un des meilleurs) avec Bwana Le Diable (1952) de Arch Oboler. De Toth utilise le relief de manière astucieuse, jouant avec le brouillard, la couleur, des rentrées de champ inattendues (Alain Resnais se souvenait du surgissement de Charles Bronson qui rentre par le bas de l’image). Le relief donne un côté presque mystique au film qui vient d’être refait de manière calamiteuse.

 Dans un registre opposé Le Couperet (2005), remarquable adaptation par Costa-Gavras et Jean-Claude Grumberg d’un fort bon roman de Donald Westlake. La transposition de cette histoire américaine dans une zone frontalière est une excellente idée.
Dans un registre opposé Le Couperet (2005), remarquable adaptation par Costa-Gavras et Jean-Claude Grumberg d’un fort bon roman de Donald Westlake. La transposition de cette histoire américaine dans une zone frontalière est une excellente idée.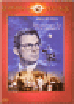 Autre adaptation très réussie : Du Silence et des Ombres (1962 – To Kill a Mockingbird) de Robert Mulligan, une oeuvre sensible, attachante et délicate qui transpose le beau roman de Harper Lee qui vient d’être réédité en France. Signalons que l’on voit Harper Lee dans les deux bons films consacrés à Truman Capote dont elle fut l’assistante.
Autre adaptation très réussie : Du Silence et des Ombres (1962 – To Kill a Mockingbird) de Robert Mulligan, une oeuvre sensible, attachante et délicate qui transpose le beau roman de Harper Lee qui vient d’être réédité en France. Signalons que l’on voit Harper Lee dans les deux bons films consacrés à Truman Capote dont elle fut l’assistante.
 Toujours chez Criterion, signalons Tanner 88 (1988) série télévisée de Robert Altman, écrite par Gary Trudeau, sur la campagne d’un candidat démocrate fictif, incarné magnifiquement par Michael Murphy, qui essaie de s’imposer durant les primaires. L’actualité tant américaine que française renforce la pertinence, la justesse prémonitoire de cette oeuvre essentielle. Altman mêle brillamment moments de fiction et de documentaires, acteurs et politiciens ou journalistes réels, analyse avec acuité les rapports entre la politique et les médias, politiciens réels, de Dukakis à Gary Hart en passant par Gore, se livre en permanence à de spectaculaires changements de ton. Comme toujours cinq ou six actions se télescopent dans la plupart des plans et des scènes et certains personnages secondaires deviennent brusquement des figures essentielles au détour d’une séquence. J’adore tout particulièrement la stagiaire volontaire nunuche dont chaque réflexion est décalée durant les premiers épisodes et qui prend peu a peu des couleurs différentes. Chaque épisode est précédé d’une interview avec les différents protagonistes 16 ans plus tard. INDISPENSABLE.
Toujours chez Criterion, signalons Tanner 88 (1988) série télévisée de Robert Altman, écrite par Gary Trudeau, sur la campagne d’un candidat démocrate fictif, incarné magnifiquement par Michael Murphy, qui essaie de s’imposer durant les primaires. L’actualité tant américaine que française renforce la pertinence, la justesse prémonitoire de cette oeuvre essentielle. Altman mêle brillamment moments de fiction et de documentaires, acteurs et politiciens ou journalistes réels, analyse avec acuité les rapports entre la politique et les médias, politiciens réels, de Dukakis à Gary Hart en passant par Gore, se livre en permanence à de spectaculaires changements de ton. Comme toujours cinq ou six actions se télescopent dans la plupart des plans et des scènes et certains personnages secondaires deviennent brusquement des figures essentielles au détour d’une séquence. J’adore tout particulièrement la stagiaire volontaire nunuche dont chaque réflexion est décalée durant les premiers épisodes et qui prend peu a peu des couleurs différentes. Chaque épisode est précédé d’une interview avec les différents protagonistes 16 ans plus tard. INDISPENSABLE.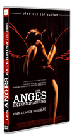 J’ai aussi revu avec beaucoup de plaisir à la Nouvelle-Orléans Les Anges Exterminateurs (2006) de Jean-Claude Brisseau. Sa force de conviction ingénue, son engagement me touchent et confèrent au film une force quasi mystique. Ce mot surprendra au vu des scènes sexuelles, mais je le maintiens.
J’ai aussi revu avec beaucoup de plaisir à la Nouvelle-Orléans Les Anges Exterminateurs (2006) de Jean-Claude Brisseau. Sa force de conviction ingénue, son engagement me touchent et confèrent au film une force quasi mystique. Ce mot surprendra au vu des scènes sexuelles, mais je le maintiens.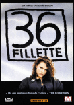 Dans le même registre, 36 Fillette (1988), un des meilleurs films de Catherine Breillat. Apre, teigneux corps à corps avec des personnages dérangeants, c’est une vraie réussite injustement éclipsée par des succès plus récents.
Dans le même registre, 36 Fillette (1988), un des meilleurs films de Catherine Breillat. Apre, teigneux corps à corps avec des personnages dérangeants, c’est une vraie réussite injustement éclipsée par des succès plus récents.

 En zone américaine, sortie de plusieurs classiques du film de cape et d’épée. Dans un même dvd, les deux versions de The Prisoner of Zenda (Le Prisonnier de Zenda – 1937 et 1952) d’après le roman éponyme de Anthony Hope (classique de la bibliothèque Verte). La première est due au talentueux John Cromwell et la seconde de Richard Thorpe la décalque fidèlement. On raconte que les droits de remake, exigés par Stewart Granger, furent si chers que la MGM refusa de payer un nouveau scénario et demanda qu’on recopie cette version.
En zone américaine, sortie de plusieurs classiques du film de cape et d’épée. Dans un même dvd, les deux versions de The Prisoner of Zenda (Le Prisonnier de Zenda – 1937 et 1952) d’après le roman éponyme de Anthony Hope (classique de la bibliothèque Verte). La première est due au talentueux John Cromwell et la seconde de Richard Thorpe la décalque fidèlement. On raconte que les droits de remake, exigés par Stewart Granger, furent si chers que la MGM refusa de payer un nouveau scénario et demanda qu’on recopie cette version.


 Les opéras comiques de Gilbert and Sullivan restent méconnus en France et le beau film que Mike Leigh leur consacra fut un bide. Il faut dire que les livrets, les lyrics de Gilbert sont difficilement traduisibles ou adaptables. Ils regorgent d’allusions, de jeux de mots qui n’ont pas de sens. Il faut pourtant voir The Pirates Of Penzance (1980) et son festival de pyrotechnie verbale (qui culmine avec l’entrée du major général), captation d’une représentation donnée dans le cadre de Shakespeare on the Park. Rythme effréné, trouvailles farceuses, chanteurs remarquables, notamment Linda Ronstadt et l’ébouriffant Kevin Kline.
Les opéras comiques de Gilbert and Sullivan restent méconnus en France et le beau film que Mike Leigh leur consacra fut un bide. Il faut dire que les livrets, les lyrics de Gilbert sont difficilement traduisibles ou adaptables. Ils regorgent d’allusions, de jeux de mots qui n’ont pas de sens. Il faut pourtant voir The Pirates Of Penzance (1980) et son festival de pyrotechnie verbale (qui culmine avec l’entrée du major général), captation d’une représentation donnée dans le cadre de Shakespeare on the Park. Rythme effréné, trouvailles farceuses, chanteurs remarquables, notamment Linda Ronstadt et l’ébouriffant Kevin Kline.

 Dans un registre mille fois plus obscur, on doit saluer la sortie chez VCI de Little Big Horn écrit et dirigé par Charles Marquis Warren que le grand critique Manny Farber avait qualifié de meilleur film de 1951, louant à juste titre l’interprétation introvertie, sombre, mélancolique et gracieuse de John Ireland et Lloyd Bridges.
Dans un registre mille fois plus obscur, on doit saluer la sortie chez VCI de Little Big Horn écrit et dirigé par Charles Marquis Warren que le grand critique Manny Farber avait qualifié de meilleur film de 1951, louant à juste titre l’interprétation introvertie, sombre, mélancolique et gracieuse de John Ireland et Lloyd Bridges. Dans la même collection, deux westerns co écrits et réalisés par Richard Bartlett, cinéaste chouchou du Nickel Odéon (pour Joe Dakota) que je rencontrai en 1961. The Silver Star (1955) est l’un des westerns les plus fauchés jamais tournés. On ne voit pas UN SEUL FIGURANT dans la ville que sillonne le héros, un shérif froussard qui refuse d’affronter les bandits qui l’attendent au saloon et dont le chef est joué par le réalisateur. Le sujet démarque High Noon (1952 – jusque dans l’utilisation d’une ballade à l’unique couplet) et en prend le contre-pied. On y retrouve les préoccupations morales de Bartlett. Edgard Buchanan y est excellent. Interview sans intérêt du producteur, acteur, co scénariste, Earle Lyon.
Dans la même collection, deux westerns co écrits et réalisés par Richard Bartlett, cinéaste chouchou du Nickel Odéon (pour Joe Dakota) que je rencontrai en 1961. The Silver Star (1955) est l’un des westerns les plus fauchés jamais tournés. On ne voit pas UN SEUL FIGURANT dans la ville que sillonne le héros, un shérif froussard qui refuse d’affronter les bandits qui l’attendent au saloon et dont le chef est joué par le réalisateur. Le sujet démarque High Noon (1952 – jusque dans l’utilisation d’une ballade à l’unique couplet) et en prend le contre-pied. On y retrouve les préoccupations morales de Bartlett. Edgard Buchanan y est excellent. Interview sans intérêt du producteur, acteur, co scénariste, Earle Lyon. Un petit mot sur les merveilleux documentaires de Les Blank sur la musique et la cuisine Cajun : J’ai été au Bal (1990), Yum Yum Yum (1990). Ils donnent une furieuse envie de se plonger dans l’étouffée d’écrevisse, le boudin de crevettes, le dirty rice, dans la musique de Clifton Chenier, Nathan Zydeco, John Delafosse, Marc et Ann Savoy.
Un petit mot sur les merveilleux documentaires de Les Blank sur la musique et la cuisine Cajun : J’ai été au Bal (1990), Yum Yum Yum (1990). Ils donnent une furieuse envie de se plonger dans l’étouffée d’écrevisse, le boudin de crevettes, le dirty rice, dans la musique de Clifton Chenier, Nathan Zydeco, John Delafosse, Marc et Ann Savoy. Un certain nombre de coffrets très excitants sont sortis ces derniers mois, dont le coffret Charlie Chan collection, vol 1 qui regroupe 4 titres : Charlie Chan in Paris (1935), Charlie Chan in London (1934), Charlie Chan in Egypt (1935), Charlie Chan in Shanghai (1935) joués par Warner Oland, pour moi le meilleur Chan. Et pourtant sa nationalité suédoise ne le prédisposait pas à jouer le détective chinois inventé par Earl Derr Biggers (d’après un vrai détective chinois de Honolulu) qu’il allait marquer pourtant de manière indélébile. Il est admirable de bonhomie rouée, de politesse raffinée et malicieuse. Il faut le voir distiller les faux aphorismes et proverbes (totalement absents des livres) inventés par les scénaristes : « Souvent petite taupinière plus révélatrice que grande montagne », « Trou de serrure bon ami de grand détective », « Alibi comme poisson pas frais, pourrit toujours par la tête », « Théorie comme buée sur lunettes, obscurcit la vision ». Le premier titre du coffret est en fait le 5ème de la série dont le premier Charlie Chan Carries on a disparu. Charlie Chan in Paris introduit pour la première fois Lee « le fils numéro 1 » joué avec beaucoup de bonne humeur par Keye Luke qui dynamise la série. Dans Charlie Chan in Egypt de Louis King (metteur en scène à surveiller) on peut voir Rita Cansino, future Rita Hayworth et le désopilant Stepin Fetchit.
Un certain nombre de coffrets très excitants sont sortis ces derniers mois, dont le coffret Charlie Chan collection, vol 1 qui regroupe 4 titres : Charlie Chan in Paris (1935), Charlie Chan in London (1934), Charlie Chan in Egypt (1935), Charlie Chan in Shanghai (1935) joués par Warner Oland, pour moi le meilleur Chan. Et pourtant sa nationalité suédoise ne le prédisposait pas à jouer le détective chinois inventé par Earl Derr Biggers (d’après un vrai détective chinois de Honolulu) qu’il allait marquer pourtant de manière indélébile. Il est admirable de bonhomie rouée, de politesse raffinée et malicieuse. Il faut le voir distiller les faux aphorismes et proverbes (totalement absents des livres) inventés par les scénaristes : « Souvent petite taupinière plus révélatrice que grande montagne », « Trou de serrure bon ami de grand détective », « Alibi comme poisson pas frais, pourrit toujours par la tête », « Théorie comme buée sur lunettes, obscurcit la vision ». Le premier titre du coffret est en fait le 5ème de la série dont le premier Charlie Chan Carries on a disparu. Charlie Chan in Paris introduit pour la première fois Lee « le fils numéro 1 » joué avec beaucoup de bonne humeur par Keye Luke qui dynamise la série. Dans Charlie Chan in Egypt de Louis King (metteur en scène à surveiller) on peut voir Rita Cansino, future Rita Hayworth et le désopilant Stepin Fetchit. Le plus réussis, Charlie Chan at the Opera (1936) de Bruce Humberstone (dont on vient de sortir le très bon I Wake Up Screaming), est sorti dans le coffret volume 2. C’est le plus stylisé visuellement, Boris Karloff joue le principal suspect et on y entend un opéra écrit par Oscar Levant. A noter qu’aucun des livres de Biggers ne fut adapté.
Le plus réussis, Charlie Chan at the Opera (1936) de Bruce Humberstone (dont on vient de sortir le très bon I Wake Up Screaming), est sorti dans le coffret volume 2. C’est le plus stylisé visuellement, Boris Karloff joue le principal suspect et on y entend un opéra écrit par Oscar Levant. A noter qu’aucun des livres de Biggers ne fut adapté. Encore plus divertissant est le coffret Mr Moto, série également produite par la Fox avec pas mal de moyens à la suite du succès des Charlie Chan. Le héros, Kentaro Moto, est cette fois un soldat de fortune, mi aventurier, mi détective (il appartient à la « police internationale » (sic)), japonais et non plus chinois, inventé par John P. Marquand. Ce personnage timide, effacé qui se transforme sans cesse, se révèle d’une intelligence diabolique et, contrairement à Charlie Chan, se bagarre assez souvent : c’est un as du judo. Il y a d’ailleurs pas mal de scène d’action, une poursuite dans le brouillard (Mysterious Mr Moto – 1938), des règlements de compte. On choisit pour incarner cet asiatique, un juif autrichien, cela s’imposait, à savoir Peter Lorre qui est formidable, avec ses grosses lunettes (on le fait parfois parler allemand). On lui oppose une galerie de « méchants » hauts en couleurs, joués par John Carradine, Lionell Atwill, Sig Ruman, George Sanders, Sidney Blackmer. Autre particularité, cette série est essentiellement l’œuvre d’une seule personne, Norman Foster qui écrivit et réalisa 6 des 8 titres et participa au scénario de l’un des deux restant. Foster avait été un acteur qui joue un rôle important dans le beau Pilgrimage (1933) de John Ford et dans State Fair (1933) de Henry King. Il était marié à Claudette Colbert et arrêta de jouer après qu’une agression lui ait abîmé le visage. Les films sont mieux mis en scène que les Charlie Chan. Foster aime remplir le cadre d’objets, de figurants, de plantes ; il joue beaucoup sur les avants plans et deux des films, Thank You, Mr Moto (1937) et Mysterious Mr Moto (1938) sont extrêmement réussis, inventifs, divertissants. Le deuxième se passe à Londres, après une rocambolesque évasion de l’île du diable, et nous montre toute une série de britanniques affichant un comportement très raciste face à notre héros. Lequel égrène des proverbes et se présente ainsi : nettoyage : immense, cuisine : prétentieux, cocktails : sublimes. Think Fast, Mr Moto (1937) est amusant mais moins cohérent. La qualité des décors et de la photo, bien mis en valeur dans ces Dvds, élève ces œuvres au-dessus de la série B. Orson Welles avait dû voir cette série et apprécier leur atmosphère cosmopolite, colorée avant de confier Voyage au Pays de la Peur (1943 – où contrairement à la rumeur, il ne semble pas avoir participé à la mise en scène. Dans un bonus, un historien rapporte une déclaration de Welles attribuant à Foster les mérites du film) puis My Friend Benito à Norman Foster (selon Dave Kehr, c’était parce qu’il parlait espagnol).
Encore plus divertissant est le coffret Mr Moto, série également produite par la Fox avec pas mal de moyens à la suite du succès des Charlie Chan. Le héros, Kentaro Moto, est cette fois un soldat de fortune, mi aventurier, mi détective (il appartient à la « police internationale » (sic)), japonais et non plus chinois, inventé par John P. Marquand. Ce personnage timide, effacé qui se transforme sans cesse, se révèle d’une intelligence diabolique et, contrairement à Charlie Chan, se bagarre assez souvent : c’est un as du judo. Il y a d’ailleurs pas mal de scène d’action, une poursuite dans le brouillard (Mysterious Mr Moto – 1938), des règlements de compte. On choisit pour incarner cet asiatique, un juif autrichien, cela s’imposait, à savoir Peter Lorre qui est formidable, avec ses grosses lunettes (on le fait parfois parler allemand). On lui oppose une galerie de « méchants » hauts en couleurs, joués par John Carradine, Lionell Atwill, Sig Ruman, George Sanders, Sidney Blackmer. Autre particularité, cette série est essentiellement l’œuvre d’une seule personne, Norman Foster qui écrivit et réalisa 6 des 8 titres et participa au scénario de l’un des deux restant. Foster avait été un acteur qui joue un rôle important dans le beau Pilgrimage (1933) de John Ford et dans State Fair (1933) de Henry King. Il était marié à Claudette Colbert et arrêta de jouer après qu’une agression lui ait abîmé le visage. Les films sont mieux mis en scène que les Charlie Chan. Foster aime remplir le cadre d’objets, de figurants, de plantes ; il joue beaucoup sur les avants plans et deux des films, Thank You, Mr Moto (1937) et Mysterious Mr Moto (1938) sont extrêmement réussis, inventifs, divertissants. Le deuxième se passe à Londres, après une rocambolesque évasion de l’île du diable, et nous montre toute une série de britanniques affichant un comportement très raciste face à notre héros. Lequel égrène des proverbes et se présente ainsi : nettoyage : immense, cuisine : prétentieux, cocktails : sublimes. Think Fast, Mr Moto (1937) est amusant mais moins cohérent. La qualité des décors et de la photo, bien mis en valeur dans ces Dvds, élève ces œuvres au-dessus de la série B. Orson Welles avait dû voir cette série et apprécier leur atmosphère cosmopolite, colorée avant de confier Voyage au Pays de la Peur (1943 – où contrairement à la rumeur, il ne semble pas avoir participé à la mise en scène. Dans un bonus, un historien rapporte une déclaration de Welles attribuant à Foster les mérites du film) puis My Friend Benito à Norman Foster (selon Dave Kehr, c’était parce qu’il parlait espagnol). Enfin le coffret Film Noir Classic Collection volume 3 comprend un certain nombre d’œuvres essentielles : On Dangerous Ground (1952) l’un des plus beau Nicholas Ray (disponible en zone 2 – La Maison dans l’Ombre), Border Incident(1949)très bon Anthony Mann, photographié par John Alton, polar noir et violent sur l’exploitation des travailleurs mexicains sans papiers. His Kind of Woman (1951) de John Farrow commence comme un film noir archétypal, au dialogue percutant, se transforme en comédie aux échanges sophistiqués ou très marrants : à Mitchum qui déclare , « je suis trop jeune pour mourir », Vincent Price répond « moi trop célèbre ». Jane Russel demande à Mitchum qui repasse son argent « quand il s’ennuie » : « Et quand tu es fauché, qu’est ce que tu repasses ? » – « Mon pantalon ». Durant une partie de poker, pour confondre un tricheur, il augmente la mise en posant sa chaussure sur la table, répondant ainsi au portefeuille qu’on vient de jeter. Il sort une liasse de la chaussure et la scène s’achève en farce. Vincent Price incarne de manière grandiose un cabot qui tente d’incarner les personnages qu’il joue et cite constamment Hamlet. Mais la comédie est trouée d’éclairs de violence, de sadisme, filmés par Richard Fleischer qui termina le dernier quart du film, après le meurtre de Tim Holt (tout ce qui se passe sur et autour du yacht). Il faut dire que les caprices, les indécisions d’Howard Hughes avaient décuplé la durée du tournage. Vincent Price qui avait un contrat de 8 semaines célébra sa 52e semaine par une fête somptueuse. Les autres films sont The Racket (1951) de John Cromwell et le célèbre Lady in the Lake (1947) de Robert Montgomery où la caméra est Philip Marlowe et que j’aimerais revoir.
Enfin le coffret Film Noir Classic Collection volume 3 comprend un certain nombre d’œuvres essentielles : On Dangerous Ground (1952) l’un des plus beau Nicholas Ray (disponible en zone 2 – La Maison dans l’Ombre), Border Incident(1949)très bon Anthony Mann, photographié par John Alton, polar noir et violent sur l’exploitation des travailleurs mexicains sans papiers. His Kind of Woman (1951) de John Farrow commence comme un film noir archétypal, au dialogue percutant, se transforme en comédie aux échanges sophistiqués ou très marrants : à Mitchum qui déclare , « je suis trop jeune pour mourir », Vincent Price répond « moi trop célèbre ». Jane Russel demande à Mitchum qui repasse son argent « quand il s’ennuie » : « Et quand tu es fauché, qu’est ce que tu repasses ? » – « Mon pantalon ». Durant une partie de poker, pour confondre un tricheur, il augmente la mise en posant sa chaussure sur la table, répondant ainsi au portefeuille qu’on vient de jeter. Il sort une liasse de la chaussure et la scène s’achève en farce. Vincent Price incarne de manière grandiose un cabot qui tente d’incarner les personnages qu’il joue et cite constamment Hamlet. Mais la comédie est trouée d’éclairs de violence, de sadisme, filmés par Richard Fleischer qui termina le dernier quart du film, après le meurtre de Tim Holt (tout ce qui se passe sur et autour du yacht). Il faut dire que les caprices, les indécisions d’Howard Hughes avaient décuplé la durée du tournage. Vincent Price qui avait un contrat de 8 semaines célébra sa 52e semaine par une fête somptueuse. Les autres films sont The Racket (1951) de John Cromwell et le célèbre Lady in the Lake (1947) de Robert Montgomery où la caméra est Philip Marlowe et que j’aimerais revoir.
 J’ai revu Network (1976) de Sidney Lumet qui vient de sortie en Dvd collector et j’ai trouvé qu’on avait été très sévère et assez superficiel dans 50 Ans de Cinéma Américain vis à vis de ce film qui, non seulement tient le coup, mais prend une valeur incroyablement prémonitoire. Il suffit de penser aux dérives de la télévision ces dernières années, à la mainmise des sectes chrétiennes, des partis plus conservateurs sur l’information. Network anticipe aussi sur la télé réalité, nous parle du terrorisme filmé en direct, de la présence de l’Arabie Saoudite dans l’économie américaine, des intérêts arabes. On y mentionne déjà, 20 ans avant, que l’Arabie Saoudite possède une grande partie du port de la Nouvelle Orléans.
J’ai revu Network (1976) de Sidney Lumet qui vient de sortie en Dvd collector et j’ai trouvé qu’on avait été très sévère et assez superficiel dans 50 Ans de Cinéma Américain vis à vis de ce film qui, non seulement tient le coup, mais prend une valeur incroyablement prémonitoire. Il suffit de penser aux dérives de la télévision ces dernières années, à la mainmise des sectes chrétiennes, des partis plus conservateurs sur l’information. Network anticipe aussi sur la télé réalité, nous parle du terrorisme filmé en direct, de la présence de l’Arabie Saoudite dans l’économie américaine, des intérêts arabes. On y mentionne déjà, 20 ans avant, que l’Arabie Saoudite possède une grande partie du port de la Nouvelle Orléans.