A compter d’aujourd’hui, Bertrand Tavernier vous donne rendez-vous plus souvent. Il publiera à votre attention, fidèles lecteurs ou amateurs occasionnels, des regrets, des coups de gueule ou des découvertes plusieurs fois par mois et non plus une seule fois comme cela était jusqu’ici le cas. Tous les textes seront disponibles en ligne, sur le site de la SACD. Vous pourrez ainsi vous en délecter à souhait, selon votre temps et votre convenance. Le premier de cette nouvelle version du blog de Bertrand Tavernier : ses regrets. Lire ci-dessus. Bonne lecture.
Lire la suite »SUSPENSE (Warner Archive)
 Voilà le deuxième Tuttle intéressant que je vois en quelques semaines. Après HOSTAGES, oeuvre qui symbolise tout un cinéma, celui pensé, écrit par des auteurs qui seront blacklistés (résistance et collaboration en Tchécoslovaquie, photo de Victor Milner, indiscernable sur ma copie), voici SUSPENSE. On se demande pourquoi Tuttle passe brusquement de la Paramount où son statut était assez fort après THIS GUN FOR HIRE, de la Fox, de la première production de Bing Crosby (THE GREAT JOHN L) à Monogram. Est-il menacé politiquement ? Ce qu’on pourrait imaginer, vu que le film est produit par les King Brothers qui engagèrent des dizaines de black listés. SUSPENSE est considérée comme la première production A de la Monogram, ce qui veut juste dire que les moyens sont un peu moins misérables que d’habitude, les décors un peu moins fauchés. C’est l’équivalent d’une série B de Studio et le film est relativement impressionnant quant aux décors (le penthouse dont un internaute dit qu’il a dix ans d’avance sur les décors de PLANETE INTERDITE, le night Club (le même que celui de XANADU ?) le chalet dans la montagne, les décors de montagne). Tuttle demande à son opérateur Karl Struss de nombreux effets visuels, une utilisation des clair obscur, des personnages éclairés à contre jour dont certains disent qu’il anticipe sur le Mann de Desperate. Discutable, d’autres films s’aventuraient dans la même direction (citons AFRAID TO TALK, le chef d’œuvre d’Edward L Cahn qui date de 32). Même certaines des séquences de patinages sont décorées et photographiées avec soin (elles sont dirigées par Nick Castle). Le scénario de Philip Yordan accumule les ellipses, les fausses pistes, évite toute explication un tant soit peu rationnelle : Albert Dekker engage Barry Sullivan après sans doute le plus court entretien d’embauche de l’Histoire du cinéma : « C’est machin qui m’envoie » – » Que pouvez vous faire ? » – » Tout ce que vous voulez » – » Je crois qu’on va trouver quelque chose pour vous ». Il est ensuite promu sans aucune raison. Plus tard, on mentionne une lettre qui contiendrait des informations préjudiciables à Sullivan, lettre qu’on ne verra pas et informations qu’on n’aura pas. Les deux disparitions d’Albert Dekker restent ultra énigmatiques, principalement ce bureau qu’on fait bruler dans la chaudière, mais cela finit par donner un vrai côté onirique au film, comme si le scénariste semblait avoir oublié ce qui s’était passé avant et qu’il collait des bouts de scène typiques du genre, dont plusieurs décalquent GILDA. Dekker et surtout Eugène Palette méritent une mention spéciale, Belita est plus qu’acceptable et Sullivan ne ressemble vraiment à aucun acteur de l’époque. Il accepte un personnage épouvantablement antipathique qui ne songe qu’à se venger de son bienfaiteur, traite avec une terrible muflerie son ancienne petite amie « tu peux me servir ma bière ? » – « Pourquoi, tu as le bras cassé ? ». C’est sans doute l’un des héros les plus déplaisants de l’histoire du genre qui en compte pas mal.
Voilà le deuxième Tuttle intéressant que je vois en quelques semaines. Après HOSTAGES, oeuvre qui symbolise tout un cinéma, celui pensé, écrit par des auteurs qui seront blacklistés (résistance et collaboration en Tchécoslovaquie, photo de Victor Milner, indiscernable sur ma copie), voici SUSPENSE. On se demande pourquoi Tuttle passe brusquement de la Paramount où son statut était assez fort après THIS GUN FOR HIRE, de la Fox, de la première production de Bing Crosby (THE GREAT JOHN L) à Monogram. Est-il menacé politiquement ? Ce qu’on pourrait imaginer, vu que le film est produit par les King Brothers qui engagèrent des dizaines de black listés. SUSPENSE est considérée comme la première production A de la Monogram, ce qui veut juste dire que les moyens sont un peu moins misérables que d’habitude, les décors un peu moins fauchés. C’est l’équivalent d’une série B de Studio et le film est relativement impressionnant quant aux décors (le penthouse dont un internaute dit qu’il a dix ans d’avance sur les décors de PLANETE INTERDITE, le night Club (le même que celui de XANADU ?) le chalet dans la montagne, les décors de montagne). Tuttle demande à son opérateur Karl Struss de nombreux effets visuels, une utilisation des clair obscur, des personnages éclairés à contre jour dont certains disent qu’il anticipe sur le Mann de Desperate. Discutable, d’autres films s’aventuraient dans la même direction (citons AFRAID TO TALK, le chef d’œuvre d’Edward L Cahn qui date de 32). Même certaines des séquences de patinages sont décorées et photographiées avec soin (elles sont dirigées par Nick Castle). Le scénario de Philip Yordan accumule les ellipses, les fausses pistes, évite toute explication un tant soit peu rationnelle : Albert Dekker engage Barry Sullivan après sans doute le plus court entretien d’embauche de l’Histoire du cinéma : « C’est machin qui m’envoie » – » Que pouvez vous faire ? » – » Tout ce que vous voulez » – » Je crois qu’on va trouver quelque chose pour vous ». Il est ensuite promu sans aucune raison. Plus tard, on mentionne une lettre qui contiendrait des informations préjudiciables à Sullivan, lettre qu’on ne verra pas et informations qu’on n’aura pas. Les deux disparitions d’Albert Dekker restent ultra énigmatiques, principalement ce bureau qu’on fait bruler dans la chaudière, mais cela finit par donner un vrai côté onirique au film, comme si le scénariste semblait avoir oublié ce qui s’était passé avant et qu’il collait des bouts de scène typiques du genre, dont plusieurs décalquent GILDA. Dekker et surtout Eugène Palette méritent une mention spéciale, Belita est plus qu’acceptable et Sullivan ne ressemble vraiment à aucun acteur de l’époque. Il accepte un personnage épouvantablement antipathique qui ne songe qu’à se venger de son bienfaiteur, traite avec une terrible muflerie son ancienne petite amie « tu peux me servir ma bière ? » – « Pourquoi, tu as le bras cassé ? ». C’est sans doute l’un des héros les plus déplaisants de l’histoire du genre qui en compte pas mal.
 Revu enfin dans une belle copie HE WALKED BY NIGHT (WILD SIDE) qui m’a paru meilleur que dans mon souvenir. En grande partie à cause de la photo très inventive d’Alton et de l’interprétation de Richard Basehart qui arrive à préserver l’opacité de son personnage tout en le rendant intéressant. On ne sait pas très bien ce qu’il cherche, sinon de l’argent ni ce qui le motive vraiment. Le scénario ne se préoccupe guère de psychologie ni pour lui ni pour les flics. Aucun effort n’est fait pour approfondir le personnage de Scott Brady et le film y gagne car on nous épargne les habituelles séquences de vie domestiques. Il n’y a guère plus de progression dramatique, le récit procède par brusque à coups que relie un commentaire pléonastique et solennel, asséné plutôt que lu par Reed Hadley. Les scènes nocturnes sont très réussies. On a beaucoup glosé sur les séquences se déroulant dans les égouts où Alton exécute une série de variations sur des lampes torche sans doute très renforcées qui s’éloignent ou se rapprochent dans les conduits très obscurs créant de spectaculaires effets, notamment dans les plans très larges (dont il se servira à nouveau avec Florey) : on voit la lumière cascader puis décroitre sur les murs. Mais j’ai été encore plus impressionné par toute la scène où Basehart arrive en avance au rendez vous fixé par Mr Reeves, déjouant le piège tendu par les policiers. Là, plus que dans la scène célèbre où il s’opère lui même, je me suis dit que le découpage, les angles, les rapports des personnages dans l’espace portaient la trace (l’influence ?) d’Anthony Mann. Mais John Alton nous avait dit que la part de Mann avait été minime contrairement à ce qui a été dit. C’est un des points sur lesquels il n’est jamais revenu (l’autre étant sa détestation d’Allan Dwan) La séquence est néanmoins la plus réussie du film qui reste quand même en dessous de T MEN ou de RAW DEAL.
Revu enfin dans une belle copie HE WALKED BY NIGHT (WILD SIDE) qui m’a paru meilleur que dans mon souvenir. En grande partie à cause de la photo très inventive d’Alton et de l’interprétation de Richard Basehart qui arrive à préserver l’opacité de son personnage tout en le rendant intéressant. On ne sait pas très bien ce qu’il cherche, sinon de l’argent ni ce qui le motive vraiment. Le scénario ne se préoccupe guère de psychologie ni pour lui ni pour les flics. Aucun effort n’est fait pour approfondir le personnage de Scott Brady et le film y gagne car on nous épargne les habituelles séquences de vie domestiques. Il n’y a guère plus de progression dramatique, le récit procède par brusque à coups que relie un commentaire pléonastique et solennel, asséné plutôt que lu par Reed Hadley. Les scènes nocturnes sont très réussies. On a beaucoup glosé sur les séquences se déroulant dans les égouts où Alton exécute une série de variations sur des lampes torche sans doute très renforcées qui s’éloignent ou se rapprochent dans les conduits très obscurs créant de spectaculaires effets, notamment dans les plans très larges (dont il se servira à nouveau avec Florey) : on voit la lumière cascader puis décroitre sur les murs. Mais j’ai été encore plus impressionné par toute la scène où Basehart arrive en avance au rendez vous fixé par Mr Reeves, déjouant le piège tendu par les policiers. Là, plus que dans la scène célèbre où il s’opère lui même, je me suis dit que le découpage, les angles, les rapports des personnages dans l’espace portaient la trace (l’influence ?) d’Anthony Mann. Mais John Alton nous avait dit que la part de Mann avait été minime contrairement à ce qui a été dit. C’est un des points sur lesquels il n’est jamais revenu (l’autre étant sa détestation d’Allan Dwan) La séquence est néanmoins la plus réussie du film qui reste quand même en dessous de T MEN ou de RAW DEAL.
Par ailleurs, Scott Brady était le frère de Lawrence Tierney.
 Cela fait déjà un bout de temps que je voulais signaler le deuxième coffret Columbia Film Noir Classics 2. Je ne me souviens même plus si j’ai parlé du premier, FILM NOIR CLASSICS NOIR I (sous titres anglais). Même si c’est le cas je peux revenir sur le très méconnu THE SNIPER (l’HOMME A L’AFFUT) d’Edward Dmytryk, étude forte, pleine de compassion d’un tueur en série qui abat les femmes avec un fusil à mire télescopique. Il lutte contre ses pulsions, tente de se bruler, de se mutiler pour arrêter. Chaque fois que je vois ce film, je me demande si les scénaristes de DIRTY HARRY ne s’étaient amusés à prendre le contrepied systématique de la morale, de la démarche humaniste de THE SNIPER. Utilisant la même ville (San Francisco), ils montraient un tueur abject, refusaient tout alibi médical et Eastwood jouait un personnage aux antipodes de l’inspecteur Kafka que brosse Adolphe Menjou. Il est passionnant en tout cas d’opposer les deux films. Dmytryk utilise aussi brillamment que Siegel les décors naturels (je n’ai jamais oublié cette immense cheminée d’usine avec cet ouvrier qui repère le tueur), joue avec des plans longs (le premier meurtre), évite toute complaisance dans la description de la violence. Les scènes de police font preuve d’une rudesse peu commune à l’époque.
Cela fait déjà un bout de temps que je voulais signaler le deuxième coffret Columbia Film Noir Classics 2. Je ne me souviens même plus si j’ai parlé du premier, FILM NOIR CLASSICS NOIR I (sous titres anglais). Même si c’est le cas je peux revenir sur le très méconnu THE SNIPER (l’HOMME A L’AFFUT) d’Edward Dmytryk, étude forte, pleine de compassion d’un tueur en série qui abat les femmes avec un fusil à mire télescopique. Il lutte contre ses pulsions, tente de se bruler, de se mutiler pour arrêter. Chaque fois que je vois ce film, je me demande si les scénaristes de DIRTY HARRY ne s’étaient amusés à prendre le contrepied systématique de la morale, de la démarche humaniste de THE SNIPER. Utilisant la même ville (San Francisco), ils montraient un tueur abject, refusaient tout alibi médical et Eastwood jouait un personnage aux antipodes de l’inspecteur Kafka que brosse Adolphe Menjou. Il est passionnant en tout cas d’opposer les deux films. Dmytryk utilise aussi brillamment que Siegel les décors naturels (je n’ai jamais oublié cette immense cheminée d’usine avec cet ouvrier qui repère le tueur), joue avec des plans longs (le premier meurtre), évite toute complaisance dans la description de la violence. Les scènes de police font preuve d’une rudesse peu commune à l’époque.
On retrouve Siegel pour le remarquable the LINE UP qui démarre un peu mollement (Siegel se bagarra pour changer ce début mais le producteur à qui ont doit la série TV du même nom, voulait montrer la police).
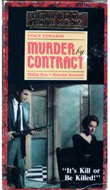 MURDER BY CONTRACT est d’une rare sécheresse mais je me suis toujours demandé si ce ton dépouillé, dégraissé, surprenant dans son refus de la scène à faire, ne venait pas autant des manques d’Irving Lerner (qui apparaitront dans ses films suivants) que de ses qualités : une certaine platitude dans les cadres, les plans qui contredit des options souvent intelligentes. Le scénariste Ben Maddow (non crédité) a du aussi jouer un rôle important. Inutile de s’étendre sur REGLEMENT DE COMPTE, le meilleur Fritz Lang de la décennie.
MURDER BY CONTRACT est d’une rare sécheresse mais je me suis toujours demandé si ce ton dépouillé, dégraissé, surprenant dans son refus de la scène à faire, ne venait pas autant des manques d’Irving Lerner (qui apparaitront dans ses films suivants) que de ses qualités : une certaine platitude dans les cadres, les plans qui contredit des options souvent intelligentes. Le scénariste Ben Maddow (non crédité) a du aussi jouer un rôle important. Inutile de s’étendre sur REGLEMENT DE COMPTE, le meilleur Fritz Lang de la décennie.
FIVE AGAINST THE HOUSE est assez bavard et statique après de bonnes scènes d’introduction où je retrouve la patte du scénariste dialoguiste William Bowers. Dans ces échanges de vannes rapides, souvent drôles mais qui deviennent ici trop systématiques (chez De Toth, Dick Powell, Parrish, Bowers changeait de ton et de style). De plus cette nervosité n’est pas très bien servie par des acteurs trop âgés pour ces étudiants qu’ils sont censés jouer, trop placides comme Madison ou Matthews. Brian Keith lui s’en sort nettement mieux. Je me demande si Phil Karlson n’a pas été paralysé par l’autre scénariste Stirling Silliphant qui produisit le film et donc protégea son scénario. Il serait intéressant de voir quelle est la part respective de ces deux écrivains. On peut penser que Silliphant vint en premier et que Bowers qui avait travaillé avec Karlson (ils se retrouvèrent sur TIGH SPOT) vint dynamiser le dialogue et l’épicer. Quelques plans réussis dans le hold-up final, un décor – ce garage avec ces ascenseurs- bien utilisé, un long plan en mouvement qui traverse tout le casino pour aboutir à la pièce où William Conrad range son chariot rompent la monotonie terne du film. Comme toujours, dans tous les films, une chanteuse de bar (Kim Novak doublée bien sur) ne chante qu’une seule chanson…
