 Le festival du Grand Lyon a été encore une fois un immense succès. L’occasion de découvrir ou de revoir dans des copies restaurées (pas toujours en ce qui concerne le son comme l’a montré FALBALAS, ce chef d’œuvre de Becker), le plus souvent magnifiques.
Le festival du Grand Lyon a été encore une fois un immense succès. L’occasion de découvrir ou de revoir dans des copies restaurées (pas toujours en ce qui concerne le son comme l’a montré FALBALAS, ce chef d’œuvre de Becker), le plus souvent magnifiques.
Je voudrais profiter de l’occasion pour saluer Jacques Becker qui n’est pas reconnu à sa juste valeur en France. Aucune biographie à ce jour ne lui rend pleinement justice. Une ou deux études dont la meilleure fut publiée à la BIFI mettent en valeur son génie. N’ayons pas peur des mots. Après avoir revu plusieurs de ses films, j’ai envie d’affirmer que Jacques Becker est le meilleur cinéaste français des décennies 40/50 (en 40, il a de rudes concurrents avec Clouzot, Clément, Autant-Lara mais leurs films des années suivantes ne valent pas les siens).
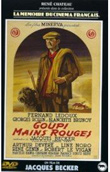 Bonne occasion de rappeler que FALBALAS, TOUCHEZ PAS AU GRISBI, LE TROU, RENDEZ-VOUS DE JUILLET, CASQUE D’OR, RUE DE L’ESTRAPADE, ces chefs d’œuvres, sont disponibles en dvd souvent dans de belles éditions. Qu’on trouve GOUPI MAINS ROUGES sans chapitres, ni bonus chez René Château. Mais pas EDOUARD ET CAROLINE, cette merveilleuse comédie qui se déroule durant une soirée, efface toute trace d’intrigue tarabiscotée. Seuls des retards, des importuns, des petits problèmes concrets (l’absence d’un gilet) viennent nourrir la narration, provoquer des drames, une rupture. Anne Vernon, Daniel Gelin n’arrêtent pas de courir, de se démener, de travailler comme dans tous les films de Becker. Jean Galland, Jacques François, Elena Labourdette qui fait l’œil de biche, sont hilarants.
Bonne occasion de rappeler que FALBALAS, TOUCHEZ PAS AU GRISBI, LE TROU, RENDEZ-VOUS DE JUILLET, CASQUE D’OR, RUE DE L’ESTRAPADE, ces chefs d’œuvres, sont disponibles en dvd souvent dans de belles éditions. Qu’on trouve GOUPI MAINS ROUGES sans chapitres, ni bonus chez René Château. Mais pas EDOUARD ET CAROLINE, cette merveilleuse comédie qui se déroule durant une soirée, efface toute trace d’intrigue tarabiscotée. Seuls des retards, des importuns, des petits problèmes concrets (l’absence d’un gilet) viennent nourrir la narration, provoquer des drames, une rupture. Anne Vernon, Daniel Gelin n’arrêtent pas de courir, de se démener, de travailler comme dans tous les films de Becker. Jean Galland, Jacques François, Elena Labourdette qui fait l’œil de biche, sont hilarants.
 Heureusement, pour compenser cette injustice insensée, Gaumont a eu l’idée heureuse de sortir en collection rouge le magnifique ANTOINE ET ANTOINETTE : admirable portrait de la France sous l’Occupation, une France populaire qui prend le métro (y travaille aussi) ou son vélo, qui n’a pas de lavabo. Une France ouvrière où l’on se prête des livres, où les légumes coûtent encore chers (Noël Roquevert en épicier torve et libidineux dont on se dit qu’il a dû profiter de l’Occupation, est grandiose). Et comme toujours chez Becker – voir Jeanne Fusier Gir dans FALBALAS -, épuré, débarrassé de la conscience qu’il peut avoir d’incarner une baderne : direction d’acteurs qui gomme les effets, accélère le rythme. Modernisme absolu. Claire Maffei, Roger Pigaut, Pierre Trabaud sont parfaits. Et parlant de la classe ouvrière (les personnages une fois de plus travaillent ou prennent du temps pour se rendre au travail), le cinéaste demande à son fidèle collaborateur, le compositeur Jean-Jacques Grunenwald (LES AVENTURES DE BEBE DONGE, LES ANGES DU PECHE, FALBALAS), le spécialiste de Bach à l’orgue, une partition néo classique. Belle chronique de Philippe Meyer dont il faut lire SANGUINES sur ce film le 13 à 7 heures 55 sur France Culture.
Heureusement, pour compenser cette injustice insensée, Gaumont a eu l’idée heureuse de sortir en collection rouge le magnifique ANTOINE ET ANTOINETTE : admirable portrait de la France sous l’Occupation, une France populaire qui prend le métro (y travaille aussi) ou son vélo, qui n’a pas de lavabo. Une France ouvrière où l’on se prête des livres, où les légumes coûtent encore chers (Noël Roquevert en épicier torve et libidineux dont on se dit qu’il a dû profiter de l’Occupation, est grandiose). Et comme toujours chez Becker – voir Jeanne Fusier Gir dans FALBALAS -, épuré, débarrassé de la conscience qu’il peut avoir d’incarner une baderne : direction d’acteurs qui gomme les effets, accélère le rythme. Modernisme absolu. Claire Maffei, Roger Pigaut, Pierre Trabaud sont parfaits. Et parlant de la classe ouvrière (les personnages une fois de plus travaillent ou prennent du temps pour se rendre au travail), le cinéaste demande à son fidèle collaborateur, le compositeur Jean-Jacques Grunenwald (LES AVENTURES DE BEBE DONGE, LES ANGES DU PECHE, FALBALAS), le spécialiste de Bach à l’orgue, une partition néo classique. Belle chronique de Philippe Meyer dont il faut lire SANGUINES sur ce film le 13 à 7 heures 55 sur France Culture.

 Autre hommage, autre confirmation : William A Wellman. Mais c’est une bonne occasion pour citer encore et louer L’ETRANGE INCIDENT, ce western si puissant sur le lynchage, CONVOI DE FEMMES, LA VILLE ABANDONNÉE, deux westerns sublimes (j’avais sous estimé le second), le coffret numéro 3 de FORBIDDEN HOLLYWOOD (sous titres français) avec 6 de ses films pré codes dont 3 ou 4 chefs d’œuvres, le numéro 2 qui comprend le remarquable et décapant NIGHT NURSE, WINGS film autobiographique où les scènes sentimentales sont aussi poignantes que les combats aériens, ISLAND IN THE SKY (AVENTURES DANS LE GRAND NORD) œuvre personnelle et méconnue sur l’héroïsme quotidien, AU DELA DU MISSOURI. Ce même héroïsme qui imprègne chaque plan de l’admirable STORY OF GI JOE (LES FORÇATS DE LA GLOIRE), bientôt chez Wild Side. Cette chronique guerrière où les batailles sont gommées comme souvent chez Wellman (il fait carrément l’impasse sur la prise de Monte Cassino, préférant se concentrer sur l’attente). Il y a juste un combat singulier contre des snipers dans une église en ruine (« drôle de lieu pour se tuer »). Sinon, on lutte contre le froid, la pluie (les scènes de pluie sont formidables chez Wellman), cette mort qui rode, ce chien qu’on héberge. Mitchum est tout bonnement admirable, se fondant dans la masse de ses soldats, n’émergeant que pour parler du sentiment qu’il a d’être un meurtrier. Burgess Meredith est inoubliable en Ernie Pyle, inoubliable d’humanité, de vulnérabilité. Signalons qu’on peut trouver ses chroniques sur Amazon.fr et j’ai même acheté GI JOE, recueil publié avant la chute de l’Allemagne comme le mentionne la couverture. J’ai déjà dans la même collection UNE PROMENADE AU SOLEIL de Harry Brown dont je lis un très beau roman THE STARS IN THEIR COURSES que Hawks hélas, ignora totalement dans EL DORADO qui était supposé être une adaptation de ce livre lyrique et méditatif. Le Salinger du western, écrit un lecteur de ce livre.
Autre hommage, autre confirmation : William A Wellman. Mais c’est une bonne occasion pour citer encore et louer L’ETRANGE INCIDENT, ce western si puissant sur le lynchage, CONVOI DE FEMMES, LA VILLE ABANDONNÉE, deux westerns sublimes (j’avais sous estimé le second), le coffret numéro 3 de FORBIDDEN HOLLYWOOD (sous titres français) avec 6 de ses films pré codes dont 3 ou 4 chefs d’œuvres, le numéro 2 qui comprend le remarquable et décapant NIGHT NURSE, WINGS film autobiographique où les scènes sentimentales sont aussi poignantes que les combats aériens, ISLAND IN THE SKY (AVENTURES DANS LE GRAND NORD) œuvre personnelle et méconnue sur l’héroïsme quotidien, AU DELA DU MISSOURI. Ce même héroïsme qui imprègne chaque plan de l’admirable STORY OF GI JOE (LES FORÇATS DE LA GLOIRE), bientôt chez Wild Side. Cette chronique guerrière où les batailles sont gommées comme souvent chez Wellman (il fait carrément l’impasse sur la prise de Monte Cassino, préférant se concentrer sur l’attente). Il y a juste un combat singulier contre des snipers dans une église en ruine (« drôle de lieu pour se tuer »). Sinon, on lutte contre le froid, la pluie (les scènes de pluie sont formidables chez Wellman), cette mort qui rode, ce chien qu’on héberge. Mitchum est tout bonnement admirable, se fondant dans la masse de ses soldats, n’émergeant que pour parler du sentiment qu’il a d’être un meurtrier. Burgess Meredith est inoubliable en Ernie Pyle, inoubliable d’humanité, de vulnérabilité. Signalons qu’on peut trouver ses chroniques sur Amazon.fr et j’ai même acheté GI JOE, recueil publié avant la chute de l’Allemagne comme le mentionne la couverture. J’ai déjà dans la même collection UNE PROMENADE AU SOLEIL de Harry Brown dont je lis un très beau roman THE STARS IN THEIR COURSES que Hawks hélas, ignora totalement dans EL DORADO qui était supposé être une adaptation de ce livre lyrique et méditatif. Le Salinger du western, écrit un lecteur de ce livre.
« Et si le lien entre ces deux immenses cinéastes consistait dans l’importance, le poids que prend chez eux la décence commune », cette notion chère à Orwell (reprise par Jean-Claude Michea : la décence commune c’est le « sentiment intuitif des choses qui ne doivent pas se faire, non seulement si l’on veut rester digne de sa propre humanité, mais surtout si l’on cherche à maintenir les conditions d’une existence quotidienne véritablement commune ».) qui veut qu’on donne sans vouloir obligatoirement recevoir, qu’on prenne en compte la collectivité, que la notion de responsabilité soit prise au sérieux. Voilà deux cinéastes qui savent s’attarder sur les conséquences d’un acte, d’une action et pas seulement dramatiser cette action.
Sinon quelle émotion de revoir Gérard Depardieu bouleversant dans LE CHOIX DES ARMES (salut Alain), dans le magnifique QUAND J’ÉTAIS CHANTEUR, dans LOULOU, DITES-LUI QUE JE L’AIME, œuvre si dérangeante de Claude Miller et dans LE SUCRE et CYRANO. Que du bonheur.
 Un bonheur qu’on peut partager en se plongeant dans le coffret Brassens édité par l’Ina qui comprend des trésors. Entre autres, cette discussion sur ses livres favoris parmi lesquels GIL BLAS qui m’a fait acheter Mon Oncle Benjamin, ce roman philosophique de Claude Tillier.
Un bonheur qu’on peut partager en se plongeant dans le coffret Brassens édité par l’Ina qui comprend des trésors. Entre autres, cette discussion sur ses livres favoris parmi lesquels GIL BLAS qui m’a fait acheter Mon Oncle Benjamin, ce roman philosophique de Claude Tillier.
La sortie du savoureux SKYLAB me permet de rappeler les deux précédents films de Julie Delpy sans parler du délicieux BEFORE SUNSET qu’elle a co écrit : le décapant, TWO DAYS IN PARIS, truffés d’allusions sexuelles (les rapports entre une fellation et la politique). Dès qu’elle déambule, elle est accostée par d’anciens amants sous l’œil exaspéré de son petit ami américain qu’elle a forcé à manger du lapin. LA COMTESSE sans être aussi réussie, était une oeuvre riche, gonflée, passionnante. Vive Julie.


 Dans le texte de 50 ANS sur Joseph H Lewis, je parle de l’ambiance nocturne de THE HALLYDAY BRAND, ce western dont le début renvoie aux FURIES de Mann. En le revoyant dans une belle copie en dvd, le terme m’a paru un peu inexact et pourtant pas si faux que cela. Il y a peu de scènes de nuit, même si elles sont fortes (le plan des lyncheurs courant vers la prison) mais si j’ai utilisé ce terme, c’est que le film dégage une impression de claustrophobie, d’étouffement plus associée au film noir qu’au western.
Dans le texte de 50 ANS sur Joseph H Lewis, je parle de l’ambiance nocturne de THE HALLYDAY BRAND, ce western dont le début renvoie aux FURIES de Mann. En le revoyant dans une belle copie en dvd, le terme m’a paru un peu inexact et pourtant pas si faux que cela. Il y a peu de scènes de nuit, même si elles sont fortes (le plan des lyncheurs courant vers la prison) mais si j’ai utilisé ce terme, c’est que le film dégage une impression de claustrophobie, d’étouffement plus associée au film noir qu’au western. Toujours de Lewis, A LADY WITHOUT PASSPORT comprend deux ou trois séquences fort bien filmées, en dehors du premier plan d’ouverture, exceptionnel (le meurtre commis par Hodiak), de beaux extérieurs filmés à la Havane, deux ou trois décors intéressants, plusieurs plans très élégants, très recherchés qui, étrangement, soulignent le manque de tension dramatique. Le scénario cafouille et entre les acteurs que nous (je) qualifions d’exécrables (le terme est un poil fort), il ne se passe RIEN. Hedy Lamar qui joue une réfugiée qui attend ses papiers parait distante, peu concernée, jamais angoissée. Son interprétation est sidérante et il n’y a aucune alchimie avec Hodiak (qui ressemble à Martin Landau). Petit point intéressant : les étrangers sont regardés avec une grande sympathie. FILM AUSSI ETRANGE QUE RATÉ.
Toujours de Lewis, A LADY WITHOUT PASSPORT comprend deux ou trois séquences fort bien filmées, en dehors du premier plan d’ouverture, exceptionnel (le meurtre commis par Hodiak), de beaux extérieurs filmés à la Havane, deux ou trois décors intéressants, plusieurs plans très élégants, très recherchés qui, étrangement, soulignent le manque de tension dramatique. Le scénario cafouille et entre les acteurs que nous (je) qualifions d’exécrables (le terme est un poil fort), il ne se passe RIEN. Hedy Lamar qui joue une réfugiée qui attend ses papiers parait distante, peu concernée, jamais angoissée. Son interprétation est sidérante et il n’y a aucune alchimie avec Hodiak (qui ressemble à Martin Landau). Petit point intéressant : les étrangers sont regardés avec une grande sympathie. FILM AUSSI ETRANGE QUE RATÉ. J’ai enfin vu DOWN THREE DARK STREETS d’Arnold Laven. En fait de dark streets, on a une autoroute, une forêt, une rue normale de jour, un parc. Il y a au contraire pénurie de ruelles obscures (une seule en fait + un cimetière). Le film écrit par the Gordons (???) est l’une de ces apologies claironnantes et hébétées du FBI que souligne un commentaire exaspérant.
J’ai enfin vu DOWN THREE DARK STREETS d’Arnold Laven. En fait de dark streets, on a une autoroute, une forêt, une rue normale de jour, un parc. Il y a au contraire pénurie de ruelles obscures (une seule en fait + un cimetière). Le film écrit par the Gordons (???) est l’une de ces apologies claironnantes et hébétées du FBI que souligne un commentaire exaspérant. Revu : MAIL ORDER BRIDE, vraiment agréable, détendu, lyrique. C’est une sorte de version rose de COUPS DE FEU DANS LA SIERRA. Dans le dernier tiers, le scénario est parfois attendu et le gunfight final malgré le brouillard est un peu soldé.
Revu : MAIL ORDER BRIDE, vraiment agréable, détendu, lyrique. C’est une sorte de version rose de COUPS DE FEU DANS LA SIERRA. Dans le dernier tiers, le scénario est parfois attendu et le gunfight final malgré le brouillard est un peu soldé. Vu enfin (???) DESTRY. Ce que l’on en dit est juste. Marie Blanchard est pire qu’inexpressive et les numéros sont d’une grande banalité où l’on retrouve la manie de Marshall d’ajouter des ponctuations comiques dont certaines sont d’une lourdeur éprouvante. Surtout que certains de ces gags (il faudra le noter quelque part) ne semblent avoir aucun effet sur la musique, les musiciens, la chanteuse (en dehors des deux ou trois types qu’elle prend à partie) qui ont dû être filmés à part, avec un playback qui n’intégrait aucune de ces trouvailles. Les décors du film sont particulièrement plats et conventionnels (trait commun aux westerns de série Universal) : ville standard, intérieurs hideux et conventionnels sans la moindre idée visuelle. Ce qui permet de saluer encore plus chaleureusement les efforts des réalisateurs (Mann avec FAR COUNTRY) qui rompent avec ces conventions épuisantes.
Vu enfin (???) DESTRY. Ce que l’on en dit est juste. Marie Blanchard est pire qu’inexpressive et les numéros sont d’une grande banalité où l’on retrouve la manie de Marshall d’ajouter des ponctuations comiques dont certaines sont d’une lourdeur éprouvante. Surtout que certains de ces gags (il faudra le noter quelque part) ne semblent avoir aucun effet sur la musique, les musiciens, la chanteuse (en dehors des deux ou trois types qu’elle prend à partie) qui ont dû être filmés à part, avec un playback qui n’intégrait aucune de ces trouvailles. Les décors du film sont particulièrement plats et conventionnels (trait commun aux westerns de série Universal) : ville standard, intérieurs hideux et conventionnels sans la moindre idée visuelle. Ce qui permet de saluer encore plus chaleureusement les efforts des réalisateurs (Mann avec FAR COUNTRY) qui rompent avec ces conventions épuisantes. Après deux ou trois westerns Universal, les qualités du splendide APACHE DRUMS deviennent encore plus frappantes : topographie insolite du village, rapports intérieurs/extérieurs, décors inhabituels comme cette église (importance là du producteur, de Val Lewton car les décors de THE RAID, film par ailleurs intéressant, sont beaucoup plus conventionnels). Je trouve maintenant que l’intérêt porté à la topographie, la localisation d’un village, d’une bourgade trace une ligne de démarcation entre les westerns où l’ambition est évidente et les autres. Dans la première catégorie, celle où les auteurs se sont posés des questions quant à l’état d’une ville à l’époque, je range CANYON PASSAGE, APACHE DRUMS, SADDLE THE WIND, THE GUNFIGHTER avec leurs rues inachevées, les constructions asymétriques.
Après deux ou trois westerns Universal, les qualités du splendide APACHE DRUMS deviennent encore plus frappantes : topographie insolite du village, rapports intérieurs/extérieurs, décors inhabituels comme cette église (importance là du producteur, de Val Lewton car les décors de THE RAID, film par ailleurs intéressant, sont beaucoup plus conventionnels). Je trouve maintenant que l’intérêt porté à la topographie, la localisation d’un village, d’une bourgade trace une ligne de démarcation entre les westerns où l’ambition est évidente et les autres. Dans la première catégorie, celle où les auteurs se sont posés des questions quant à l’état d’une ville à l’époque, je range CANYON PASSAGE, APACHE DRUMS, SADDLE THE WIND, THE GUNFIGHTER avec leurs rues inachevées, les constructions asymétriques.
 Les deux westerns de Marshall que j’ai trouvé intéressants sont LES PILIERS DU CIEL, dont les extérieurs, les paysages témoignent d’une réelle recherche et donnent un lyrisme à cette histoire de tolérance religieuse. Et THE GUNS OF FORT PETTICOAT (LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE), assez plaisante histoire (après un début conventionnel) qui confronte Murphy à des dizaines de femmes, dont l’impressionnante Hope Emerson, qui doivent se défendre contre les Indiens. Et aussi contre des hors la loi qui font preuve d’une violence rare chez Marshall. Le tout dans un décor de mission en ruines (celui de l’HOMME DE SAN CARLOS ?) bien choisi et astucieusement utilisé.
Les deux westerns de Marshall que j’ai trouvé intéressants sont LES PILIERS DU CIEL, dont les extérieurs, les paysages témoignent d’une réelle recherche et donnent un lyrisme à cette histoire de tolérance religieuse. Et THE GUNS OF FORT PETTICOAT (LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE), assez plaisante histoire (après un début conventionnel) qui confronte Murphy à des dizaines de femmes, dont l’impressionnante Hope Emerson, qui doivent se défendre contre les Indiens. Et aussi contre des hors la loi qui font preuve d’une violence rare chez Marshall. Le tout dans un décor de mission en ruines (celui de l’HOMME DE SAN CARLOS ?) bien choisi et astucieusement utilisé. CROWDED DAY, chronique unanimiste, douce-amère, décrivant une journée dans la vie de 5 vendeuses travaillant dans un grand magasin. Je ne pensais pas que Guillermin que je voyais spécialisé dans le film d’action, le polar, avait abordé ce genre de sujets. Cette petite production indépendante vit hélas son exploitation bloquée par l’étroitesse d’esprit, l’impérialisme des deux grands circuits de salles qui interdisaient l’accès des Gaumont, des Odéon à ce type de films, bloquant tout renouvellement.
CROWDED DAY, chronique unanimiste, douce-amère, décrivant une journée dans la vie de 5 vendeuses travaillant dans un grand magasin. Je ne pensais pas que Guillermin que je voyais spécialisé dans le film d’action, le polar, avait abordé ce genre de sujets. Cette petite production indépendante vit hélas son exploitation bloquée par l’étroitesse d’esprit, l’impérialisme des deux grands circuits de salles qui interdisaient l’accès des Gaumont, des Odéon à ce type de films, bloquant tout renouvellement.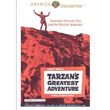 Toujours de Guillermin, j’ai revu avec plaisir malgré un transfert très discutable (même si Ted Scaife est un chef opérateur conventionnel. Dans son équipe, il y a Gerry Fischer) TARZAN GREATEST ADVENTURE (la PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN), le meilleur – de loin – des Tarzan récents. Celui, en outre, qui est le plus fidèle au personnage créé par Edgar Rice Burrough. En effet, dans cette version, Tarzan parle normalement, ne s’exprime pas en petit nègre. Il a l’air intelligent, éduqué. Dès la séquence pré générique, d’une réelle violence, très bien filmée, Guillermin (qui co-écrit le scénario) multiplie les travellings dans la jungle, les mouvements de grue, joue avec les amorces, la profondeur de champ. Le combat final est très bien mis en scène, avec ce recadrage au-dessus du vide. Formidable trio de « méchants » : Anthony Quayle, acteur shakespearien, Niall McGinnis et…Sean Connery. L’avant dernier plan est savoureux. Tarzan regarde son reflet dans l’eau et sourit.
Toujours de Guillermin, j’ai revu avec plaisir malgré un transfert très discutable (même si Ted Scaife est un chef opérateur conventionnel. Dans son équipe, il y a Gerry Fischer) TARZAN GREATEST ADVENTURE (la PLUS GRANDE AVENTURE DE TARZAN), le meilleur – de loin – des Tarzan récents. Celui, en outre, qui est le plus fidèle au personnage créé par Edgar Rice Burrough. En effet, dans cette version, Tarzan parle normalement, ne s’exprime pas en petit nègre. Il a l’air intelligent, éduqué. Dès la séquence pré générique, d’une réelle violence, très bien filmée, Guillermin (qui co-écrit le scénario) multiplie les travellings dans la jungle, les mouvements de grue, joue avec les amorces, la profondeur de champ. Le combat final est très bien mis en scène, avec ce recadrage au-dessus du vide. Formidable trio de « méchants » : Anthony Quayle, acteur shakespearien, Niall McGinnis et…Sean Connery. L’avant dernier plan est savoureux. Tarzan regarde son reflet dans l’eau et sourit.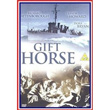 Je viens de revoir GIFT HORSE (COMMANDO SUR SAINT NAZAIRE sans sous titres) que je n’avais guère aimé lorsque je l’avais vu a douze ou treize ans. Et j’ai été touché, intéressé maintenant par tout ce qui m’avait rebuté. J’avais déploré le manque d’action, d’héroïsme, le fait que le raid mentionné dans le titre français n’occupait que les 20 dernières minutes, ce qui serait inimaginable maintenant. Or justement ce qui donne au film une force, c’est l’importance de l’attente, des échecs répétés à la suite d’erreurs humaines ou mécaniques (rien ne semble marcher dans ce foutu destroyer : les canons s’enrayent, les tuyaux crèvent). Le capitaine Fraser se trompe, l’un de ses officiers commet une bourde énorme. Rarement films de guerre et de propagande auront autant mis en valeur les cafouillages, les accidents, les obstacles que les britanniques. C’est ce que ce GIFT HORSE réussit, et cela jusqu’à la fin. Un internaute qui m’a convaincu de voir le film loue son absolue authenticité (les bateaux, l’armement ne sont pas postérieurs à l’époque, contrairement à tant de films), insiste sur cette absence d’héroïsme, sur la mauvais qualité du matériel. Sur l’interprétation impeccable de Trevor Howard.
Je viens de revoir GIFT HORSE (COMMANDO SUR SAINT NAZAIRE sans sous titres) que je n’avais guère aimé lorsque je l’avais vu a douze ou treize ans. Et j’ai été touché, intéressé maintenant par tout ce qui m’avait rebuté. J’avais déploré le manque d’action, d’héroïsme, le fait que le raid mentionné dans le titre français n’occupait que les 20 dernières minutes, ce qui serait inimaginable maintenant. Or justement ce qui donne au film une force, c’est l’importance de l’attente, des échecs répétés à la suite d’erreurs humaines ou mécaniques (rien ne semble marcher dans ce foutu destroyer : les canons s’enrayent, les tuyaux crèvent). Le capitaine Fraser se trompe, l’un de ses officiers commet une bourde énorme. Rarement films de guerre et de propagande auront autant mis en valeur les cafouillages, les accidents, les obstacles que les britanniques. C’est ce que ce GIFT HORSE réussit, et cela jusqu’à la fin. Un internaute qui m’a convaincu de voir le film loue son absolue authenticité (les bateaux, l’armement ne sont pas postérieurs à l’époque, contrairement à tant de films), insiste sur cette absence d’héroïsme, sur la mauvais qualité du matériel. Sur l’interprétation impeccable de Trevor Howard. THE LONG, THE TALL AND THE SHORT de Leslie Norman est visiblement l’adaptation d’une pièce de théâtre. Et cela se sent. Les grands travellings dans la jungle ne suffisent pas à rendre cinématographiques ces pesants débats d’idées, lourdingues, sur dramatisés qui restent théoriques malgré une distribution où l’on remarque un jeune Richard Harris et Laurence Harvey. Statique et ennuyeux.
THE LONG, THE TALL AND THE SHORT de Leslie Norman est visiblement l’adaptation d’une pièce de théâtre. Et cela se sent. Les grands travellings dans la jungle ne suffisent pas à rendre cinématographiques ces pesants débats d’idées, lourdingues, sur dramatisés qui restent théoriques malgré une distribution où l’on remarque un jeune Richard Harris et Laurence Harvey. Statique et ennuyeux. ICE COLD IN ALEX de Jack Lee Thompson est beaucoup plus intéressant et transcende un sujet qui pourrait être conventionnel (4 personnes perdues dans le désert). On sent la chaleur, le poids du désert, la fatigue, la sueur sur la peau. John Mills en officier alcoolique (encore un héros en état de faiblesse) est beaucoup plus convaincant que d’habitude et Sylvia Syms confirme, une fois de plus, le bien que j’ai pu dire d’elle. Elle est même très sexy dans ce film d’homme et elle évoque dans les bonus ce tournage qui fut épuisant. Il paraît qu’une scène d’amour entre Mills et elle fut coupée, car sa chemise était trop ouverte.
ICE COLD IN ALEX de Jack Lee Thompson est beaucoup plus intéressant et transcende un sujet qui pourrait être conventionnel (4 personnes perdues dans le désert). On sent la chaleur, le poids du désert, la fatigue, la sueur sur la peau. John Mills en officier alcoolique (encore un héros en état de faiblesse) est beaucoup plus convaincant que d’habitude et Sylvia Syms confirme, une fois de plus, le bien que j’ai pu dire d’elle. Elle est même très sexy dans ce film d’homme et elle évoque dans les bonus ce tournage qui fut épuisant. Il paraît qu’une scène d’amour entre Mills et elle fut coupée, car sa chemise était trop ouverte.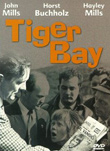 A propos de Lee Thompson, dont j’ai acheté TIGER BAY mais ne parvient pas à trouver ses premiers films qui ont une bonne réputation (WOMAN IN A DRESSING GOWN) et font oublier les productions avec Charles Bronson, mon ami Jean Pierre Coursodon m’écrit qu’il a regardé « un film que je n’avais jamais vu et que tu couvres de ridicule dans 50 ANS: EYE OF THE DEVIL et à ma surprise je ne l’ai pas trouvé si mauvais. La « population hébétée » dont tu parlais, on la voit environ 3 minutes en tout, maximum. Je suis plus dérangé par la convention qui fait que des acteurs 100 % britanniques sont censés être français, mais on s’y habitue. Le film est assez grandiloquent (Tourneur l’aurait dirigé de façon différente!) mais le genre le veut. L’histoire n’est pas plus extravagante que EYES WIDE SHUT. Le château est remarquablement utilisé, intérieurs et extérieurs, la photo est excellente, avec beaucoup de profondeur de champ. L’incohérence due aux coupures ne peut pas être impliquée au pauvre réalisateur (il y en a quand même une de taille, quand Deborah Kerr tombe du haut du château et apparait intacte dans le plan suivant). Je ne cherche pas à réhabiliter Lee Thompson mais je trouve que tu étais un peu injuste.
A propos de Lee Thompson, dont j’ai acheté TIGER BAY mais ne parvient pas à trouver ses premiers films qui ont une bonne réputation (WOMAN IN A DRESSING GOWN) et font oublier les productions avec Charles Bronson, mon ami Jean Pierre Coursodon m’écrit qu’il a regardé « un film que je n’avais jamais vu et que tu couvres de ridicule dans 50 ANS: EYE OF THE DEVIL et à ma surprise je ne l’ai pas trouvé si mauvais. La « population hébétée » dont tu parlais, on la voit environ 3 minutes en tout, maximum. Je suis plus dérangé par la convention qui fait que des acteurs 100 % britanniques sont censés être français, mais on s’y habitue. Le film est assez grandiloquent (Tourneur l’aurait dirigé de façon différente!) mais le genre le veut. L’histoire n’est pas plus extravagante que EYES WIDE SHUT. Le château est remarquablement utilisé, intérieurs et extérieurs, la photo est excellente, avec beaucoup de profondeur de champ. L’incohérence due aux coupures ne peut pas être impliquée au pauvre réalisateur (il y en a quand même une de taille, quand Deborah Kerr tombe du haut du château et apparait intacte dans le plan suivant). Je ne cherche pas à réhabiliter Lee Thompson mais je trouve que tu étais un peu injuste.