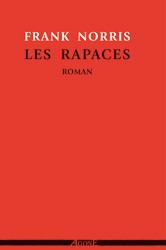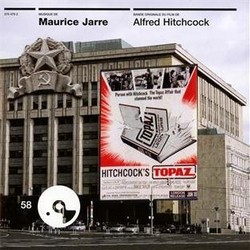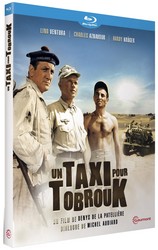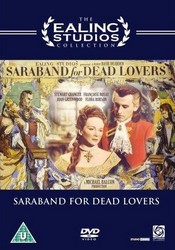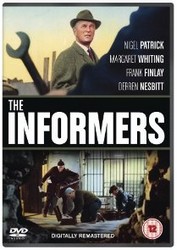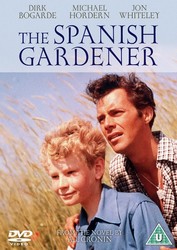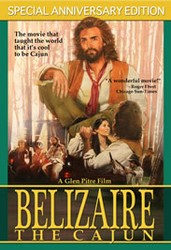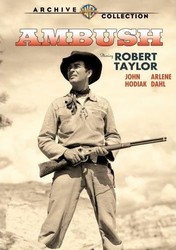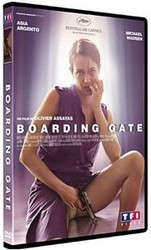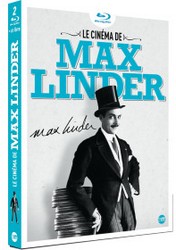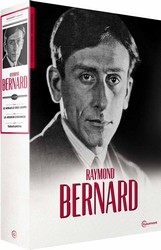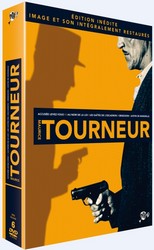LIVRES
Commençons par recommander quelques livres et notamment les deux magnifiques romans de Frank Norris, disciple de Zola, LE GOUFFRE (THE PIT) et LES RAPACES (McTEAGUE) qui viennent enfin d’être traduits en français. LE GOUFFRE (Les Editions du Sonneur) qui sortit en 1903 est un ouvrage incroyablement précis, épique et prémonitoire sur la Bourse, la spéculation (en l’occurrence du blé). Les descriptions des séances à la Bourse sont magistrales. On est emporté par un vrai souffle qui se marie à une précision remarquable. Toutes aussi réussies sont les évocations de la vie mondaine à Chicago, au début du siècle avec ce si touchant portrait de jeune femme idéaliste. Le livre appartient à la trilogie de l’épopée du blé qui ne comprend que deux titres, THE PIT et THE OCTOPUS, Norris mourut avant d’attaquer le troisième titre, THE WOLF. C’est Robert Parrish qui, le premier, me parla de cette trilogie. Il avait voulu adapter THE PIT ou THE OCTOPUS, je ne me souviens plus, mais ce projet avait été refusé. Paru chez Agone, valeureuse maison d’éditions qui a publié un grand nombre de recueils essentiels de George Orwell, LES RAPACES fait partie de la trilogie de San Francisco et inspira le chef d’œuvre de Stroheim.
J’ai aussi retenu le très passionnant, très étonnant, L’AUTRE VIE D’ORWELL de Jean-Pierre Martin chez Gallimard. J’ai découvert quelle incroyable existence menait Orwell sur l’Ile du Jura, en Écosse (où l’on fait un malt remarquable), sa lutte contre la Nature, son incroyable énergie physique. C’est là qu’il écrivit 1984.
Ne manquez pas le DICTIONNAIRE DES INJURES LITTÉRAIRES de Pierre Chalmin qui contient un nombre incalculable de vannes, mots d’esprits, saillies désopilantes. Parfois justes et incisives comme ce trait de Jeanson qui demandant à Berl quelles étaient les fonctions de Malraux, se voyait répondre : « Oh, rien de plus simple. Il s’efforce de mettre du désordre dans un ministère qui n’existe pas » ou alors Vialatte, toujours sur Malraux : « Malraux ne se détend jamais. Il voit le comique et ne prend pas le temps d’en rire » ou « Il y a deux façons de ne pas aimer la poésie. La première est de ne pas l’aimer, l’autre est de lire Pope ». Il y a certaines vacheries (de Léautaud, Céline) qui discréditent plus leurs auteurs que leurs cibles.
Enfin je ne saurais trop conseiller L’ANTI-BAZIN de Gérard Gozlan, pamphlet qui fut publié dans deux numéros de Positif et qui déconstruit les interprétations théologiques chères à Bazin, montre leurs limites, voire leur fausseté. Préface persifleuse de Bernard Chardère (éditions Le Bord de l’Eau).
MUSIQUE
Passons à quelques CD que vient de faire sortir Stéphane Lerouge : Le Cinéma de Maurice Jarre, coffret de 4 CD qui regroupe aussi bien les films français (LES YEUX SANS VISAGE, THÉRÈSE DESQUEYROUX, LE PRÉSIDENT) que les américains. Toujours de Jarre, un autre CD entièrement consacré à TOPAZ (L’ÉTAU) et un enfin qui nous permet d’écouter ce que Georges Delerue composa pour Melville (L’AINÉ DES FERCHAUX, film très décevant, en dessous du livre de Simenon) et la partition de Michel Colombier (à qui on doit UNE CHAMBRE EN VILLE) pour UN FLIC. Deux assez belles musiques pour deux films plutôt ratés.
PLACE AU CINÉMA
 Il est bon parfois d’aller revisiter les « classiques » et l’on peut avoir de fort belles surprises. Le magnifique Blu-ray, issu de la restauration exemplaire des ENFANTS DU PARADIS, nous permet de redécouvrir un film qu’on croyait pourtant connaître. Le nettoyage de la bande sonore rend toute sa force, toute son invention, toutes ses fulgurances aux dialogues de Jacques Prévert. J’ai eu l’impression de les entendre enfin dans tout leur éclat. Le personnage et le jeu d’Arletty prennent une force, une urgence nouvelles. L’œuvre est littéralement portée par une vibration, une sensibilité très féministe, d’une grande liberté par rapport à tous les interdits (il est curieux de voir comment le cinéma français, volontiers misogyne dans les années 30, devint beaucoup plus féministe aux approches de la guerre et durant l’Occupation : pensez à DOUCE, au MARIAGE DE CHIFFON, aux Grémillon ; on reconnaît là la patte d’Aurenche, de Prévert) et cela alors que la France était soumise à une idéologie réactionnaire, machiste. Toutes les réactions d’Arletty sont exemplaires dans leur vivacité, leur gouaille libertaire. Garance est une vraie femme libre et elle le reste. On sent le film porté par un souffle anarchiste. L’interprétation du film est d’ailleurs magistrale (sauf une Maria Casarès que l’on sent coincée, mal dirigée, dans un personnage trop passif), de Louis Salou à l’inoubliable Marcel Herrand en passant par Pierre Renoir. On sait d’ailleurs que tous les rôles furent distribués par Prévert. Mais la restauration permet aussi de mieux saluer le soin maniaque de Carné, ses exigences (les mouvements de figuration sont magnifiques, jamais scolaires ou figés et le décor est superbement mis en valeur) et son grand talent dans le découpage, ici extrêmement fluide.
Il est bon parfois d’aller revisiter les « classiques » et l’on peut avoir de fort belles surprises. Le magnifique Blu-ray, issu de la restauration exemplaire des ENFANTS DU PARADIS, nous permet de redécouvrir un film qu’on croyait pourtant connaître. Le nettoyage de la bande sonore rend toute sa force, toute son invention, toutes ses fulgurances aux dialogues de Jacques Prévert. J’ai eu l’impression de les entendre enfin dans tout leur éclat. Le personnage et le jeu d’Arletty prennent une force, une urgence nouvelles. L’œuvre est littéralement portée par une vibration, une sensibilité très féministe, d’une grande liberté par rapport à tous les interdits (il est curieux de voir comment le cinéma français, volontiers misogyne dans les années 30, devint beaucoup plus féministe aux approches de la guerre et durant l’Occupation : pensez à DOUCE, au MARIAGE DE CHIFFON, aux Grémillon ; on reconnaît là la patte d’Aurenche, de Prévert) et cela alors que la France était soumise à une idéologie réactionnaire, machiste. Toutes les réactions d’Arletty sont exemplaires dans leur vivacité, leur gouaille libertaire. Garance est une vraie femme libre et elle le reste. On sent le film porté par un souffle anarchiste. L’interprétation du film est d’ailleurs magistrale (sauf une Maria Casarès que l’on sent coincée, mal dirigée, dans un personnage trop passif), de Louis Salou à l’inoubliable Marcel Herrand en passant par Pierre Renoir. On sait d’ailleurs que tous les rôles furent distribués par Prévert. Mais la restauration permet aussi de mieux saluer le soin maniaque de Carné, ses exigences (les mouvements de figuration sont magnifiques, jamais scolaires ou figés et le décor est superbement mis en valeur) et son grand talent dans le découpage, ici extrêmement fluide.
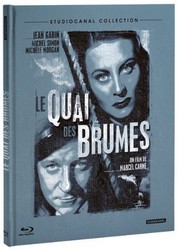 Je croyais aussi connaître QUAI DES BRUMES et j’ai été cueilli par la mélancolie noire et rêveuse (le récit a des allures de rêve éveillé), la beauté plastique de la photo, des décors de Trauner. C’est un film de personnages (et quels personnages ! un Michel Simon inouï de noirceur visqueuse, Aimos, le Vigan) plus que d’intrigue (laquelle ne paraît pas toujours logique), des personnages qui avancent en se carambolant les uns les autres comme les auto-tamponneuses où Gabin emmène Morgan. Ce qui nous vaut l’une des plus belles gifles de l’histoire du cinéma. Michèle Morgan me disait que Gabin, exaspéré par la conduite de Brasseur qui la veille avait été mufle avec elle, ne l’avait pas du tout truquée ni amortie. Ce qui explique sa violence. Extraordinaire musique, dont on ne parle pas assez, de Maurice Jaubert. Et là encore découpage incisif de Carné qui sera encore plus inspiré dans LE JOUR SE LÈVE.
Je croyais aussi connaître QUAI DES BRUMES et j’ai été cueilli par la mélancolie noire et rêveuse (le récit a des allures de rêve éveillé), la beauté plastique de la photo, des décors de Trauner. C’est un film de personnages (et quels personnages ! un Michel Simon inouï de noirceur visqueuse, Aimos, le Vigan) plus que d’intrigue (laquelle ne paraît pas toujours logique), des personnages qui avancent en se carambolant les uns les autres comme les auto-tamponneuses où Gabin emmène Morgan. Ce qui nous vaut l’une des plus belles gifles de l’histoire du cinéma. Michèle Morgan me disait que Gabin, exaspéré par la conduite de Brasseur qui la veille avait été mufle avec elle, ne l’avait pas du tout truquée ni amortie. Ce qui explique sa violence. Extraordinaire musique, dont on ne parle pas assez, de Maurice Jaubert. Et là encore découpage incisif de Carné qui sera encore plus inspiré dans LE JOUR SE LÈVE.
On tombe un peu de haut avec DU MOURON POUR LES PETITS OISEAUX, pochade populiste comique autour d’un butin caché (écrite par un Jacques Sigurd qui lorgne vers Lautner) avec des acteurs sous-employés (Suzy Delair) ou stéréotypés (Meurisse dans ses tics), des personnages en toc, à l’exception de Suzanne Gabrielo, épatante en concierge, Mme Communal (sic), un des meilleurs personnages du film – avec Lesaffre en « protestant siphonné » -, film qui reste très décevant.
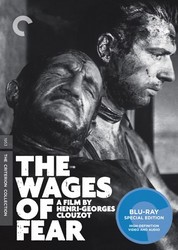 J’ai revu une grande partie du SALAIRE DE LA PEUR, dans l’édition américaine sortie par Criterion. Magnifique copie, bonus remarquables, en particulier un livret écrit par Dennis Lehane (le romancier de MYSTIC RIVER, de TÉNÈBRES, PRENEZ-MOI LA MAIN), grand admirateur de Clouzot. J’y ai appris que le film fut jugé tellement anti-américain (Time Magazine le qualifia d’œuvre diabolique ou un truc comme ça), qu’il dut attendre deux ans avant d’être distribué dans une version très coupée qui ne fut restaurée qu’en 1996. Dès l’ouverture une belle surprise avec cet enfant qui joue avec un insecte, plan qui influença, inspira le Peckinpah de THE WILD BUNCH (LA HORDE SAUVAGE). Chez Clouzot, la notation est plus subtile et se déroule en plusieurs temps. Le gamin est interrompu dans son jeu par un marchand de glaces, parade avec sa proie avant de l’achever. En fait toute la première partie, si forte, si rude, si âpre est moins anti-américaine (encore que les ravages de l’exploitation capitaliste sur la Nature et le sol soient dénoncés de manière si prémonitoire) qu’anti-espèce humaine dont les représentants sont prêts à tous les compromis, toutes les lâchetés. Et il faut immédiatement corriger cette assertion trop dogmatique, car Clouzot sait faire preuve de compassion, de solidarité, d’amitié envers certains personnages (celui que joue Véra Clouzot), certains gestes, certaines réactions de Montand, des paysans exploités (on se souvient de Larquey dans QUAI DES ORFÈVRES). Vanel est, une fois encore, totalement génial. A Lyon, nous avions appris que c’était René Wheeler qui avait donné l’idée si belle, si forte de la « fausse apparence » de ce soi disant caïd qui va s’effriter, se délabrer. Travail incroyable de mise en scène (qui dut jongler avec un temps pourri) qui nous fait accepter une Amérique du Sud rêvée en Camargue. Lire le texte splendide du frère de Clouzot dans MOTS D’AUTEURS, JEUX D’ACTEURS (Actes Sud Institut Lumière) qui raconte les difficultés que posait l’adaptation. Voilà un texte indispensable aux futurs scénaristes.
J’ai revu une grande partie du SALAIRE DE LA PEUR, dans l’édition américaine sortie par Criterion. Magnifique copie, bonus remarquables, en particulier un livret écrit par Dennis Lehane (le romancier de MYSTIC RIVER, de TÉNÈBRES, PRENEZ-MOI LA MAIN), grand admirateur de Clouzot. J’y ai appris que le film fut jugé tellement anti-américain (Time Magazine le qualifia d’œuvre diabolique ou un truc comme ça), qu’il dut attendre deux ans avant d’être distribué dans une version très coupée qui ne fut restaurée qu’en 1996. Dès l’ouverture une belle surprise avec cet enfant qui joue avec un insecte, plan qui influença, inspira le Peckinpah de THE WILD BUNCH (LA HORDE SAUVAGE). Chez Clouzot, la notation est plus subtile et se déroule en plusieurs temps. Le gamin est interrompu dans son jeu par un marchand de glaces, parade avec sa proie avant de l’achever. En fait toute la première partie, si forte, si rude, si âpre est moins anti-américaine (encore que les ravages de l’exploitation capitaliste sur la Nature et le sol soient dénoncés de manière si prémonitoire) qu’anti-espèce humaine dont les représentants sont prêts à tous les compromis, toutes les lâchetés. Et il faut immédiatement corriger cette assertion trop dogmatique, car Clouzot sait faire preuve de compassion, de solidarité, d’amitié envers certains personnages (celui que joue Véra Clouzot), certains gestes, certaines réactions de Montand, des paysans exploités (on se souvient de Larquey dans QUAI DES ORFÈVRES). Vanel est, une fois encore, totalement génial. A Lyon, nous avions appris que c’était René Wheeler qui avait donné l’idée si belle, si forte de la « fausse apparence » de ce soi disant caïd qui va s’effriter, se délabrer. Travail incroyable de mise en scène (qui dut jongler avec un temps pourri) qui nous fait accepter une Amérique du Sud rêvée en Camargue. Lire le texte splendide du frère de Clouzot dans MOTS D’AUTEURS, JEUX D’ACTEURS (Actes Sud Institut Lumière) qui raconte les difficultés que posait l’adaptation. Voilà un texte indispensable aux futurs scénaristes.
J’ai profité de la sortie du magnifique THÉRÈSE DESQUEYROUX de Claude Miller pour revoir la version de Franju (René Château, assez belle copie), dont les dialogues sont de François Mauriac. Le film a de réelles beautés, des fulgurances mais il m’a paru plus sage, moins inspiré, moins ardent que le Miller. Emmanuelle Riva, si juste, si aiguée dans LÉON MORIN PRÊTRE, est trop âgée pour le personnage, ce qui étouffe son urgence et sa flamme ce que rend génialement Audrey Tautou. Edith Scob, dont le personnage est mal écrit et bancal fait terne et appliquée à côté d’Anaïs Demoustier si lumineuse. En revanche, Philippe Noiret apporte une modernité, une profondeur, une subtilité qui élève le film (Gilles Lellouche est excellent dans le remake). Belle musique de Maurice Jarre et splendide phot en noir et blanc mais il y a quelque chose de figé dans cette œuvre.
Toujours chez René Château, signalons la sortie en DVD du passionnant MENACES d’Edmond T. Gréville, film inégal, chaotique avec des fulgurances, des audaces folles et de grands et subits bonheurs de mise en scène (le travelling avant sur le visage de Mireille Balin en train de téléphoner, la fin de Stroheim).
Si l’on peut passer très rapidement sur UNE JAVA de Claude Orval, pochade policière assez mal écrite et dialoguée, avec ici et là un personnage croqué de manière pittoresque (l’ivrogne qui finit tous les verres, « running gag » à la Tay Garnett) et aussi des acteurs faibles (Pierre Stephen). C’est filmé à la va comme je te pousse et l’on peut sauver Berval entonnant soudainement une chansonnette et surtout Fréhel qui chante la Java Bleue.
Henri Jeanson, Pascal Mérigeau, Paul Vecchiali ont tous trois parlé de 7 HOMMES ET UNE FEMME, écrit et réalisé par Yves Mirande. Le premier le trouve remarquable (déclarant avec drôlerie que Mirande qui s’est souvent noyé et qui a réussi à surnager, « est son propre terre-neuve »). Les deux autres notent les ressemblances entre ce film et LA RÈGLE DU JEU : arrivée d’invités à la campagne, partie de chasse, évocation du monde des maîtres et des domestiques, liaison entre des domestiques. Tous deux sont certains que Renoir a vu le film et s’en est inspiré. Cela saute aux yeux. Cela dit, les personnages chez Mirande restent prisonnier du canevas, des conventions et la réalisation (là, je suis moins élogieux que Vecchiali) est parfois approximative (moins dans les scènes d’extérieur). On enregistre les scènes plus qu’on les met en scène. Le résultat est plaisant, grâce aux comédiens comme Maurice Escande, Larquey (il faut le voir réciter tous les travaux d’Hercule, piéger les invités avec le nom des 9 Muses ou gagner à la belote contre Saturnin Fabre, lequel est toujours marrant même dans un personnage attendu de député qui déclare « avoir les opinions politiques de ses électeurs »). Ici et là quelques phrases qui font mouche : « méfiez vous », confie un domestique à une soubrette qui a une touche avec un boursicoteur, « les gens de la Bourse sont au plus bas en ce moment ». Un invité demande à un musicien qui joue du piano : « C’est de vous ? » ce à quoi un autre convive réplique : « Pas encore ». Mais faites un tour du côté de BACCARA (« De la finesse dans la finesse, voilà le secret d’un film impitoyable et drôlement secret. Un chef d’œuvre indiscutable, écrit Vecchiali dans l’Encinéclopédie), et de DERRIÈRE LA FAÇADE.
 Changeons de registre avec le magnifique PETIT PRINCE A DIT de Christine Pascal (Gaumont Collection Rouge), aigu, déchirant, tranchant. « Je voudrais une poésie qui soit dure et consolatrice » écrivait le grand poète Jean Pérol. Ces termes conviennent au PETIT PRINCE, aux rapports entre les personnages. Le moment où Berry, qui a poussé sa fille à nager jusqu’à l’épuisement, la prend dans ses bras pour la réconforter, ces plans où on le découvre en train de comprendre ce qu’est la maladie de sa fille, vous poignent le cœur, vous brassent la cage comme on dit au Québec. Marie Kleiber est une des enfants les plus extraordinaires de l’histoire du cinéma. Son physique tout d’abord, aux antipodes des clichés et pourtant si original, son regard, la chaleur qu’elle dégage. Il faudrait écrire des pages pour louer l’intensité émotionnelle, l’absence de manipulation, la pureté déchirante de cette œuvre admirable. Espérons que vous serez nombreux à l’acheter pour que Gaumont lance une édition Collector en Blu-ray.
Changeons de registre avec le magnifique PETIT PRINCE A DIT de Christine Pascal (Gaumont Collection Rouge), aigu, déchirant, tranchant. « Je voudrais une poésie qui soit dure et consolatrice » écrivait le grand poète Jean Pérol. Ces termes conviennent au PETIT PRINCE, aux rapports entre les personnages. Le moment où Berry, qui a poussé sa fille à nager jusqu’à l’épuisement, la prend dans ses bras pour la réconforter, ces plans où on le découvre en train de comprendre ce qu’est la maladie de sa fille, vous poignent le cœur, vous brassent la cage comme on dit au Québec. Marie Kleiber est une des enfants les plus extraordinaires de l’histoire du cinéma. Son physique tout d’abord, aux antipodes des clichés et pourtant si original, son regard, la chaleur qu’elle dégage. Il faudrait écrire des pages pour louer l’intensité émotionnelle, l’absence de manipulation, la pureté déchirante de cette œuvre admirable. Espérons que vous serez nombreux à l’acheter pour que Gaumont lance une édition Collector en Blu-ray.
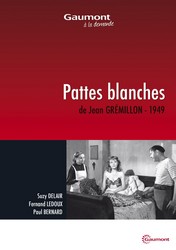 On faire le même souhait pour ce chef d’œuvre qu’est PATTES BLANCHES de Jean Grémillon, film maudit qui devrait retrouver enfin un public. Et ceux qui prennent de grands airs avec Anouilh (lequel devait réaliser le film) devraient étudier ce beau scénario, ces dialogues lyriques, tendus, inventifs avec ces éclairs de compassion, ces déchirements dont Michel Bouquet qui trouve son premier grand rôle, rend toutes les nuances, les délicatesses comme les éclairs d’âpreté. Le réalisateur ne cache pas son estime pour le travail entamé par Anouilh : « Je suis particulièrement sensible à la richesse, à la vigueur, à la cruauté du dialogue de Jean Anouilh dont j’ai la charge de faire un film. J’essaye, pour être le plus fidèle illustrateur de l’histoire de PATTES BLANCHES, d’utiliser au mieux les ressources de l’écriture cinématographique. » C’est peu dire qu’il ait réussi.
On faire le même souhait pour ce chef d’œuvre qu’est PATTES BLANCHES de Jean Grémillon, film maudit qui devrait retrouver enfin un public. Et ceux qui prennent de grands airs avec Anouilh (lequel devait réaliser le film) devraient étudier ce beau scénario, ces dialogues lyriques, tendus, inventifs avec ces éclairs de compassion, ces déchirements dont Michel Bouquet qui trouve son premier grand rôle, rend toutes les nuances, les délicatesses comme les éclairs d’âpreté. Le réalisateur ne cache pas son estime pour le travail entamé par Anouilh : « Je suis particulièrement sensible à la richesse, à la vigueur, à la cruauté du dialogue de Jean Anouilh dont j’ai la charge de faire un film. J’essaye, pour être le plus fidèle illustrateur de l’histoire de PATTES BLANCHES, d’utiliser au mieux les ressources de l’écriture cinématographique. » C’est peu dire qu’il ait réussi.
Voilà un film écrit et filmé à fleur de peau, avec une maitrise confondante de l’espace, une science du découpage. Quand je pense que les Cahiers parlaient de la « médiocrité grémillonnante » alors qu’on est face à un tourbillon de sentiments qui se heurte à une Nature qui semble les orchestrer. Arlette Thomas est magnifique de dignité, de lyrisme retenu. Paul Bernard, une fois encore, rare, s’aventurant dans des couleurs qu’on ne mettait pas en avant. Fernand Ledoux a cette force, cette probité qui permet d’enraciner cette histoire presque gothique. Magnifique musique d’Elsa Barraine (qui écrivit cette du SABOTIER DU VAL DE LOIRE de Demy), grande résistante, compositrice passionnante oubliée par le monde du disque. Je signale aussi, dans la même collection le fort beau FILS DU REQUIN d’Agnès Merlet, LA FILLE PRODIGUE (que j’avais beaucoup aimé) et LA FEMME QUI PLEURE, deux opus de Jacques Doillon. Que ceux qui n’ont jamais vu Dominique Laffin se ruent sur le second.
 Avant le début de LA TENDRE ENNEMIE, dans un ahurissant prologue, le vice-président des exploitants clame pompeusement sa fierté devant cette œuvre qu’il juge si originale, distribue des conseils pour mieux se laisser porter par ce conte de fées où les morts dialoguent avec les vivants et salue cette production si française. Il ne cite jamais le nom du réalisateur (Ophüls), de son scénariste (Curt Alexander), son chef opérateur (Eugen Schuftan). Cette comédie sentimentale avec fantômes est agréable, délicate mais un rien compassée. Il y a moins de modernité que dans les meilleurs moments de SANS LENDEMAIN.
Avant le début de LA TENDRE ENNEMIE, dans un ahurissant prologue, le vice-président des exploitants clame pompeusement sa fierté devant cette œuvre qu’il juge si originale, distribue des conseils pour mieux se laisser porter par ce conte de fées où les morts dialoguent avec les vivants et salue cette production si française. Il ne cite jamais le nom du réalisateur (Ophüls), de son scénariste (Curt Alexander), son chef opérateur (Eugen Schuftan). Cette comédie sentimentale avec fantômes est agréable, délicate mais un rien compassée. Il y a moins de modernité que dans les meilleurs moments de SANS LENDEMAIN.
 Je me suis enfin décidé à voir TOI, LE VENIN qui fut le grand succès commercial de Robert Hossein. Le thème jazzy du générique, écrit par André Gosselain alias André Hossein (la seule personne que j’ai vue brosser la peau d’une banane sous un robinet avant de l’ouvrir) fut un triomphe au box office. Le film est typique de tout un cinéma français : un décor quasi unique, en l’occurrence une villa sur la Côte d’Azur, peu de personnages (pour la plupart marginaux ou sans emploi… on a un peu de mal à croire que Robert Hossein fut producteur d’une émission de poésie), une intrigue de Frédéric Dard machinalement machiavélique dont on devine vite le dénouement. Peu de péripéties comme dans la plupart des films d’Hossein qui sont fondés sur l’attente. Et une sorte de puritanisme machiste. On voit mal, en dehors du révolver, ce qui traumatise le héros sinon ce sentiment que c’est lui qui s’est fait violer et qu’il doit se venger. Pas de sexe malgré l’accroche publicitaire et la présence toujours agréable de Marina Vlady.
Je me suis enfin décidé à voir TOI, LE VENIN qui fut le grand succès commercial de Robert Hossein. Le thème jazzy du générique, écrit par André Gosselain alias André Hossein (la seule personne que j’ai vue brosser la peau d’une banane sous un robinet avant de l’ouvrir) fut un triomphe au box office. Le film est typique de tout un cinéma français : un décor quasi unique, en l’occurrence une villa sur la Côte d’Azur, peu de personnages (pour la plupart marginaux ou sans emploi… on a un peu de mal à croire que Robert Hossein fut producteur d’une émission de poésie), une intrigue de Frédéric Dard machinalement machiavélique dont on devine vite le dénouement. Peu de péripéties comme dans la plupart des films d’Hossein qui sont fondés sur l’attente. Et une sorte de puritanisme machiste. On voit mal, en dehors du révolver, ce qui traumatise le héros sinon ce sentiment que c’est lui qui s’est fait violer et qu’il doit se venger. Pas de sexe malgré l’accroche publicitaire et la présence toujours agréable de Marina Vlady.
Gaumont vient par ailleurs de sortir en Blu-ray UN TAXI POUR TOBROUK (avec la désopilante bande annonce présentée par Léon Zitrone) et CENT MILLE DOLLARS AU SOLEIL de Denys de la Patellière et Verneuil. Deux films qui furent vilipendés par les jeunes turcs de la critique qui en avaient après Audiard, souvent très injustement. Je n’ai pas un très bon souvenir du second mais je vais les revoir tous les deux
Autre Blu-ray, celui-là indispensable : L’AVENTURIER DU RIO GRANDE de Robert Parrish.