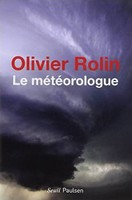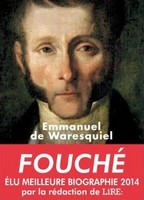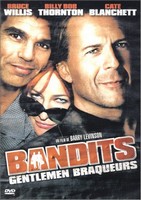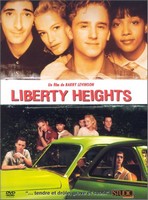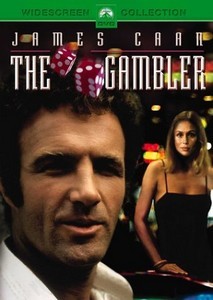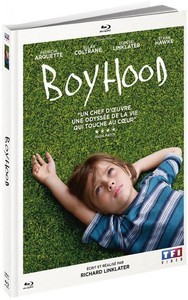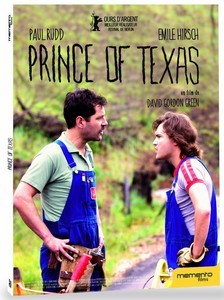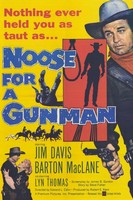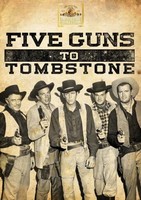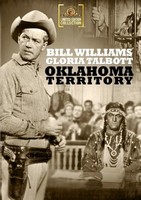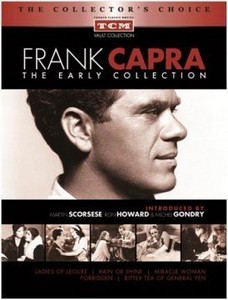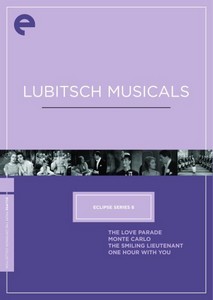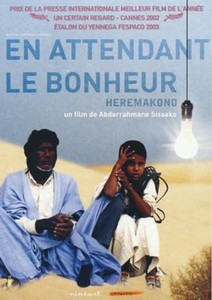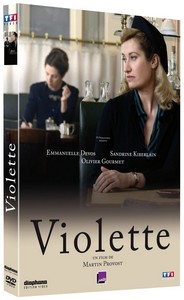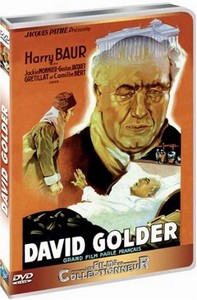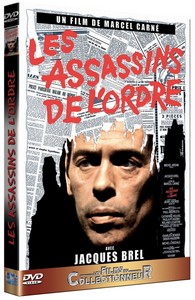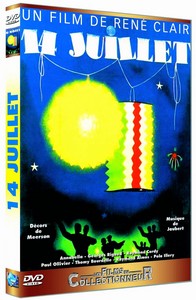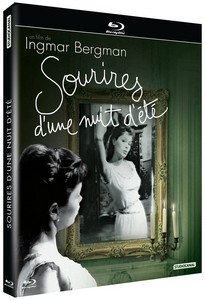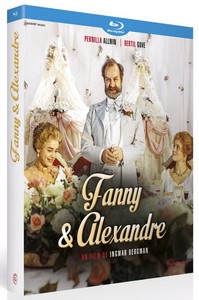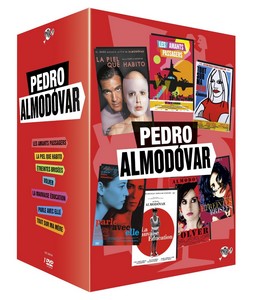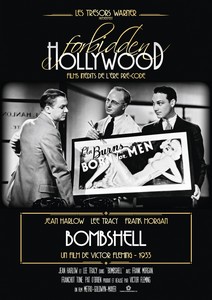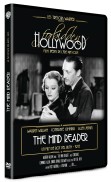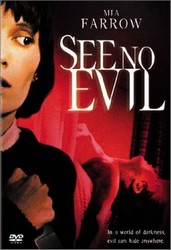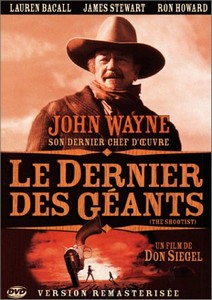LIVRES
MAURICE TOURNEUR de Christiane Leteux est un ouvrage passionnant où j’ai appris beaucoup de choses : le stupéfiant scandale causé par L’ÉQUIPAGE, le traitement de Richard Pottier au début de la guerre, l’importance de Carlo Rim qui a écrit AVEC LE SOURIRE, ce chef d’œuvre. Le livre donne envie de revoir les grands Tourneur muets mais défend aussi ses derniers titres.
L’IMPOSSIBLE RÉPARATION de Jean Marc Dreyfus sur le paiement des dommages de guerre. On découvre qu’il y avait plus de personnes avec la carte du parti nazi au Ministère des Affaires Etrangères allemand en 1951 qu’en 1940.
LE MÉTÉOROLOGUE d’Olivier Rolin, livre cinglant, émouvant, incroyable.
La dernière biographie de Joseph Fouché par Emmanuel de Waresquiel est un modèle du genre. Ce gros livre de 668 pages trace un portrait contrasté et subtil du personnage, fait la part belle à l’analyse psychologique et se fonde sur des sources nouvelles, provenant notamment d’archives privées. Il est sous titré : Les silences de la pieuvre. Fouché se révèle tour à tour monstre froid et calculateur, organisateur et administrateur hors pair, père attentif et sentimental…
De retour de Serbie, j’en profite pour redire tout le bien que je pense de certains films d’Emir Kusturica, CHAT NOIR, CHAT BLANC et j’ai revu la première heure d’UNDERGROUND qui est stupéfiante d’invention et de puissance. Dans cette manière de mêler les animaux à la guerre, à la violence, d’en faire les témoins, les victimes.
COFFRETS
Je voudrais d’abord signaler et recommander deux coffrets exceptionnels édités par Potemkine sur Kalatozov et Gleb Pamfilov. Du premier outre QUAND PASSENT LES CIGOGNES et SOY CUBA, il faut voir LA LETTRE INACHEVÉE, beaucoup moins connu. On y trouve de stupéfiants plans de Nature. La course des protagonistes dans une forêt en flammes est une très longue séquence qui n’a pas d’équivalents. Les personnages courent, marchent, luttent au milieu des flammes et de la fumée. Le scénario est un peu sommaire et il y a quelques plans pompiers vers la fin mais aussi des moments étranges quand les personnages errent dans les flammes avec une radio détraquée qui répète des télégrammes de félicitation.
Et chez Panfilov, cinéaste magistral, l’impressionnant JE DEMANDE LA PAROLE et LE THÈME, œuvre d’une originalité sidérante : dans la conduite du récit, dans les bifurcations que prend le scénario qui ménage de nombreuses surprises, dans un mélange incroyable de drôlerie, de cocasserie, de tension et de force émotionnelle qui surgit comme à l’improviste dans le dernier quart du film.
BARRY LEVINSON
 Le hasard et le travail d’approfondissement de 50 ANS DE CINEMA AMÉRICAIN m’ont conduit à revoir et parfois à voir plusieurs film de Barry Levinson, et l’on s’aperçoit qu’ils ont en commun une ironie sceptique et chaleureuse, une volonté de traiter en comédie des sujets politiques assez décapants avec une vision beaucoup plus démocrate que républicaine, beaucoup plus libertaire que consensuelle. Parfois aussi un manque d’exigence ou une propension à tirer vers la farce des péripéties qui auraient gagnées à s’arrêter avant. Le dernier tiers de WAG THE DOG/DES HOMMES D’INFLUENCE devient insistant et lourd alors que tout ce qui précède fait preuve d’une irrévérence et d’une invention cocasse quelque peu sous-estimée. Le service de communication réussit à inventer une guerre pour camoufler les frasques sexuelles du président (le film est antérieur à l’affaire Monica Lewinsky) avec l’aide d’un producteur interprété génialement par Dustin Hoffman. On sent d’ailleurs Levinson à l’aise avec les acteurs et Robin Williams, Laura Linney sont épatants dans le tout aussi caustique MAN OF THE YEAR, une sorte d’HOMME DANS LA FOULE inversé qui contient des moments très pertinents sur la création et la manipulation des images. Levinson a un flair pour les dialogues (il écrivit d’ailleurs un certains nombre de ses films) et sait leur donner de la vie. On retrouve ces mêmes qualités dans BANDITS qui contient des échanges désopilants entre Bruce Willis et Billy Bob Thornton en détenu hypocondriaque, sans oublier Cate Blanchett, formidable en épouse frustrée qui est ravie de se faire kidnapper et de rejoindre les malfaiteurs. Il en résulte une série de variation sur JULES ET JIM. Levinson parfois découpe trop et manque de confiance dans son matériau ce qui uniformise plusieurs séquences. DINER, plus autobiographique, est une vrai réussite, drôle, tendre, amère, révélant plusieurs jeunes comédiens époustouflants dont Mickey Rourke. C’est la veine très personnelle de Levinson qui comprend LIBERTY HEIGHTS et son film favori, difficilement trouvable, AVALON. J’aimerais revoir BUGSY, écrit par James Toback qui m’avait bien plu.
Le hasard et le travail d’approfondissement de 50 ANS DE CINEMA AMÉRICAIN m’ont conduit à revoir et parfois à voir plusieurs film de Barry Levinson, et l’on s’aperçoit qu’ils ont en commun une ironie sceptique et chaleureuse, une volonté de traiter en comédie des sujets politiques assez décapants avec une vision beaucoup plus démocrate que républicaine, beaucoup plus libertaire que consensuelle. Parfois aussi un manque d’exigence ou une propension à tirer vers la farce des péripéties qui auraient gagnées à s’arrêter avant. Le dernier tiers de WAG THE DOG/DES HOMMES D’INFLUENCE devient insistant et lourd alors que tout ce qui précède fait preuve d’une irrévérence et d’une invention cocasse quelque peu sous-estimée. Le service de communication réussit à inventer une guerre pour camoufler les frasques sexuelles du président (le film est antérieur à l’affaire Monica Lewinsky) avec l’aide d’un producteur interprété génialement par Dustin Hoffman. On sent d’ailleurs Levinson à l’aise avec les acteurs et Robin Williams, Laura Linney sont épatants dans le tout aussi caustique MAN OF THE YEAR, une sorte d’HOMME DANS LA FOULE inversé qui contient des moments très pertinents sur la création et la manipulation des images. Levinson a un flair pour les dialogues (il écrivit d’ailleurs un certains nombre de ses films) et sait leur donner de la vie. On retrouve ces mêmes qualités dans BANDITS qui contient des échanges désopilants entre Bruce Willis et Billy Bob Thornton en détenu hypocondriaque, sans oublier Cate Blanchett, formidable en épouse frustrée qui est ravie de se faire kidnapper et de rejoindre les malfaiteurs. Il en résulte une série de variation sur JULES ET JIM. Levinson parfois découpe trop et manque de confiance dans son matériau ce qui uniformise plusieurs séquences. DINER, plus autobiographique, est une vrai réussite, drôle, tendre, amère, révélant plusieurs jeunes comédiens époustouflants dont Mickey Rourke. C’est la veine très personnelle de Levinson qui comprend LIBERTY HEIGHTS et son film favori, difficilement trouvable, AVALON. J’aimerais revoir BUGSY, écrit par James Toback qui m’avait bien plu.
Parlant de Toback, il est préférable de revoir le magnifique THE GAMBLER si bien dirigé par Karel Reisz plutôt que le remake, démonstration par l’absurde de tout ce qu’il ne faut pas faire. Et James Caan pulvérise son successeur Mark Wahlberg.
DE LINKLATER À ANDERSON
J’ai adoré BOYHOOD, ce qui est une bonne manière de rappeler d’autres films du très talentueux Richard Linklater, qui jouent aussi à fictionnaliser la durée : la trilogie des BEFORE avec BEFORE SUNRISE, BEFORE SUNSET (celui là très Rohmerien), BEFORE MIDNIGHT.
PRINCE OF TEXAS – étrange traduction française de PRINCE AVALANCHE (il s’agit du second titre de cette œuvre inspirée par un film islandais minimaliste!) – de David Gordon Green, chronique rurale, intimiste, dans le ton de ses premiers essais, tournée en 16 jours sur deux hommes qui repeignent le marquage au sol des routes de la campagne texane, routes quasi désertes. On n’y croise pratiquement qu’un seul camion dont le conducteur, personnage haut en couleurs, brusque et attachant, ravitaille en alcool les deux protagonistes. Il faut dire que tout autour, la végétation, les forêts ont été dévastées par des incendies (premier plan du film) : une scène magnifique nous montre le héros errant dans les ruines d’une maison calcinée où il découvre une femme qui cherche un papier. Moment furtif, peut-être rêvé et bouleversant où l’on voit la vieille femme reconstituer le plan de sa maison, puis, Alvin, le héros, faire mine d’entrer dans la maison et d’y découvrir des occupants. PRINCE AVALANCHE repose essentiellement sur les rapports d’Alvin et du frère de sa fiancée, sur leurs dialogues souvent marrants, flirtant avec l’absurde, entrecoupés par des plans de nature et d’animaux. David Gordon Green n’évite pas toujours le maniérisme ni la répétition et le film piétine quelque peu malgré une interprétation hors pair de Paul Rudd et Emile Hirsch et une belle photo de Tim Orr.
JOE, tourné la même année, est plus réussi dans ses deux premiers tiers, avec des éclats de violence surprenants qui semblent appartenir au tissu social, à l’air qu’on respire. L’agressivité surgit brusquement dans un bar et l’un des protagonistes répète « qu’il ne craint rien car il est passé à travers un pare-brise ». Réplique géniale. Un meurtre horrible est commis pour une bouteille. Interprétation assez étonnante de Gary Poulter, un SDF découvert par le réalisateur et qui mourut avant la sortie du film. Le dernier tiers malheureusement devient trop explicatif et redondant. Green est il condamné aux films prometteurs ?
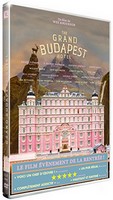 Ce qui frappe d’emblée dans GRAND BUDAPEST HOTEL, c’est la luxuriance visuelle des décors (palace luxueux et rococo, station balnéaire, bâtiments Art Nouveau), aussi imaginatifs et somptueux dans leur splendeur cocasse que dans leur décrépitude, et du découpage, du choix des cadres. Wes Anderson ne répète jamais un plan, un angle et cela, même dans des moments de transition habituellement soldés, quand les protagonistes empruntent, par exemple, un de ces moyens de locomotion dont le cinéaste est friand : ici des trains, un téléphérique, voire des ascenseurs. Chacune de ces scènes donne lieu à une débauche d’imagination, ponctuée par des effets spéciaux spectaculaires dont l’artificialité est fièrement revendiquée par la mise en scène. Le soin accordé à chaque cadre, tous hyper graphiques et stylisés, la précision du découpage, l’abondance des références picturales, le choix de trois formats de projection différents : en 1.37 pour les années 30, en format anamorphique pour les séquences des années 60 et en 1.85 pour la période plus récente peuvent laisser craindre une œuvre que pétrifie le formalisme. Il n’en est rien, bien au contraire. L’énergie de la narration semble survitaminer le propos, grandeur et décadence d’un palace. Et l’esthétisme n’étouffe jamais la sensualité, la présence physique des lieux et des acteurs un peu comme chez Michael Powell.
Ce qui frappe d’emblée dans GRAND BUDAPEST HOTEL, c’est la luxuriance visuelle des décors (palace luxueux et rococo, station balnéaire, bâtiments Art Nouveau), aussi imaginatifs et somptueux dans leur splendeur cocasse que dans leur décrépitude, et du découpage, du choix des cadres. Wes Anderson ne répète jamais un plan, un angle et cela, même dans des moments de transition habituellement soldés, quand les protagonistes empruntent, par exemple, un de ces moyens de locomotion dont le cinéaste est friand : ici des trains, un téléphérique, voire des ascenseurs. Chacune de ces scènes donne lieu à une débauche d’imagination, ponctuée par des effets spéciaux spectaculaires dont l’artificialité est fièrement revendiquée par la mise en scène. Le soin accordé à chaque cadre, tous hyper graphiques et stylisés, la précision du découpage, l’abondance des références picturales, le choix de trois formats de projection différents : en 1.37 pour les années 30, en format anamorphique pour les séquences des années 60 et en 1.85 pour la période plus récente peuvent laisser craindre une œuvre que pétrifie le formalisme. Il n’en est rien, bien au contraire. L’énergie de la narration semble survitaminer le propos, grandeur et décadence d’un palace. Et l’esthétisme n’étouffe jamais la sensualité, la présence physique des lieux et des acteurs un peu comme chez Michael Powell.
CLASSIQUES AMÉRICAINS
 THUNDERHOOF est un des westerns les plus ambitieux de la première partie de la carrière de Phil Karlson et j’aimerais bien voir ADVENTURES IN SILVERADO dont le héros est Robert Louis Stevenson : 3 personnages, deux hommes, une femme et quelques chevaux, un tournage entièrement en extérieurs, en dehors d’un ou deux décors peu importants. Karlson utilise remarquablement ces paysages arides, rocailleux, escarpés, qui traduisent la violence intérieure des protagonistes : un travelling latéral surplombe de plus en plus Preston Foster et William Bishop, des contreplongées très larges isolent les personnages qui se découpent au sommet d’une crête, durant une bagarre, on passe brutalement d’un cadre serré à un plan d’ensemble. On a droit à un pugilat teigneux, signature de Karlson, assez vite interrompu, et à deux cascades spectaculaires lors de la capture de l’étalon, dont une chute de cheval devant ce dernier. Le scénario, très dépouillé, tourne autour de la capture d’un étalon sauvage (c’est la version minimaliste de THE MISFITS), symbole de succès et de richesse, qui va opposer les deux hommes. Les personnages sont plus complexes que d’habitude et tous ont leur zone d’ombre, leurs accès d’égoïsme et de violence (les deux hommes sont tour à tour sympathiques et antipathiques) et le dialogue insiste sur les frustrations, les jalousies, la tentation sexuelle, avec même un petit interlude musical où Bishop fredonne entre autres « The girl he left behind », chère à Ford. Foster est meilleur que Bishop mais Mary Stuart campe une héroïne plutôt originale. Malheureusement la conclusion, soldée, n’est pas à la hauteur de ce qui précède. A noter que THUNDERHOOF sortit en copie sépia.
THUNDERHOOF est un des westerns les plus ambitieux de la première partie de la carrière de Phil Karlson et j’aimerais bien voir ADVENTURES IN SILVERADO dont le héros est Robert Louis Stevenson : 3 personnages, deux hommes, une femme et quelques chevaux, un tournage entièrement en extérieurs, en dehors d’un ou deux décors peu importants. Karlson utilise remarquablement ces paysages arides, rocailleux, escarpés, qui traduisent la violence intérieure des protagonistes : un travelling latéral surplombe de plus en plus Preston Foster et William Bishop, des contreplongées très larges isolent les personnages qui se découpent au sommet d’une crête, durant une bagarre, on passe brutalement d’un cadre serré à un plan d’ensemble. On a droit à un pugilat teigneux, signature de Karlson, assez vite interrompu, et à deux cascades spectaculaires lors de la capture de l’étalon, dont une chute de cheval devant ce dernier. Le scénario, très dépouillé, tourne autour de la capture d’un étalon sauvage (c’est la version minimaliste de THE MISFITS), symbole de succès et de richesse, qui va opposer les deux hommes. Les personnages sont plus complexes que d’habitude et tous ont leur zone d’ombre, leurs accès d’égoïsme et de violence (les deux hommes sont tour à tour sympathiques et antipathiques) et le dialogue insiste sur les frustrations, les jalousies, la tentation sexuelle, avec même un petit interlude musical où Bishop fredonne entre autres « The girl he left behind », chère à Ford. Foster est meilleur que Bishop mais Mary Stuart campe une héroïne plutôt originale. Malheureusement la conclusion, soldée, n’est pas à la hauteur de ce qui précède. A noter que THUNDERHOOF sortit en copie sépia.
EDWARD L. CAHN
De cet empereur de la série Z pré-Roger Corman, IT! THE TERROR FROM BEYOND SPACE peut en effet être considéré comme une des sources d’inspiration d’ALIEN et Dan O’Bannon, l’un des co-auteurs, le confirme. Le scénariste Jerome Bixby voulut faire un procès mais les producteurs d’ALIEN s’abritèrent derrière une nouvelle de Van Vogt avec qui ils s’arrangèrent. Il y a beaucoup de détails similaires : l’importance des coursives, des conduits de chauffage. Malheureusement, le monstre qu’on voit très tôt, est totalement ridicule. Juste un acteur (Ray Corrigan) avec une combinaison en caoutchouc. Comme de bien entendu, il est indestructible (on l’attaque même au bazooka ! un bazooka dans un vol spatial !!). De plus le scenario s’emmêle avec les différents étages du vaisseau spatial que des personnages descendent au lieu de monter et vice versa. Selon Dave Kehr, en dehors de IT, les films fantastiques ou de SF de Cahn sont plutôt décevants et plats.
NOOSE FOR A GUNMAN est un western au scénario ultra classique, mais assez adroitement filmé (les premiers plans sont pas mal du tout) et bien joué par Jim Davis pour une fois en vedette, Barton MacLane, Harry Carey Jr, Walter Sande dans un personnage original de shérif intelligent, sensible. La palme revient à Ted de Corsia qui campe un Jake Cantrell assez impressionnant mais dont la mort n’est pas du tout historique. FIVE GUNS TO TOMBSTONE et surtout OKLAHOMA TERRITORY sont assez médiocres, le second, une pénible intrigue policière avec Ted de Corsia en chef indien accusé à tort est platement photographié. Le meilleur film de Cahn que j’ai pu voir est certainement DESTINATION MURDER, polar tendu, astucieux où certains personnages prennent tout à coup une grande importance.
On devine que LA PISTE FATALE (INFERNO) doit être plaisant à voir en 3D. Roy Baker et Lucien Ballard utilisent bien l’espace, le paysage rocailleux. Évidemment dans la bagarre finale, on vous envoie des lampes, des chaises, des ustensiles dans la gueule mais ces effets doivent être moins efficaces que certaines descentes d’un piton. Ryan est pratiquement condamné à la voix off et Rhonda Fleming est très belle avec des vêtements spectaculaires.
Lire la suite »