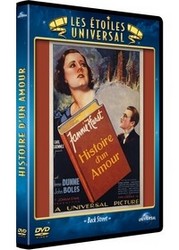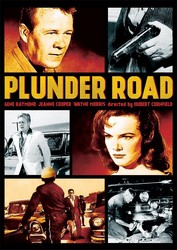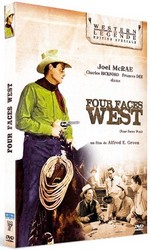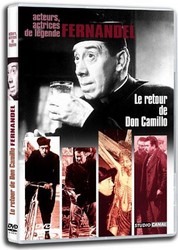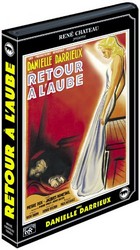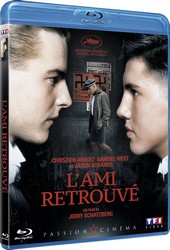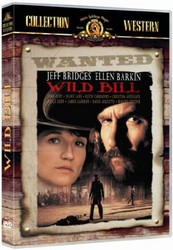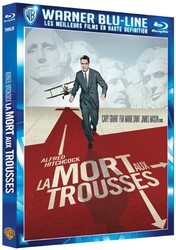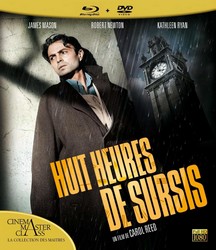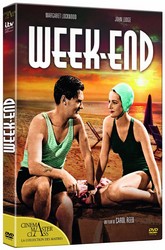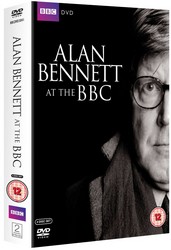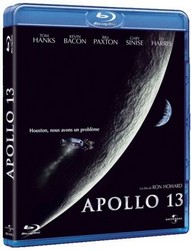QUELQUES CLASSIQUES US
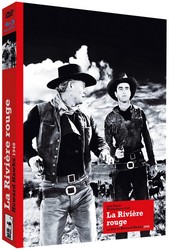 Revoir RED RIVER (Wild Side) est un immense plaisir, surtout dans la version du réalisateur qui fut la moins montrée (c’est l’un des paradoxes de ce film que Hawks avait pourtant produit). Version plus courte et c’est le seul cas avec celui de DARLING LILI de Blake Edwards. Le remarquable livret de Philippe Garnier met enfin en lumière l’apport des différents scénaristes (il a relu le roman de Borden Chase) et celui de Hawks, explique les tripatouillages de la fin, causés par Howard Hughes, qui font chanceler légèrement les dernières scènes. Peu de chose à côté des fulgurances. Ah le dialogue avec Joanne Dru qui reçoit une flèche et la manière dont on la lui retirer. Garnier est un peu sévère avec Dru qui est plutôt convaincante même si son personnage a été édulcoré par la censure. Wayne lui est génial dans un des rôles les plus âpres, noirs, durs de sa carrière avant THE SEARCHERS (il explore déjà ces couleurs dans l’excellent WAKE OF THE RED WITCH). Clift est sidérant d’invention, de justesse, de magnétisme et fait pâlir les succédanés des films ultérieurs (que Ricky Nelson semble falot et bêta à coté de lui). Et lisez le beau roman de Michael Ondaatje, LE FANTÔME D’ANIL où l’on voit deux jeunes femmes très belles, toutes deux médecin légiste, analyser après avoir pas mal bu et fumé, les trajectoires des balles à la fin du film pour déterminer la gravité des blessures. Scène hilarante. Par la suite, elles dissèquent de la même façon POINT BLANK et finissent par écrire à Boorman pour savoir où est touché Marvin.
Revoir RED RIVER (Wild Side) est un immense plaisir, surtout dans la version du réalisateur qui fut la moins montrée (c’est l’un des paradoxes de ce film que Hawks avait pourtant produit). Version plus courte et c’est le seul cas avec celui de DARLING LILI de Blake Edwards. Le remarquable livret de Philippe Garnier met enfin en lumière l’apport des différents scénaristes (il a relu le roman de Borden Chase) et celui de Hawks, explique les tripatouillages de la fin, causés par Howard Hughes, qui font chanceler légèrement les dernières scènes. Peu de chose à côté des fulgurances. Ah le dialogue avec Joanne Dru qui reçoit une flèche et la manière dont on la lui retirer. Garnier est un peu sévère avec Dru qui est plutôt convaincante même si son personnage a été édulcoré par la censure. Wayne lui est génial dans un des rôles les plus âpres, noirs, durs de sa carrière avant THE SEARCHERS (il explore déjà ces couleurs dans l’excellent WAKE OF THE RED WITCH). Clift est sidérant d’invention, de justesse, de magnétisme et fait pâlir les succédanés des films ultérieurs (que Ricky Nelson semble falot et bêta à coté de lui). Et lisez le beau roman de Michael Ondaatje, LE FANTÔME D’ANIL où l’on voit deux jeunes femmes très belles, toutes deux médecin légiste, analyser après avoir pas mal bu et fumé, les trajectoires des balles à la fin du film pour déterminer la gravité des blessures. Scène hilarante. Par la suite, elles dissèquent de la même façon POINT BLANK et finissent par écrire à Boorman pour savoir où est touché Marvin.
 LOVE ME TONIGHT (AIMEZ-MOI CE SOIR) reste un éblouissement dès la scène d’ouverture qui joue avec toutes les possibilités du son. Le scénario extrêmement brillant, avec beaucoup de répliques osées et suggestives de Samuel Hoffenstein (collaborateur de Lubitsch) et Waldemar Young (Peter Ibbetsen) d’après une pièce française de Léopold Marchand et Paul Armand (à qui on doit CES MESSIEURS DE LA SANTÉ) brille aussi bien par son ironie que par un traitement extrêmement subtil et inhabituellement lucide des clichés et des conventions. On peut même dire qu’il s’en sert pour mieux les retourner et, pour utiliser un vocabulaire à la mode, les subvertir et s’en jouer. Mais ce qui frappe surtout c’est la folle énergie de la mise en scène de Mamoulian, son audace intrépide et volontariste : ralentis, accélérés, montage alterné à la Griffith, double exposition, voire même des zooms, une magistrale utilisation des décors (tous les plans d’escalier, l’arrivée de Chevalier dans le château), tout lui est bon pour dynamiser le récit, faire exploser les règles, aiguiser la drôlerie des situations. Plusieurs numéros musicaux sont même enregistrés en direct et la manière dont il fait traverser la France à une sublime chanson de Rodgers et Hart reste anthologique.
LOVE ME TONIGHT (AIMEZ-MOI CE SOIR) reste un éblouissement dès la scène d’ouverture qui joue avec toutes les possibilités du son. Le scénario extrêmement brillant, avec beaucoup de répliques osées et suggestives de Samuel Hoffenstein (collaborateur de Lubitsch) et Waldemar Young (Peter Ibbetsen) d’après une pièce française de Léopold Marchand et Paul Armand (à qui on doit CES MESSIEURS DE LA SANTÉ) brille aussi bien par son ironie que par un traitement extrêmement subtil et inhabituellement lucide des clichés et des conventions. On peut même dire qu’il s’en sert pour mieux les retourner et, pour utiliser un vocabulaire à la mode, les subvertir et s’en jouer. Mais ce qui frappe surtout c’est la folle énergie de la mise en scène de Mamoulian, son audace intrépide et volontariste : ralentis, accélérés, montage alterné à la Griffith, double exposition, voire même des zooms, une magistrale utilisation des décors (tous les plans d’escalier, l’arrivée de Chevalier dans le château), tout lui est bon pour dynamiser le récit, faire exploser les règles, aiguiser la drôlerie des situations. Plusieurs numéros musicaux sont même enregistrés en direct et la manière dont il fait traverser la France à une sublime chanson de Rodgers et Hart reste anthologique.
BACK STREET (HISTOIRE D’UN AMOUR) de John M. Stahl
Merci au correspondant qui m’a signalé la sortie de ce chef d’œuvre en DVD. Nous en disions un bien fou dans 50 Ans de Cinéma américain. Il est frappant de voir à quel point la mise en scène de Stahl dans ses mélodrames, prend le contrepied de celle de Sirk. Elle est épurée, retenue, rapide. Certaines péripéties sont à peine évoquées : on voit une jeune femme prendre feu en fond de plan. Les dialogues sont contenus, jamais déclamés et cela donne une force incroyable à des personnages, notamment à celui du héros dont l’inconscience égoïste, la suffisance n’est jamais commentée. Un chef d’œuvre. Belle analyse de Jacques Lourcelles dans son dictionnaire.
SPAWN OF THE NORTH (LES GARS DU LARGE) de Henry Hathaway
Autre découverte majeure. A première vue, rien que de très classique : deux amis inséparables que les circonstances, l’appât du gain, vont dresser l’un contre l’autre sur fond de pêche au saumon en Alaska, deux femmes, une rédemption à la clé. Ajouter un oiseau, un phoque inénarrable et vous croyez avoir affaire à un de ces produits fabriqués à la chaine par les studios, entre film d’aventures et western (on se demande si Hathaway avec l’aide de Jules Furthman et Talbot Jennings ne recycle pas une fois de plus la trame de THE VIRGINIAN). Or il s’agit là d’un des meilleurs films de Hathaway non seulement des années 30 mais de sa carrière. Grâce à la nervosité narrative qu’il impose dès les premiers plans, au ton resserré, précis, dégraissé qui coupent le cou aux effusions sentimentales, soldent les scènes de détente comique ou leur adjoignent un contrepoint plus sombre. Hathaway agit un peu comme l’associé de John Barrymore qui condense toutes ses tirades lyriques et fleuries destinées à paraître dans le journal en deux phrases sèches et précises. Il renouvelle, revitalise les situations les plus classiques en terminant abruptement la plupart des scènes : Fonda sort en claquant la porte que la caméra continue à cadrer pendant qu’on entend en off un sanglot de Dorothy Lamour. Ou aussi en les abordant sous un angle inattendu, jouant de manière magistrale avec une série de décors inventifs et orignaux : l’hôtel et le bar que possède Dorothy Lamour (une fois de plus formidable chez Hathaway) permet des cadres, des cadrages excitants, surprenants qui jouent avec la cheminée intérieure au milieu de la pièce, l’escalier, l’immense aigle empaillé. Pour se laver, Fonda et George Raft plongent de la fenêtre de leur chambre dans la mer (Raft témoigne ici de qualités athlétiques étonnantes et bien mises en valeur). On est constamment surpris par les brusques changements de ton : une joyeuse « square dance » est interrompue brusquement par des mélopées plaintives. Ce sont les Indiens de l’autre côté de la baie qui prient les esprits pour que leur pêche soit fructueuse et la scène brusquement devient grave, mélancolique avant de se transformer en une déclaration d’amour lyrique. C’est peut-être le film qui retrouve le mieux le ton de Jack London.
RIDE THE PINK HORSE
A revoir ce beau film produit par Joan Harrison, on est beaucoup moins gêné par ce que nous relevions comme des conventions, les décors de studio par exemple qui renforcent le côté un peu féérique, mélancolique de l’histoire, de cette fable. Le charme et la force du film provient d’un décalage constant avec les conventions, les règles du genre : quand tombant dans un guet apens, le héros est attaqué dans le noir, nous ne voyons que l’éclat d’une lame. On découvrira plus tard qu’il a réussi à s’échapper en tuant un de ses agresseurs. Lors de l’affrontement final, Montgomery prend le contrepied de tout ce qu’on pourrait attendre : blessé, il s’en prend à Frank Hugo sans le reconnaître tant est grande sa faiblesse, séquence incroyablement originale. Ce manège autour duquel s’articule une grande partie de l’action devient un lieu un peu magique (ce que renforce la fiesta qui prend de plus en plus d’importance et dont les péripéties paraissent commenter ce qui arrive au héros), révélateur des sentiments secrets des personnages, à des lieues de toute dramaturgie réaliste. L’envers de l’hôtel où se planque Frank Hugo. De même Thomas Gomez nous a paru plus sobre, plus tenu que dans notre souvenir (c’est un de ses meilleurs rôles avec FORCE OF EVIL) et nous oublions de citer Art Smith, originale idée de distribution, en enquêteur du FBI et Andrea King, excellente.
PLUNDER ROAD de Hubert Cornfield est un excellent petit polar (photo d’Ernest Haller) dont nous ne vantions que le début dans 50 ANS. Il faut dire que l’ouverture sous la pluie, pratiquement silencieuse en dehors de quelques phrases en voix off et de deux ou trois répliques est un assez joli morceau de bravoure. Mais la suite est toute aussi intéressante dans sa sécheresse elliptique, notamment la manière extrêmement crédible et donc surprenante dont tous les membres du gang se font repérer et arrêter : un camion en surpoids, une erreur commise en ouvrant le capot, un instant d’énervement. Pas de trucs scénaristiques mais des petits faits simples qui sonnent juste jusqu’à la course mortelle du personnage principal.
NOCTURNE est un petit film noir d’Edwin L. Marin qui signa quelques réalisations honorables parmi beaucoup de produits stéréotypés. L’un des points forts du film est le remarquable dialogue de Jonathan Latimer, romancier brillant qui aligne là les répliques percutantes et cyniques. Le début est remarquable.
 DRIVE A CROOKED ROAD est le premier vrai film de Quine qui coécrit le scénario avec Blake Edwards. La trame en est simple : un brave garagiste, ex-coureur automobile va être manipulé par une femme qui travaille avec des malfrats. A partir de là, servi par une interprétation magnifique d’un Mickey Rooney touchant, sobre traduisant à merveille la timidité, la maladresse de son personnage qui tranche dans sa sobriété avec la plupart de ses rôles, Quine et Edwards évitent pas mal de stéréotypes : Dianne Foster, déjà excellente dans LES FRÈRES RICO, n’a rien d’une femme fatale et les auteurs lui donnent des doutes et des remords de même qu’ils insufflent une vie, une couleur au moindre personnage. On n’en attendait pas moins de Quine dont la caméra épouse les rêves, les illusions, la douleur de son héros. Excellents extérieurs tournés en Californie du Sud. Pas mal d’acteurs excellents de Jack Kelly à Kevin McCarthy.
DRIVE A CROOKED ROAD est le premier vrai film de Quine qui coécrit le scénario avec Blake Edwards. La trame en est simple : un brave garagiste, ex-coureur automobile va être manipulé par une femme qui travaille avec des malfrats. A partir de là, servi par une interprétation magnifique d’un Mickey Rooney touchant, sobre traduisant à merveille la timidité, la maladresse de son personnage qui tranche dans sa sobriété avec la plupart de ses rôles, Quine et Edwards évitent pas mal de stéréotypes : Dianne Foster, déjà excellente dans LES FRÈRES RICO, n’a rien d’une femme fatale et les auteurs lui donnent des doutes et des remords de même qu’ils insufflent une vie, une couleur au moindre personnage. On n’en attendait pas moins de Quine dont la caméra épouse les rêves, les illusions, la douleur de son héros. Excellents extérieurs tournés en Californie du Sud. Pas mal d’acteurs excellents de Jack Kelly à Kevin McCarthy.
 THE WHIP HAND de William Cameron Menzies est une vraie curiosité et mérite une place à part dans la série des films anti-rouge. D’abord parce que le scénario initial tel que le tourna Menzies (décorateur du VOLEUR DE BAGDAD, D’AUTANT EN EMPORTE LE VENT) une première fois s’en prenait aux nazis. C’est eux qui contrôlaient le petit village où pénètre le héros à la recherche d’un endroit où pêcher. Il découvre que tous les poissons du lac sont morts et que tous les villageois ont un comportement lourdement inquiétant et inquisiteur, la palme revenant à Raymond Burr en bistrotier dont l’affabilité respire la menace à 800 mètres. Quand Howard Hughes vit le montage, il décida de transformer les nazis en communistes adeptes de la guerre bactériologiques (tous gardent cependant des noms et un accent allemands et on dit de leur chef qu’il abandonna le nazisme pour le communisme à la fin de la guerre), fit supprimer la présence de Hitler (joué évidemment par Bobby Watson). Le retournage se fit dans des conditions paraît-il déprimantes. Il en résulte des ellipses étranges. Le résultat est pourtant assez distrayant. Le rythme est rapide et Menzies renforce l’atmosphère paranoïaque avec des recherches visuelles assez marrantes, aidé par la photo de Nicolas Musuracca : avant-plans (murs, rochers, arbres) ultra-dramatisés, importance des obliques, champs vide qui renforcent l’angoisse, cadrages qui figent trois visages dans un plan, l’un étant à demi-caché. Le dialogue, les péripéties, la logique, le jeu des acteurs sont en jachère mais le résultat traduit assez bien la vision conspirationniste, paranoïaque de Howard Hughes.
THE WHIP HAND de William Cameron Menzies est une vraie curiosité et mérite une place à part dans la série des films anti-rouge. D’abord parce que le scénario initial tel que le tourna Menzies (décorateur du VOLEUR DE BAGDAD, D’AUTANT EN EMPORTE LE VENT) une première fois s’en prenait aux nazis. C’est eux qui contrôlaient le petit village où pénètre le héros à la recherche d’un endroit où pêcher. Il découvre que tous les poissons du lac sont morts et que tous les villageois ont un comportement lourdement inquiétant et inquisiteur, la palme revenant à Raymond Burr en bistrotier dont l’affabilité respire la menace à 800 mètres. Quand Howard Hughes vit le montage, il décida de transformer les nazis en communistes adeptes de la guerre bactériologiques (tous gardent cependant des noms et un accent allemands et on dit de leur chef qu’il abandonna le nazisme pour le communisme à la fin de la guerre), fit supprimer la présence de Hitler (joué évidemment par Bobby Watson). Le retournage se fit dans des conditions paraît-il déprimantes. Il en résulte des ellipses étranges. Le résultat est pourtant assez distrayant. Le rythme est rapide et Menzies renforce l’atmosphère paranoïaque avec des recherches visuelles assez marrantes, aidé par la photo de Nicolas Musuracca : avant-plans (murs, rochers, arbres) ultra-dramatisés, importance des obliques, champs vide qui renforcent l’angoisse, cadrages qui figent trois visages dans un plan, l’un étant à demi-caché. Le dialogue, les péripéties, la logique, le jeu des acteurs sont en jachère mais le résultat traduit assez bien la vision conspirationniste, paranoïaque de Howard Hughes.
Saluons la sortie d’un magnifique western, inédit jusque là en France, FOUR FACES WEST (300 000 DOLLARS MORT OU VIF) d’Alfred Green, œuvre élégiaque, originale, sensible et très fine, adaptant une belle histoire écrite par Eugène Manlove Rhodes, l’un des rares écrivains de westerns qui fut cowboy, auquel le film rend hommage. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule, vous allez pouvoir découvrir l’étonnant TERROR IN A TEXAS TOWN, le dernier film de Joseph H. Lewis écrit par Dalton Trumbo. Voilà ce que j’en disais dans une chronique : « Je ne sais pas si je le qualifierai de « bon film » car ses défauts, interprétation parfois hiératique, étrange accent suédois de Hayden, peuvent déconcerter, mais le ton glacé du film, la longueur de certains plans (dans le saloon), la débauche de cadrages insolites privilégiant les amorces (énorme roue, colonnade) qui tordent l’espace, statufient l’action, lui confèrent un coté baroque, sur mise en scène, qui jure avec la simplicité de l’intrigue, tout cela donne un ton vraiment insolite, accentué par la musique de Gerald Fried qui est tout sauf une musique de western : éclats de trompette qui ne dépareraient pas dans une mise en scène de Laurence Olivier, dissonances à la Paul Dessau, lamento percussif. Les extérieurs sont réduits au minimum et sont d’un dépouillement qui frôle l’abstraction. Le film est d’ailleurs beaucoup plus proche d’un film noir claustrophobique dans le style de SO DARK IS THE NIGHT, l’un des titres majeurs de Lewis, que d’un western. Le dialogue de Trumbo (sous le pseudonyme de Ben Perry) est très écrit, très volontariste et les allusions à la liste noire sont évidentes. A noter que c’est un des rares films où l’on voit un cavalier sauter de sa monture et se diriger vers un bâtiment tandis que son cheval s’échappe dans la rue (ce qui foule au pied un cliché). La pauvreté du budget fait que Lewis utilise deux fois le même cadrage et un autre personnage laisse aussi partir sa monture. »
 LA JOURNÉE DES VIOLENTS, western urbain, compte parmi les plus réussis d’Harry Keller et maintient l’intérêt jusqu’au règlement de compte final relativement décevant. Il faut dire que Robert Middleton, chef d’une famille de tueurs (parmi lesquels les inévitables Lee van Cleef et Skip Homeier) venu arrêter par tous les moyens – chantage, intimidation, violences – la pendaison de leur frère (Christopher Dark excellent) impose un vrai sentiment de menace. Le scénario assez bien dialogué de Lawrence Roman présente quelques similitudes avec HIGH NOON, s’inspirant du même auteur John W. Cunningham mais introduit quelques notations originales : la fiancée de Fred McMurray tombe amoureuse d’un autre homme et n’ose pas le lui dire. Là encore, le dénouement déçoit. Certaines décisions de McMurray, comme de ne pas mettre en prison les frères Hayes qu’il vient de désarmer, paraissent problématiques mais sont contournées par la narration sèche, dépouillée de Keller : le premier plan nous montre deux cavaliers s’approchant peu à peu de la caméra, avec en amorce une potence et un nœud coulant. A cause de l’incurie d’Universal, le film n’existe qu’en 4/3, le négatif Scope ayant été détruit. Cela semble renforcer paradoxalement le sentiment d’oppression, de tension claustrophobique, la nudité d’une mise en scène qui s’appuie peu sur le décor, mais que l’on aurait pu comparer avec celle de QUANTEZ.
LA JOURNÉE DES VIOLENTS, western urbain, compte parmi les plus réussis d’Harry Keller et maintient l’intérêt jusqu’au règlement de compte final relativement décevant. Il faut dire que Robert Middleton, chef d’une famille de tueurs (parmi lesquels les inévitables Lee van Cleef et Skip Homeier) venu arrêter par tous les moyens – chantage, intimidation, violences – la pendaison de leur frère (Christopher Dark excellent) impose un vrai sentiment de menace. Le scénario assez bien dialogué de Lawrence Roman présente quelques similitudes avec HIGH NOON, s’inspirant du même auteur John W. Cunningham mais introduit quelques notations originales : la fiancée de Fred McMurray tombe amoureuse d’un autre homme et n’ose pas le lui dire. Là encore, le dénouement déçoit. Certaines décisions de McMurray, comme de ne pas mettre en prison les frères Hayes qu’il vient de désarmer, paraissent problématiques mais sont contournées par la narration sèche, dépouillée de Keller : le premier plan nous montre deux cavaliers s’approchant peu à peu de la caméra, avec en amorce une potence et un nœud coulant. A cause de l’incurie d’Universal, le film n’existe qu’en 4/3, le négatif Scope ayant été détruit. Cela semble renforcer paradoxalement le sentiment d’oppression, de tension claustrophobique, la nudité d’une mise en scène qui s’appuie peu sur le décor, mais que l’on aurait pu comparer avec celle de QUANTEZ.