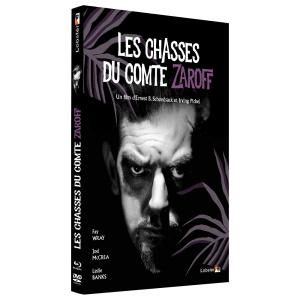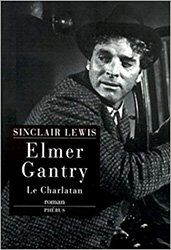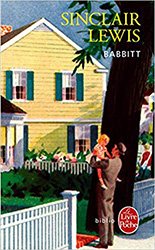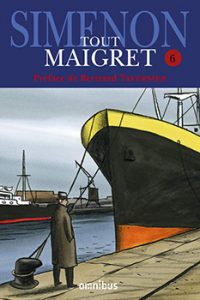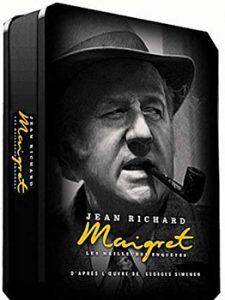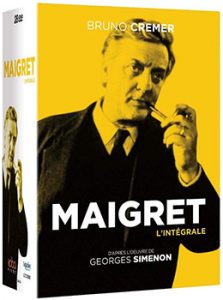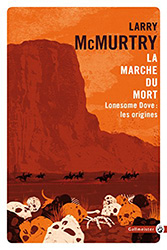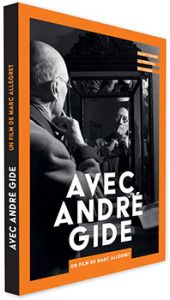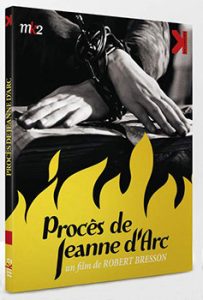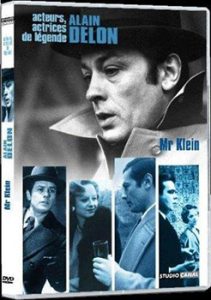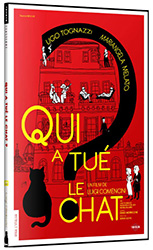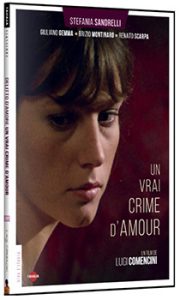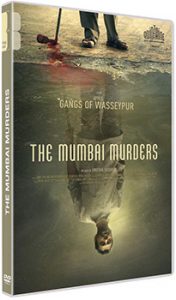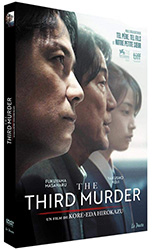Je partage pour commencer ce texte de texte de Philippe Meyer sur Didier Bezace, mon ami, mon frère avec qui j’ai partagé, entre autres, l’aventure de L 627 : « On entrait de plain-pied dans son ambition. Il ne l’expliquait pas, il la donnait à voir et à entendre. Il l’illustrait par ses choix si ouverts, d’auteurs, de textes, d’interprètes, de mises en scène, par son besoin de partager ces choix avec le public le plus large, de concevoir sa programmation pour ce public et non pour flatter le conformisme de la critique. Il chantait volontiers, il avait même d’abord pensé que c’était sa vocation, aidé autant que trompé par sa voix au timbre de clarinette basse et se sentant chez lui dans l’univers de Brassens ou de Montero, de Pia Colombo ou de Patachou, de Lluis Llach ou de Pete Seeger.
On entrait de plain-pied dans sa camaraderie. Aller voir les spectacles qu’il programmait au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers, en parler avec lui, le suivre dans cette cafétéria où il était disponible à tout le monde, c’était revigorer les enthousiasmes, les rêves et les idéaux que nous avaient insufflés, dont nous avaient persuadés, qu’avaient incarné pour nous Jean Vilar et la troupe du TNP. Ceux qui lui doivent d’avoir fait vivre cette idée du théâtre malgré la pétrification des milieux culturels et le carriérisme qui y règne sont dans un profond chagrin. »
UN PEU DE MUSIQUE
Stéphane Lerouge frappe encore un grand coup avec son anthologie Ennio Morricone qui comprend 18 CD qui rendent hommage à l’imagination inouïe de ce créateur qui change de langage, recherche de nouvelles sonorités avec des audaces esthétiques aussi exigeantes qu’accomplies avec des titres très rares (l’excellent Il Gatto tiré du film de Comencini). 5 CD sont consacrés à Sergio Leone dont un, absolument magnifique, à la musique inoubliable de IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE. Lerouge a regroupé les partitions par metteur en scène (Verneuil, Tarantino, Roland Joffé), par thème : le cinéma engagé (Elio Petri, Sacco et Vanzetti), l’histoire de l’Italie (avec notamment l’intégralité du 1900 de Bertolucci,) le cinéma de genre (Dario Argento, Sergio Sollima, ce qui va faire plaisir à Ballantrae et nous donner envie de revoir LA CITÉ DE LA VIOLENCE, Lucio Fulci), les thrillers mafieux et un dernier disque avec des thèmes célèbres interprétés par des chanteurs, des groupes, des musiciens qui vont de Raymond Lefevre à Kyle Eastwood, Pat Metheny et Charlie Haden, Georges Moustaki., Alexandre Desplat et le Traffic Quintet (Peur sur la ville morceau magnifique qui m’a donné envie de revoir le Verneuil) C’est mieux qu’un plaisir, une addiction. Cela fait déjà quatre heures que je l’écoute.
LECTURES
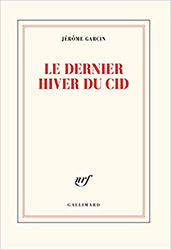 J’ai été bouleversé par LE DERNIER HIVER DU CID de Jérôme Garcin, cette manière pudique, tendre, quasi amoureuse de rendre compte des derniers moments de Gérard Philipe, de cette mort. Je découvre encore mieux que dans l’ouvrage fort d’Anne Philipe, la tendresse dont on l’a entouré et la dureté de ces derniers instants pour Anne et quelques amis. J’ai redécouvert l’homme et me suis souvenu qu’il avait été le seul à réagir en découvrant dans le Figaro Littéraire que Edmond T. Gréville risquait d’être jeté à la fosse commune, faute d’argent et qu’il nous avait envoyé une lettre et un chèque. Je dois dire que les derniers chapitres m’ont fait pleurer, cette mort si soudaine, ce répit, ces annotations des tragiques grecs où émerge une sensibilité secrète, à vif, mêlée à une drôlerie gamine, farceuse : ce goût pour les jeux de mots vaseux (Que se passe-t-il Valda ?) et j’ai redécouvert la violence et la condescendance avec lesquelles Truffaut l’a parfois traité (Soyons juste, TILL L’ESPIÈGLE le méritait mais pas FANFAN LA TULIPE ni surtout LES GRANDES MANŒUVRES qu’il faut absolument revoir dans le DVD de TF1 avec les deux fins). Ce livre m’a redonné la nostalgie du TNP où j’avais découvert LE CID où il était si jeune, si joyeux (lui et Vilar dépoussiérait les classiques), LE PRINCE DE HAMBOURG et le Musset, ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR, seule mise en scène théâtrale de René Clair, qui m’avait plu. Et je me suis souvenu qu’avant les pièces, plusieurs fois j’avais vu Gérard Philipe déambulant pendant qu’on dînait et parlant avec certains spectateurs.
J’ai été bouleversé par LE DERNIER HIVER DU CID de Jérôme Garcin, cette manière pudique, tendre, quasi amoureuse de rendre compte des derniers moments de Gérard Philipe, de cette mort. Je découvre encore mieux que dans l’ouvrage fort d’Anne Philipe, la tendresse dont on l’a entouré et la dureté de ces derniers instants pour Anne et quelques amis. J’ai redécouvert l’homme et me suis souvenu qu’il avait été le seul à réagir en découvrant dans le Figaro Littéraire que Edmond T. Gréville risquait d’être jeté à la fosse commune, faute d’argent et qu’il nous avait envoyé une lettre et un chèque. Je dois dire que les derniers chapitres m’ont fait pleurer, cette mort si soudaine, ce répit, ces annotations des tragiques grecs où émerge une sensibilité secrète, à vif, mêlée à une drôlerie gamine, farceuse : ce goût pour les jeux de mots vaseux (Que se passe-t-il Valda ?) et j’ai redécouvert la violence et la condescendance avec lesquelles Truffaut l’a parfois traité (Soyons juste, TILL L’ESPIÈGLE le méritait mais pas FANFAN LA TULIPE ni surtout LES GRANDES MANŒUVRES qu’il faut absolument revoir dans le DVD de TF1 avec les deux fins). Ce livre m’a redonné la nostalgie du TNP où j’avais découvert LE CID où il était si jeune, si joyeux (lui et Vilar dépoussiérait les classiques), LE PRINCE DE HAMBOURG et le Musset, ON NE BADINE PAS AVEC L’AMOUR, seule mise en scène théâtrale de René Clair, qui m’avait plu. Et je me suis souvenu qu’avant les pièces, plusieurs fois j’avais vu Gérard Philipe déambulant pendant qu’on dînait et parlant avec certains spectateurs.
 LE PIÈGE AMÉRICAIN de Frédéric Pierucci et Matthieu Aron (JC Lattes) : si vous voulez ressentir une vraie rage contre le patron d’un grand groupe, si vous avez besoin encore de sentir à quel point l’impérialisme américain peut être impitoyable, avec une justice totalement inféodée à la défense de ses entreprises et déterminée à détruire tous les concurrents étrangers, ce livre passionnant, tendu vous comblera. On y découvre des faits qui laissent pantois : la conduite des dirigeants d’Alstom envers le héros de l’histoire, le cynisme de Patrick Kron et aussi sa nullité en affaires (il pense être plus malin que la justice américaine et fera semblant de lui répondre pendant trois ans ; du coup il devra tout céder à cause de ce calcul imbécile et arrogant), la médiocrité de la classe politique française totalement atlantiste (Hollande qui préfère capituler devant les USA plutôt que poursuivre une politique d’alliance avec une firme allemande) ou piétinant tous les principes républicains (David Azema le conseiller chargé de défendre les intérêts français qui va se faire embaucher par une firme américaine pour « gagner plus d’argent »), le double jeu de Macron qui se couchera devant les Américains après avoir dénoncé Kron, vendant à la découpe un des fleurons de l’Industrie française. Tous ces personnages et notamment Kron qui avait déjà été condamné à des masses d’amendes pour corruption coûtent beaucoup plus cher à l’Etat que toutes les mesures d’économies, d’austérité imposées par Macron. Pour être juste, il faut ajouter qu’Arnaud Montebourg sauve l’honneur de la classe politique ainsi que quelques parlementaires de droite qui essaieront de s’opposer aux mensonges éhontés de Kron (lequel partira avec une énorme retraite et un bonus record), les socialistes brillant par leur mutisme assourdissant. Cher Rouxel, ce livre est pour vous ainsi que le suivant.
LE PIÈGE AMÉRICAIN de Frédéric Pierucci et Matthieu Aron (JC Lattes) : si vous voulez ressentir une vraie rage contre le patron d’un grand groupe, si vous avez besoin encore de sentir à quel point l’impérialisme américain peut être impitoyable, avec une justice totalement inféodée à la défense de ses entreprises et déterminée à détruire tous les concurrents étrangers, ce livre passionnant, tendu vous comblera. On y découvre des faits qui laissent pantois : la conduite des dirigeants d’Alstom envers le héros de l’histoire, le cynisme de Patrick Kron et aussi sa nullité en affaires (il pense être plus malin que la justice américaine et fera semblant de lui répondre pendant trois ans ; du coup il devra tout céder à cause de ce calcul imbécile et arrogant), la médiocrité de la classe politique française totalement atlantiste (Hollande qui préfère capituler devant les USA plutôt que poursuivre une politique d’alliance avec une firme allemande) ou piétinant tous les principes républicains (David Azema le conseiller chargé de défendre les intérêts français qui va se faire embaucher par une firme américaine pour « gagner plus d’argent »), le double jeu de Macron qui se couchera devant les Américains après avoir dénoncé Kron, vendant à la découpe un des fleurons de l’Industrie française. Tous ces personnages et notamment Kron qui avait déjà été condamné à des masses d’amendes pour corruption coûtent beaucoup plus cher à l’Etat que toutes les mesures d’économies, d’austérité imposées par Macron. Pour être juste, il faut ajouter qu’Arnaud Montebourg sauve l’honneur de la classe politique ainsi que quelques parlementaires de droite qui essaieront de s’opposer aux mensonges éhontés de Kron (lequel partira avec une énorme retraite et un bonus record), les socialistes brillant par leur mutisme assourdissant. Cher Rouxel, ce livre est pour vous ainsi que le suivant.
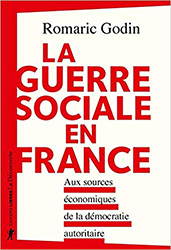 LA GUERRE SOCIALE EN FRANCE de Romaric Godin, journaliste à Médiapart, est une analyse acérée, soigneusement étayée des dérives néo-libérales imposées par Macron avec une volonté sans cesse renouvelée de s’en prendre au Travail tout en préservant, en faisant le jeu du Capital. Il faut absolument détruire toutes les règles et les lois issues de la libération afin de ne jamais brider les entreprises. Romaric Godin montre sur quoi s’appuie cette offensive d’une violence sans précédent (Macron va beaucoup plus loin que les pires débordements néo-libéraux défendus par Chirac, Jospin, Hollande, Sarkozy, débordements systématiquement rejetés par les électeurs et cela dès qu’il fut nommé ministre par Hollande) : les lois sur le travail, le plafonnement des indemnités versées par les prud’hommes. Il y a là de la part de Macron et d’Edouard Philippe volonté de casser tout ce qui peut brider les excès des entreprises, tout ce qui peut les réguler. On supprime des Inspecteurs du Travail, des contrôles alimentaires, les barrières de la Loi Littoral qui tentaient d’endiguer un urbanisme meurtrier. On impose des mesures ni étudiées, ni financées. Un livre qui fait du bien. Et j’ai pensé à Blier dans un IDIOT À PARIS lançant : « Vous oubliez que vous êtes des salariés, c’est à dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage, le chômage et son cortège de misère… Finis la petite auto, les vacances au Crotoy, le tiercé. Y avez-vous pensé ? C’est pour ça, si vous avez des revendications de salaire à me formuler, vous m’adressez une note écrite, je la fous au panier. On est bien d’accord ? ». Prescience de Michel Audiard.
LA GUERRE SOCIALE EN FRANCE de Romaric Godin, journaliste à Médiapart, est une analyse acérée, soigneusement étayée des dérives néo-libérales imposées par Macron avec une volonté sans cesse renouvelée de s’en prendre au Travail tout en préservant, en faisant le jeu du Capital. Il faut absolument détruire toutes les règles et les lois issues de la libération afin de ne jamais brider les entreprises. Romaric Godin montre sur quoi s’appuie cette offensive d’une violence sans précédent (Macron va beaucoup plus loin que les pires débordements néo-libéraux défendus par Chirac, Jospin, Hollande, Sarkozy, débordements systématiquement rejetés par les électeurs et cela dès qu’il fut nommé ministre par Hollande) : les lois sur le travail, le plafonnement des indemnités versées par les prud’hommes. Il y a là de la part de Macron et d’Edouard Philippe volonté de casser tout ce qui peut brider les excès des entreprises, tout ce qui peut les réguler. On supprime des Inspecteurs du Travail, des contrôles alimentaires, les barrières de la Loi Littoral qui tentaient d’endiguer un urbanisme meurtrier. On impose des mesures ni étudiées, ni financées. Un livre qui fait du bien. Et j’ai pensé à Blier dans un IDIOT À PARIS lançant : « Vous oubliez que vous êtes des salariés, c’est à dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste, des chômeurs en puissance. Le chômage, le chômage et son cortège de misère… Finis la petite auto, les vacances au Crotoy, le tiercé. Y avez-vous pensé ? C’est pour ça, si vous avez des revendications de salaire à me formuler, vous m’adressez une note écrite, je la fous au panier. On est bien d’accord ? ». Prescience de Michel Audiard.
Ce qui me permet d’évoquer quelques-uns des films qui décrivent ces blessés du système, ces opprimés, tous ceux à qui Macron conseille de traverser la rue pour trouver du travail. Lui qui paraît il a été bouleversé par la description de la banlieue dans LES MISÉRABLES, on ne peut que lui conseiller de voir LES NEIGES DU KILIMANDJARO, GLORIA MUNDI et autres films de Guédiguian ou de Philippe Lioret, WELCOME, TOUTES NOS ENVIES (une œuvre qui contient des moments très forts notamment sur les procédures d’endettement et trop survolés), Stéphane Brizé, EN GUERRE, LA LOI DU MARCHÉ, pour sentir ce qu’est la précarité et son traitement par les institutions comme dans LE JOURNAL D’UN MAÎTRE D’ÉCOLE de Vittorio de Seta, plusieurs fois évoqué ici. Et dans des films très émouvants et très réussis comme LES INVISIBLES de Louis-Julien Petit sur les SDF, les gens de la rue où l’on croise des personnages inoubliables et parfois très cocasses. Louis Julien Petit avait déjà réalisé le très attachant DISCOUNT. Oui voilà un programme parfait pour le Président de la République en ajoutant bien sûr les films de Ken Loach comme MOI, DANIEL BLAKE et le tout dernier que j’ai trouvé bouleversant, SORRY WE MISSED YOU.
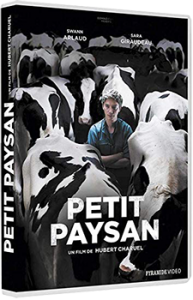 Je me réjouis du triomphe de PETIT PAYSAN lors de son passage sur la deuxième chaîne et en profite pour rappeler C’EST QUOI LA VIE de François Dupeyron et pendant que j’y suis LES RAISINS DE LA COLÈRE qu’il est sain de revoir au moins une fois par an et en Blu-ray. En le revoyant, j’ai été bouleversé une fois encore et frappé par la force si actuelle de certaines séquences : l’entrée et la descriptions des terribles camps de migrants dirigés par des patrons impitoyables soutenus par des policiers déterminés à s’en prendre aux grévistes, la détresse de ces paysans dont détruit les terres et les maisons. Le plan du Caterpillar anéantissant la maison de John Qualen renvoie à des images de la crise des subprimes. Le film inverse l’ordre des camps (on termine par le plus hospitalier, un de ces camps fédéraux initiés par Roosevelt et que les milices veulent détruire). Dans la version de Ford, le plan final était celui où Fonda gravit la colline mais Zanuck fit ajouter un dernier dialogue plus ouvert (« on ne peut pas nous balayer, nous sommes le peuple ») et Ford demanda à Zanuck de le tourner lui même.
Je me réjouis du triomphe de PETIT PAYSAN lors de son passage sur la deuxième chaîne et en profite pour rappeler C’EST QUOI LA VIE de François Dupeyron et pendant que j’y suis LES RAISINS DE LA COLÈRE qu’il est sain de revoir au moins une fois par an et en Blu-ray. En le revoyant, j’ai été bouleversé une fois encore et frappé par la force si actuelle de certaines séquences : l’entrée et la descriptions des terribles camps de migrants dirigés par des patrons impitoyables soutenus par des policiers déterminés à s’en prendre aux grévistes, la détresse de ces paysans dont détruit les terres et les maisons. Le plan du Caterpillar anéantissant la maison de John Qualen renvoie à des images de la crise des subprimes. Le film inverse l’ordre des camps (on termine par le plus hospitalier, un de ces camps fédéraux initiés par Roosevelt et que les milices veulent détruire). Dans la version de Ford, le plan final était celui où Fonda gravit la colline mais Zanuck fit ajouter un dernier dialogue plus ouvert (« on ne peut pas nous balayer, nous sommes le peuple ») et Ford demanda à Zanuck de le tourner lui même.
 Loïc Gautelier a consacré un vrai livre de fan à Mireille Balin, actrice d’une extraordinaire beauté (elle avait la plus belle descente de dos du cinéma français », disait Jean Delannoy qui lui mitonna une robe au décolleté dans le dos très audacieux dans MACAO L’ENFER DU JEU). Sa beauté, l’éclat de ses yeux éclipsa un vrai talent de comédienne, un jeu juste, retenu qu’on ne jugeait pas à sa vraie valeur comme pour Annabella. On leur préférait des actrices plus voyantes qui marquaient les effets dramatiques et du coup paraissent datées : revoyez Mireille Balin dans le sublime GUEULE D’AMOUR, dans MENACES ou PÉPÉ LE MOKO, DERNIER ATOUT. Elle y est formidable. Loïc Gautelier a admirablement documenté toute sa tragique fin de vie, après qu’elle été tabassée et violée par des FFI (qui auraient été condamnés des années après). Elle fut par la suite disculpée de toute collaboration avec l’ennemi (on peut regretter sa participation aux CADETS DE L’ALCAZAR à la gloire du franquisme) mais elle ne s’en remit jamais et termina en faisant des ménages. Les derniers chapitres, sa vie avec l’association la Roue Tourne de Paul Azaïs, les quelques interventions de Tino Rossi, sont extrêmement émouvantes (Editions Les Passagers du Rêve).
Loïc Gautelier a consacré un vrai livre de fan à Mireille Balin, actrice d’une extraordinaire beauté (elle avait la plus belle descente de dos du cinéma français », disait Jean Delannoy qui lui mitonna une robe au décolleté dans le dos très audacieux dans MACAO L’ENFER DU JEU). Sa beauté, l’éclat de ses yeux éclipsa un vrai talent de comédienne, un jeu juste, retenu qu’on ne jugeait pas à sa vraie valeur comme pour Annabella. On leur préférait des actrices plus voyantes qui marquaient les effets dramatiques et du coup paraissent datées : revoyez Mireille Balin dans le sublime GUEULE D’AMOUR, dans MENACES ou PÉPÉ LE MOKO, DERNIER ATOUT. Elle y est formidable. Loïc Gautelier a admirablement documenté toute sa tragique fin de vie, après qu’elle été tabassée et violée par des FFI (qui auraient été condamnés des années après). Elle fut par la suite disculpée de toute collaboration avec l’ennemi (on peut regretter sa participation aux CADETS DE L’ALCAZAR à la gloire du franquisme) mais elle ne s’en remit jamais et termina en faisant des ménages. Les derniers chapitres, sa vie avec l’association la Roue Tourne de Paul Azaïs, les quelques interventions de Tino Rossi, sont extrêmement émouvantes (Editions Les Passagers du Rêve).
 Pour les anglophones, je conseille un très bon livre de Sam Wasson sur CHINATOWN, THE BIG GOODBYE où on apprend plein de choses notamment sur la manière dont Polanski a sauvé, restructuré, élagué le scénario de Robert Towne, sur Edward Thomas qui collabora anonymement à tous les scénarios de Towne, écrivant des scènes, reconstruisant la narration sans que Towne daigne prononcer un éloge quand il mourut. Car CHINATOWN se termina mal pour au moins trois des quatre personnes qui le firent naître : Polanski commit un crime, Robert Evans et Towne devinrent accroc à la cocaïne, Evans qui avait permis au PARRAIN de se faire (dans la douleur) plus quelques autres grands films ambitieux fut viré et remplacé par des ilotes cyniques (la déclaration de Michael Eisner refusant qu’une oeuvre ait un contenu, des ambitions artistiques fait ressembler Harry Cohn à Spinoza). Wasson avait deja écrit un livre sur DIAMANTS SUR CANAPÉ.
Pour les anglophones, je conseille un très bon livre de Sam Wasson sur CHINATOWN, THE BIG GOODBYE où on apprend plein de choses notamment sur la manière dont Polanski a sauvé, restructuré, élagué le scénario de Robert Towne, sur Edward Thomas qui collabora anonymement à tous les scénarios de Towne, écrivant des scènes, reconstruisant la narration sans que Towne daigne prononcer un éloge quand il mourut. Car CHINATOWN se termina mal pour au moins trois des quatre personnes qui le firent naître : Polanski commit un crime, Robert Evans et Towne devinrent accroc à la cocaïne, Evans qui avait permis au PARRAIN de se faire (dans la douleur) plus quelques autres grands films ambitieux fut viré et remplacé par des ilotes cyniques (la déclaration de Michael Eisner refusant qu’une oeuvre ait un contenu, des ambitions artistiques fait ressembler Harry Cohn à Spinoza). Wasson avait deja écrit un livre sur DIAMANTS SUR CANAPÉ.
Les deux livres de Glenn Frankel sur THE SEARCHERS (j’ai appris que Ford avait improvisé en une après-midi toute la dernière séquence qui ne figurait pas dans le scénario de Frank Nugent) et HIGH NOON (LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS) sont remarquables et on découvre que le scénario du film est un miroir exact de ce qui se passait à Hollywood, la chasse aux communistes, le mouchardage (le scénariste/producteur Carl Foreman découvre qu’il est dénoncé par Lloyd Bridges, un des acteurs qu’il a engagé), la dictature d’une presse réactionnaire (remplacé de nos jours par les réseaux sociaux). Conduite très digne et courageuse de Fred Zinneman et Gary Cooper (« l’acteur le plus coopératif, le plus dévoué avec qui j’ai travaillé », me disait Zinneman) qui soutient totalement Foreman et crée même une société de production avec lui. Deux livres passionnant qui traitent des rapports raciaux et de la chasse aux sorcières.
SE BATTRE POUR LES DVD
Il existe des films en DVD où le plaisir qu’on prend à une œuvre passionnante, riche, exigeante est décuplé par le soin de la restauration et aussi par la qualité de certains bonus. C’est ce qui, pour moi, donne tant de prix à certaines éditions de films de patrimoine et que vous ne pouvez pas retrouver si vous téléchargez le même film ou le regardez en streaming. D’autant que des sites comme Netflix et autres Amazon ne favorisent guère (c’est même un euphémisme), ce cinéma de patrimoine, qu’ils diffusent à peine, répertorient mal sans cet appareil historique qu’on découvre parfois et qui peut se révéler passionnant. En plus, on fabrique des objets qui sont vraiment magnifiques, avec des livrets très documentés : les coffrets Ozu ou Naruse, ANATOMY OF A MURDER/AUTOPSIE D’UN MEUTRE chez Carlotta, ELMER GANTRY ( chef d’œuvre exaltant) chez Wild Side, NETWORK. GUN CRAZY, LA NUIT DU CHASSEUR qui sont devenus des « collectors ».
REMARQUABLES BONUS
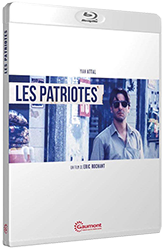 J’ai revu ainsi avec plaisir LES PATRIOTES de Rochant (où la juxtaposition des deux histoires continue à me paraître un peu aléatoire), ébloui comme la première fois par Sandrine Kiberlain, belle, sensuelle, provocante, brillante, Bernard Lecoq dont le changement de ton vous cueille toujours, Jean-François Stévenin, bouleversant et Yvan Attal. Dans le bonus, Rochant et son producteur Alain Rocca évoquent de manière très vivante l’ambition folle de ce projet , les formidables exigences du réalisateur et, hélas, la manière dont le film qui bénéficiait d’une réputation formidable, explosa en vol à la suite de la projection pour la presse à Cannes. Il fut exécuté le soir même avec une violence inouïe et totalement injuste. Ce qui détruisit les carrières des deux hommes.
J’ai revu ainsi avec plaisir LES PATRIOTES de Rochant (où la juxtaposition des deux histoires continue à me paraître un peu aléatoire), ébloui comme la première fois par Sandrine Kiberlain, belle, sensuelle, provocante, brillante, Bernard Lecoq dont le changement de ton vous cueille toujours, Jean-François Stévenin, bouleversant et Yvan Attal. Dans le bonus, Rochant et son producteur Alain Rocca évoquent de manière très vivante l’ambition folle de ce projet , les formidables exigences du réalisateur et, hélas, la manière dont le film qui bénéficiait d’une réputation formidable, explosa en vol à la suite de la projection pour la presse à Cannes. Il fut exécuté le soir même avec une violence inouïe et totalement injuste. Ce qui détruisit les carrières des deux hommes.
Dans UNE FEMME MARIÉE qui reste aussi neuf, aussi tranchant et splendide à voir que dans mon souvenir, Macha Méril parle de Jean-Luc Godard avec une grande liberté de ton. Elle fait preuve d’une franchises admirative mais lucide, sans langue de bois, parlant de son abandon (elle se laissait sculpter et le film est un hymne à son corps) louant son génie visuel, ses intuitions fulgurantes mais pointant sa radinerie, sa part de misogynie. Je n’ai pas encore eu le temps de revoir WEEK END que j’avais adoré.
Dans EAUX PROFONDES, cette histoire d’amour vénéneuse et secrète concoctée par Michel Deville où Isabelle Huppert paraît si enfantine bénéficie d’une passionnante interview de Deville et de Jean Louis Trintignant par Philippe Piazzo.
 BUFFET FROID se revoit avec délice et tant la vision du quartier de la Défense que certaines tirade se sont encore bonifiées avec le temps :
BUFFET FROID se revoit avec délice et tant la vision du quartier de la Défense que certaines tirade se sont encore bonifiées avec le temps :
L’assassin paranoïaque : « Beaucoup de meurtres en ce moment ? »
L’inspecteur Morvandiau : « Ça marche pas mal. »
L’assassin paranoïaque : « Et vous arrêtez les coupables ? »
L’inspecteur Morvandiau : « Le moins possible ! … Un coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu’en prison. »
Alphonse : « Pourquoi ? »
L’inspecteur Morvandiau : « Parce qu’en prison, il contamine les innocents. »
Là encore le bonus avec un délectable entretien avec Bertrand Blier est des plus savoureux.
Son intervention après HITLER CONNAIS PAS, œuvre rare, sortie par Jean-Baptiste Thoret est absolument passionnante. Vous ne trouvez rien d’équivalent sur Amazon ou Netflix.
Pour LE VOYAGEUR DE LA TOUSSAINT (Gaumont) de Louis Daquin, cette fort bonne adaptation de Simenon, écrite par Marcel Aymé, où triomphent Gabrielle Dorziat, Jules Berry, Guillaume de Sax (pour moi une révélation) et Jean Desailly (un habitué de Simenon) qui prend de plus en plus de consistance au fur et à mesure du récit, les suppléments sont plus classiques mais fort utiles. Ils permettent de re situer les origines italiennes des capitaux, ce qui explique la présence imposée de l’actrice Assia Norris. (L’un des points faibles du film), cernent les combats que dut mener Daquin et nous révèlent la présence furtive de Simone Signoret.
 LA BATAILLE DE L’EAU LOURDE témoigne d’une vraie sobriété qui faisait tout le prix d’HORIZONS SANS FINS et de LA FERME DU PENDU. Pas de grandiloquence ni d’élans lyrique mais une relation précise et minutieuse avec beaucoup d’extérieurs (filmé par Titus Muller ?). Jean Dréville invente un sous-genre, le docu drame mais je suis resté un peu distant face à ces dizaines de plans à skis tout en portant au crédit du film l’absence d’emphase et de sur-dramatisation qui anéantissait la médiocre version d’Anthony Mann. Dréville n’avait pas la tête épique, cela se sent tout au long du catastrophique LA FAYETTE. Frédéric Joliot-Curie joue son propre rôle sans vraiment convaincre.
LA BATAILLE DE L’EAU LOURDE témoigne d’une vraie sobriété qui faisait tout le prix d’HORIZONS SANS FINS et de LA FERME DU PENDU. Pas de grandiloquence ni d’élans lyrique mais une relation précise et minutieuse avec beaucoup d’extérieurs (filmé par Titus Muller ?). Jean Dréville invente un sous-genre, le docu drame mais je suis resté un peu distant face à ces dizaines de plans à skis tout en portant au crédit du film l’absence d’emphase et de sur-dramatisation qui anéantissait la médiocre version d’Anthony Mann. Dréville n’avait pas la tête épique, cela se sent tout au long du catastrophique LA FAYETTE. Frédéric Joliot-Curie joue son propre rôle sans vraiment convaincre.
Il faut aussi citer le travail accompli par TF1 et Coin de Mire notamment pour la qualité de leurs restaurations. J’ai pu découvrir LES BONNES CAUSES, un des meilleurs Christian-Jaque de la dernière période, bien écrit par Henri Jeanson. Brasseur et Marina Vlady sont mieux que convaincants et Bourvil est impeccable en juge d’instruction plus finaud, plus moral qu’il en a l’air (selon mon ami Alain Riou, le personnages est plus intéressant que celui du roman de Jean Laborde). Mais brusquement on tombe sur une scène qui met à mal l’édifice, une scène qui paraît artificielle, peu vraisemblable durant laquelle le magistrat présente un témoin surprise à la partie adverse qui va le terroriser, ce qui rend les défenseurs de Virna Lisi ineptes. Dans la même collection, L’AFFAIRE DOMINICI de Claude Bernard Aubert (pourra-t-on revoir PATROUILLE DE CHOC ?), un des grands rôles de Gabin, opaque, mutique, impressionnant. LA GROSSE CAISSE d’Alex Joffé que je n’ai jamais vu pas plus que LE BARON DE L’ÉCLUSE. Et bien sur ces deux chefs d’œuvre que sont NON COUPABLE, passé inaperçu, et GUEULE D’AMOUR. Je serai plus réservé sur les bonus qui privilégient les actualités.
Je veux ajouter la sortie de OLIVIA de Jacqueline Audry, autre film sous-estimé (zappé par les critiques de la Nouvelle Vague qui n’étaient ps du tout féministes) alors qu’il s’agit d’une des oeuvres les plus audacieuses sur l’homosexualité féminine traitée sans voyeurisme. On y entend Edwidge Feuillère, directrice d’un pensionnat, lire le lac de Lamartine et on peut y admirer Yvonne de Bray, actrice fétiche de Cocteau. Audry et Laroche adaptent un faux roman écrit par l’auteure anglaise qui traduisit Proust.
Il ne faut surtout pas oublier QUAND PASSENT LES CIGOGNES (en Blu-ray chez Potemkine) qui m’a encore bouleversé. Quand je pense qu’il fut de bon ton de faire la fine bouche devant cette histoire d’amour fiévreuse, passionnée, lyrique, qui vous emporte. Bonus remarquables, passionnants avec Françoise Navailh et Eugénie Zyvokine qui analysent aussi bien les procédés de la mise en scène (la manière dont le mouvements de grue soulignent les ratages, les manques, contrairement à ce qui est leur fonction première) que le contexte politique, historique.
COFFRET PABST
Merci à Tamasa d’avoir sorti un monumental coffret dédié à Pabst avec des belles copies restaurées où d’immenses et incontournables classiques comme LOULOU, L’AMOUR DE JEANNE NEY côtoient des œuvres plus rares : LA TRAGÉDIE DE LA MINE et surtout C’EST ARRIVÉ LE 20 JUILLET introuvable depuis des dizaines d’années. J’ai pu ainsi revoir QUATRE DE L’INFANTERIE le pendant allemand d’A L’OUEST RIEN DE NOUVEAU. Toutes les médiathèques doivent l’acheter.
FILMS PARLANT D’ÉPIDÉMIE
J’ai omis des dizaines de nanars.
CONTAGION de Steven Soderbergh, l’un des rares film américains totalement centré sur la notion de travail (repérer le virus, le combattre, lutter contre les fake news, la panique), sans intrigues sentimentales ou secondaires.
Le 7ème SCEAU de Bergman avec le grand Max Von Sydow
NOSFERATU version de Murnau et de Werner Herzog
LE MASQUE DE LA MORT ROUGE de Roger Corman (Sidonis) sur les vains efforts du Prince Prospero pour se confiner
PARS VITE ET REVIENS TARD de Régis Warnier. Fred Vargas est d’ailleurs une experte incollable sur les épidémies et la manière dont on identifié comment la peste se propageait.
LE MYSTÈRE ANDROMÈDE
LA NUIT DES MORTS VIVANTS
L’ÎLE DES MORTS de Mark Robson
L’ARMÉE DES DOUZE SINGES et peut être LA JETÉE de Chris Marker
LE HUSSARD SUR LE TOIT de Jean Paul Rappeneau d’après le formidable roman de Jean Giono
JE N’AI PAS TUÉ LINCOLN de John Ford
ARROWSMITH de John Ford
STARS IN MY CROWN de Jacques Tourneur qui contient une belle scène d’épidémie de même que I’D CLIMB THE HIGHEST MOUNTAIN de Henry King
JE SUIS UNE LÉGENDE
Lire la suite »





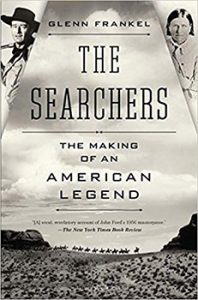
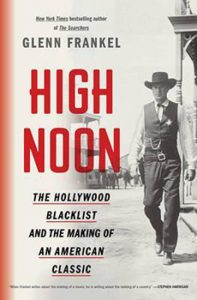





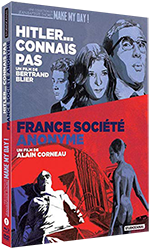

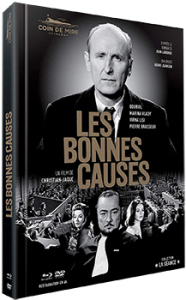

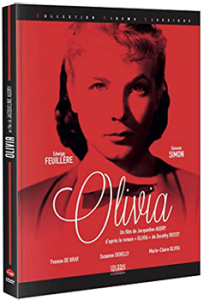


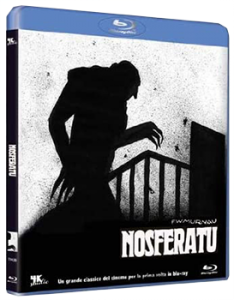
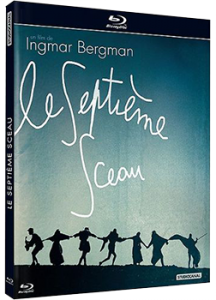

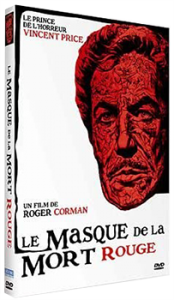
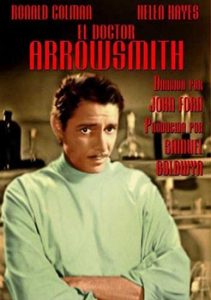
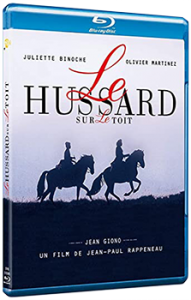
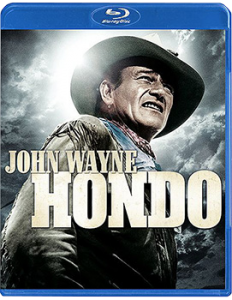 HONDO, L’HOMME DU DÉSERT vient enfin de (re)sortir en France avec un bonus très intéressant sur les Apaches et une présentation de Leonard Maltin. J’avais découvert ce western à sa sortie au Napoléon (mais pas dans la version en relief qui ne fut pas exploitée en France) puis revu toujours en VO à l’Artistic Douai et plusieurs fois en VF. On ne le dit jamais mais ce film fut critiqué de manière très positive par André Bazin dans Radio Cinéma, l’ancêtre de Télérama. J’ai réussi une fois à voir une vidéo américaine avec la version 3D et des lunettes (je le montrai à Jean-Claude Brisseau, admirateur du film). Farrow concentre les effets 3D durant la spectaculaire bagarre entre Wayne et Rodolfo Acosta et utilise le relief pour faire ressortir les entassements de rochers rouges, les ravins, pour dramatiser le paysage et donne une grande proximité aux séquences intimes particulièrement réussies, bien écrites par James Edward Grant. Elles sont denses, retenues, complexes même si on sait ce qui va se passer (ce qui fait partie du plaisir). Il faut dire que le choix de Geraldine Page est une remarquable idée. Elle débarrasse le personnage de toute mièvrerie, lui donne une force, une crédibilité, une profondeur assez rare et se révèle l’égale de Hondo. Ce choix est à porter aussi au crédit de Wayne, producteur du film (il adorait jouer avec des partenaires fortes et avait demandé Danielle Darrieux pour le BAGARREUR DU KENTUCKY) qui revendiquait également le traitement nuancé des Indiens : Hondo leur donne raison (ce sont les Blancs qui ont dénoncé le traité et ont menti) et parle avec émotion de sa femme indienne. Il les combat certes, pour défendre sa peau. Et Vittorio très bien incarné par Michael Pate est évoqué avec chaleur, sympathie mais sans fausse idéalisation. En fait Hondo constitue un trait d’union capital entre l’humanisme de Daves et LA FLÈCHE BRISÉE et le réalisme désenchanté d’Aldrich et de FUREUR APACHE qui vient de sortir en Blu-ray avec la version du réalisateur et celle de Lancaster. Voilà qui promet des comparaisons passionnantes. De Farrow, cinéaste passionnant, ne pas oublier LA GRANDE HORLOGE, le surprenant et visuellement très brillant UN PACTE AVEC LE DIABLE (Anthologie du Film Noir chez Sidonis) où Ray Milland incarne un Diable sophistiqué, qui sifflote dans le brouillard et qu’on ne voit jamais entrer dans une pièce. Deux remarquables scénarios de Jonathan Latimer sans oublier VAQUERO. Mais CALIFORNIE TERRE PROMISE est une déception que ne rachètent pas certains plans très longs – une obsession de Farrow – qui là ne rajoutent rien. Cette chronique est écrasée par le luxe de certains costumes (le premier que porte Stanwyck tue toute crédibilité), par un scénario mal centré, ponctué de curieux intermèdes musicaux avec choeurs et cloches. Les rapports entre Ray Milland et Stanwyck recensent tous les clichés du genre. On peut sauver le personnage que joue George Coulouris : un trafiquant d’esclave toujours hanté par le bruit des chaines.
HONDO, L’HOMME DU DÉSERT vient enfin de (re)sortir en France avec un bonus très intéressant sur les Apaches et une présentation de Leonard Maltin. J’avais découvert ce western à sa sortie au Napoléon (mais pas dans la version en relief qui ne fut pas exploitée en France) puis revu toujours en VO à l’Artistic Douai et plusieurs fois en VF. On ne le dit jamais mais ce film fut critiqué de manière très positive par André Bazin dans Radio Cinéma, l’ancêtre de Télérama. J’ai réussi une fois à voir une vidéo américaine avec la version 3D et des lunettes (je le montrai à Jean-Claude Brisseau, admirateur du film). Farrow concentre les effets 3D durant la spectaculaire bagarre entre Wayne et Rodolfo Acosta et utilise le relief pour faire ressortir les entassements de rochers rouges, les ravins, pour dramatiser le paysage et donne une grande proximité aux séquences intimes particulièrement réussies, bien écrites par James Edward Grant. Elles sont denses, retenues, complexes même si on sait ce qui va se passer (ce qui fait partie du plaisir). Il faut dire que le choix de Geraldine Page est une remarquable idée. Elle débarrasse le personnage de toute mièvrerie, lui donne une force, une crédibilité, une profondeur assez rare et se révèle l’égale de Hondo. Ce choix est à porter aussi au crédit de Wayne, producteur du film (il adorait jouer avec des partenaires fortes et avait demandé Danielle Darrieux pour le BAGARREUR DU KENTUCKY) qui revendiquait également le traitement nuancé des Indiens : Hondo leur donne raison (ce sont les Blancs qui ont dénoncé le traité et ont menti) et parle avec émotion de sa femme indienne. Il les combat certes, pour défendre sa peau. Et Vittorio très bien incarné par Michael Pate est évoqué avec chaleur, sympathie mais sans fausse idéalisation. En fait Hondo constitue un trait d’union capital entre l’humanisme de Daves et LA FLÈCHE BRISÉE et le réalisme désenchanté d’Aldrich et de FUREUR APACHE qui vient de sortir en Blu-ray avec la version du réalisateur et celle de Lancaster. Voilà qui promet des comparaisons passionnantes. De Farrow, cinéaste passionnant, ne pas oublier LA GRANDE HORLOGE, le surprenant et visuellement très brillant UN PACTE AVEC LE DIABLE (Anthologie du Film Noir chez Sidonis) où Ray Milland incarne un Diable sophistiqué, qui sifflote dans le brouillard et qu’on ne voit jamais entrer dans une pièce. Deux remarquables scénarios de Jonathan Latimer sans oublier VAQUERO. Mais CALIFORNIE TERRE PROMISE est une déception que ne rachètent pas certains plans très longs – une obsession de Farrow – qui là ne rajoutent rien. Cette chronique est écrasée par le luxe de certains costumes (le premier que porte Stanwyck tue toute crédibilité), par un scénario mal centré, ponctué de curieux intermèdes musicaux avec choeurs et cloches. Les rapports entre Ray Milland et Stanwyck recensent tous les clichés du genre. On peut sauver le personnage que joue George Coulouris : un trafiquant d’esclave toujours hanté par le bruit des chaines.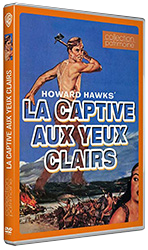 LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS est sortie chez TCM dans la version habituelle, un peu mieux restaurée. Rappelons que le DVD des Editions Montparnasse comprenait aussi la version longue, en fait une série de séquences plus développées, se perdant encore plus dans les méandres du récit qui faisaient tout le charme, le prix de cette œuvre exceptionnelle (hélas, cette version était restituée dans une copie souvent horrible) ainsi qu’une remarquable analyse de Todd McCarthy, le brillant auteur du HAWKS paru à l’Institut Lumière Actes Sud. On peut remarquer que Hawks est un des rares cinéastes qui énonce dans la voix off le thème qui inspire tant de ses films : « deux hommes étaient amis, survient une femme et ils ne le sont plus », facilitant ainsi les commentaires et exégèses. Mais le résultat est heureusement plus complexe que ce simple énoncé.
LA CAPTIVE AUX YEUX CLAIRS est sortie chez TCM dans la version habituelle, un peu mieux restaurée. Rappelons que le DVD des Editions Montparnasse comprenait aussi la version longue, en fait une série de séquences plus développées, se perdant encore plus dans les méandres du récit qui faisaient tout le charme, le prix de cette œuvre exceptionnelle (hélas, cette version était restituée dans une copie souvent horrible) ainsi qu’une remarquable analyse de Todd McCarthy, le brillant auteur du HAWKS paru à l’Institut Lumière Actes Sud. On peut remarquer que Hawks est un des rares cinéastes qui énonce dans la voix off le thème qui inspire tant de ses films : « deux hommes étaient amis, survient une femme et ils ne le sont plus », facilitant ainsi les commentaires et exégèses. Mais le résultat est heureusement plus complexe que ce simple énoncé.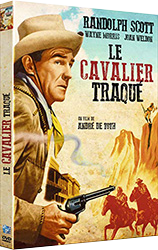 LE CAVALIER TRAQUÉ (Warner) dans les Randolph Scott dirigé par André de Toth est un des meilleurs titres. Surtout après la quinzième minute (encore que le début soit mieux filmé que dans mon souvenir), quand Scott parvenu dans une petite ville se heurte à l’incrédulité des habitants qui le prennent pour un complice des bandits qui ont attaqué la diligence alors qu’il venait les mettre en garde. Ce qui nous vaut une collection de crétins butés, soupçonneux, qui n’écoutent rien, des obsédés de la peine capitale : un personnage quasi-muet passe les deux tiers de l’histoire à se trimbaler avec un nœud coulant. De Toth multiplie les cadrages de film noir : contre-plongées ou encore plus nombreuses, plongées avec amorce, surgissement de personnages en gros plan. Il utilise très souvent en bordure de cadre les poteaux, les embrasures et utilise admirablement l’espace. Il rajouta le personnage du tenancier de « cantina » minable joué par Fritz Feld qui passe de l’espagnol baragouiné, à l’allemand voire au hongrois (« Mais quelle langue est-ce que je parle ? » dit il), tout en cherchant à protéger son miroir. Chester Morris est excellent en shérif débonnaire mais astucieux qui refuse tout lynchage. Quand un excité de la gâchette se vante devant lui, il lui tend son arme en disant « vas-y » dans un plan merveilleusement soldé. De Toth considérait Randolph Scott qu’il avait surnommé dans ses mémoires (éditions Actes Sud) « Machoire de granit », comme un vrai gentleman, un acteur limité mais courtois. Il produisait deux films par an tout en jouant à la bourse, sa vraie passion. Il était attaché à une formule assez routinière mais ni lui ni son associé, le producteur Harry Joe Brown, compétent et économe, n’avait la moindre sensibilité scénaristique. Pourvu que le film respecte un certain nombre de règles budgétaires mais aussi morales, il, laissait une vraie liberté aux réalisateurs pour la distribution (acceptant des partenaires qui pouvaient lui voler des scènes), le choix des extérieurs, le ton qu’allait donner la réalisation. De Toth disait de lui qu’il était imbattable dans un duel où il pouvait utiliser le Wall Street Journal. On pouvait s’en sortir mais il fallait lutter contre la paresse et la routine. Et Boetticher bénéficiera des combats menés par De Toth.
LE CAVALIER TRAQUÉ (Warner) dans les Randolph Scott dirigé par André de Toth est un des meilleurs titres. Surtout après la quinzième minute (encore que le début soit mieux filmé que dans mon souvenir), quand Scott parvenu dans une petite ville se heurte à l’incrédulité des habitants qui le prennent pour un complice des bandits qui ont attaqué la diligence alors qu’il venait les mettre en garde. Ce qui nous vaut une collection de crétins butés, soupçonneux, qui n’écoutent rien, des obsédés de la peine capitale : un personnage quasi-muet passe les deux tiers de l’histoire à se trimbaler avec un nœud coulant. De Toth multiplie les cadrages de film noir : contre-plongées ou encore plus nombreuses, plongées avec amorce, surgissement de personnages en gros plan. Il utilise très souvent en bordure de cadre les poteaux, les embrasures et utilise admirablement l’espace. Il rajouta le personnage du tenancier de « cantina » minable joué par Fritz Feld qui passe de l’espagnol baragouiné, à l’allemand voire au hongrois (« Mais quelle langue est-ce que je parle ? » dit il), tout en cherchant à protéger son miroir. Chester Morris est excellent en shérif débonnaire mais astucieux qui refuse tout lynchage. Quand un excité de la gâchette se vante devant lui, il lui tend son arme en disant « vas-y » dans un plan merveilleusement soldé. De Toth considérait Randolph Scott qu’il avait surnommé dans ses mémoires (éditions Actes Sud) « Machoire de granit », comme un vrai gentleman, un acteur limité mais courtois. Il produisait deux films par an tout en jouant à la bourse, sa vraie passion. Il était attaché à une formule assez routinière mais ni lui ni son associé, le producteur Harry Joe Brown, compétent et économe, n’avait la moindre sensibilité scénaristique. Pourvu que le film respecte un certain nombre de règles budgétaires mais aussi morales, il, laissait une vraie liberté aux réalisateurs pour la distribution (acceptant des partenaires qui pouvaient lui voler des scènes), le choix des extérieurs, le ton qu’allait donner la réalisation. De Toth disait de lui qu’il était imbattable dans un duel où il pouvait utiliser le Wall Street Journal. On pouvait s’en sortir mais il fallait lutter contre la paresse et la routine. Et Boetticher bénéficiera des combats menés par De Toth. On trouvait THUNDER OVER THE PLAINS (LA TRAHISON DU CAPITAINE PORTER) en zone 1 dans un DVD Warner regroupant dans de belles copies sans sous-titres trois Randolph Scott les deux autres étant LE CAVALIER TRAQUÉ cité plus haut et le médiocre THE MAN BEHIND THE GUN (LA TAVERNE DES RÉVOLTÉS) de Felix Feist. Quand on voit la paresse des cadres, des angles, la banalité des décors et des extérieurs dans le Feist, on apprécie d’autant plus le travail de De Toth dans THUNDER OVER THE PLAINS. Même quand il se heurte à des situations conventionnelles, il tente de les animer en utilisant des ravins, des déclivités, des terrains en pente qui lui permettent de faire surgir des cavaliers en fond de plan en partant d’une action près de la caméra. Et ces décors, chaque fois doivent compliquer les prises mais on sent qu’il y prend plaisir. Cela dynamise les surgissement de personnages, dramatise leurs rapports dans l’espace, d’autant qu’il joue sur les buissons, les troncs, les rapports entre les zones d’ombre et de lumière d’arbres pour aiguiser l’action, secondé par le grand chef opérateur Bert Glennon qui éclaira déjà le CAVALIER TRAQUÉ et ce policier mémorable CRIME WAVE (le film favori de Glennon me disait son fils) : un derringer en fond de plan tire sur une main qui tient un revolver en amorce. Le sujet est assez intéressant même si les rapports sentimentaux auraient pu être conventionnels. L’officier que joue Lex Barker (Tarzan à la RKO) voulant séduire la femme de Scott. De Toth traite cela avec sécheresse et cela renforce le mépris que Porter éprouve pour Barker pas trop mal distribué dans un personnage fayot, rigide et faux derche qu’il dissimule derrière son côté beau gosse. On peut aussi admirer Elisha Cook, grand copain de De Toth (il lui apprit la pêche à la mouche) et Charles McGraw en une sorte de Robin des Bois. Et j’avoue éprouver un vrai faible pour Phyllis Kirk, actrice que De Toth aimait beaucoup, la jugeant fine, intelligente et très sensible (il la dirigea dans THUNDER, dans CRIME WAVE/ CHASSE AU GANG (zone 1) où elle est magnifique, L’HOMME AU MASQUE DE CIRE). Souffrant de poliomyélite, elle dut presque interrompre sa carrière et devint attachée de presse. Démocrate militante, elle s’engagea contre la peine de mort, alla plusieurs fois visiter Cary Chessman, le célèbre condamné à mort dont le combat défraya la chronique et cet engagement freina sa carrière. Elle finança aussi après les émeutes de Watts des installation pré scolaires. Vive Phyllis Kirk !
On trouvait THUNDER OVER THE PLAINS (LA TRAHISON DU CAPITAINE PORTER) en zone 1 dans un DVD Warner regroupant dans de belles copies sans sous-titres trois Randolph Scott les deux autres étant LE CAVALIER TRAQUÉ cité plus haut et le médiocre THE MAN BEHIND THE GUN (LA TAVERNE DES RÉVOLTÉS) de Felix Feist. Quand on voit la paresse des cadres, des angles, la banalité des décors et des extérieurs dans le Feist, on apprécie d’autant plus le travail de De Toth dans THUNDER OVER THE PLAINS. Même quand il se heurte à des situations conventionnelles, il tente de les animer en utilisant des ravins, des déclivités, des terrains en pente qui lui permettent de faire surgir des cavaliers en fond de plan en partant d’une action près de la caméra. Et ces décors, chaque fois doivent compliquer les prises mais on sent qu’il y prend plaisir. Cela dynamise les surgissement de personnages, dramatise leurs rapports dans l’espace, d’autant qu’il joue sur les buissons, les troncs, les rapports entre les zones d’ombre et de lumière d’arbres pour aiguiser l’action, secondé par le grand chef opérateur Bert Glennon qui éclaira déjà le CAVALIER TRAQUÉ et ce policier mémorable CRIME WAVE (le film favori de Glennon me disait son fils) : un derringer en fond de plan tire sur une main qui tient un revolver en amorce. Le sujet est assez intéressant même si les rapports sentimentaux auraient pu être conventionnels. L’officier que joue Lex Barker (Tarzan à la RKO) voulant séduire la femme de Scott. De Toth traite cela avec sécheresse et cela renforce le mépris que Porter éprouve pour Barker pas trop mal distribué dans un personnage fayot, rigide et faux derche qu’il dissimule derrière son côté beau gosse. On peut aussi admirer Elisha Cook, grand copain de De Toth (il lui apprit la pêche à la mouche) et Charles McGraw en une sorte de Robin des Bois. Et j’avoue éprouver un vrai faible pour Phyllis Kirk, actrice que De Toth aimait beaucoup, la jugeant fine, intelligente et très sensible (il la dirigea dans THUNDER, dans CRIME WAVE/ CHASSE AU GANG (zone 1) où elle est magnifique, L’HOMME AU MASQUE DE CIRE). Souffrant de poliomyélite, elle dut presque interrompre sa carrière et devint attachée de presse. Démocrate militante, elle s’engagea contre la peine de mort, alla plusieurs fois visiter Cary Chessman, le célèbre condamné à mort dont le combat défraya la chronique et cet engagement freina sa carrière. Elle finança aussi après les émeutes de Watts des installation pré scolaires. Vive Phyllis Kirk ! Sidonis a récemment sorti l’admirable VALLÉE DE LA PEUR de Raoul Walsh, FEMME OU DÉMON de George Marshall, œuvre décontractée, nonchalante et farceuse plutôt qu’une vraie comédie qui évite les pièges de la parodie grâce à James Stewart et Marlene Dietrich (le film relança sa carrière) dont l’interaction est superbe et aux goûts de Marshall pour la bonne humeur joviale. Glenn Ford qui le découvrit durant le très plaisant TEXAS (zone 1) avait beaucoup de respect pour lui et le choisit pour LA VALLÉE DE LA POUDRE, racontant que Marshall demandait que les acteurs exécutent la plupart de leurs cascades eux-mêmes.
Sidonis a récemment sorti l’admirable VALLÉE DE LA PEUR de Raoul Walsh, FEMME OU DÉMON de George Marshall, œuvre décontractée, nonchalante et farceuse plutôt qu’une vraie comédie qui évite les pièges de la parodie grâce à James Stewart et Marlene Dietrich (le film relança sa carrière) dont l’interaction est superbe et aux goûts de Marshall pour la bonne humeur joviale. Glenn Ford qui le découvrit durant le très plaisant TEXAS (zone 1) avait beaucoup de respect pour lui et le choisit pour LA VALLÉE DE LA POUDRE, racontant que Marshall demandait que les acteurs exécutent la plupart de leurs cascades eux-mêmes.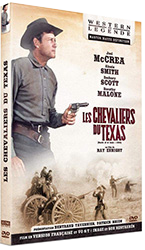 LES CHEVALIERS DU TEXAS (Sidonis) est un scénario traditionnel et conventionnel de James Webb avec des personnages sous-écrits. Quand on le découvrait, on ne retenait que l’histoire des éperons qui reste juste à l’état d’idée. Détail amusant, Alexis Smith s’appelle Rouge de L’Isle et on se demande qui on doit créditer de cette trouvaille savoureuse. Ray Enright donne un petit peu de dynamisme avec ses entrées de champ en contre-plongée et quelques cadrages dynamiques mais son travail reste fonctionnel. Les couleurs et la photo donnent du brillant à cette routine. Mieux vaut voir pour juger du talent d’Enright, BLONDIE JOHNSON (Warner, sous-titres français), un de ces épatants films pré-Code où le studio, le chef opérateur Tony Gaudio, les scénaristes jouent un rôle important. Mais la mise en scène est vive (les quatre premières scènes témoignent d’un réalisme cynique imparable) et sert bien un propos assez décapant où triomphe Joan Blondell, l’une des actrices phares de cette époque. Son personnage finit par contrôler un gang sans séduire ou tomber les truands, juste par son intelligence, ce qui est tout à fait original, voire contraire aux codes du genre. Dans la même collection aux jaquettes noires (qui hélas semble arrêtée), il ne faut pas manquer les remarquables FASCINATION et ÂME LIBRE de Clarence Brown (l’ouverture de FASCINATION reste l’une des plus fortes du genre de même que le plan de grue final), BABY FACE, mélodrame féministe tranchant et audacieux où Stanwyck est inoubliable, L’ANGE BLANC de Wellman, vanté ici à plusieurs reprises en même temps que HÉROS A VENDRE.
LES CHEVALIERS DU TEXAS (Sidonis) est un scénario traditionnel et conventionnel de James Webb avec des personnages sous-écrits. Quand on le découvrait, on ne retenait que l’histoire des éperons qui reste juste à l’état d’idée. Détail amusant, Alexis Smith s’appelle Rouge de L’Isle et on se demande qui on doit créditer de cette trouvaille savoureuse. Ray Enright donne un petit peu de dynamisme avec ses entrées de champ en contre-plongée et quelques cadrages dynamiques mais son travail reste fonctionnel. Les couleurs et la photo donnent du brillant à cette routine. Mieux vaut voir pour juger du talent d’Enright, BLONDIE JOHNSON (Warner, sous-titres français), un de ces épatants films pré-Code où le studio, le chef opérateur Tony Gaudio, les scénaristes jouent un rôle important. Mais la mise en scène est vive (les quatre premières scènes témoignent d’un réalisme cynique imparable) et sert bien un propos assez décapant où triomphe Joan Blondell, l’une des actrices phares de cette époque. Son personnage finit par contrôler un gang sans séduire ou tomber les truands, juste par son intelligence, ce qui est tout à fait original, voire contraire aux codes du genre. Dans la même collection aux jaquettes noires (qui hélas semble arrêtée), il ne faut pas manquer les remarquables FASCINATION et ÂME LIBRE de Clarence Brown (l’ouverture de FASCINATION reste l’une des plus fortes du genre de même que le plan de grue final), BABY FACE, mélodrame féministe tranchant et audacieux où Stanwyck est inoubliable, L’ANGE BLANC de Wellman, vanté ici à plusieurs reprises en même temps que HÉROS A VENDRE.

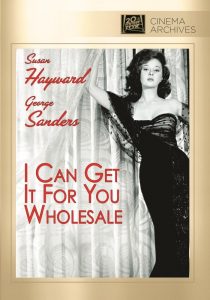 I CAN GET IT FOR YOU WHOLESALE (zone 1, pas de sous-titres) mérite d’être découvert ne serait-ce que pour la description de l’univers du prêt-à-porter dans les années 50 et pour l’interprétation remarquable de Susan Hayward dont le personnage possède la force, la volonté, le cynisme, l’ambition que l’on donnait à des acteurs comme Cagney ou Gable. L’ESCADRON NOIR m’a semblé meilleur que dans mon souvenir et toute la partie « traditionnelle » (poursuites, meetings politiques, attaque de diligence) est filmée par Walsh avec son dynamisme habituel. La course de la diligence vers un à pic sera maintes fois imitée. Le traitement de Quantrell (bien joué par Walter Pidgeon) est plus problématique. Le scénario qui trahit sans vergogne un beau roman de WR Burnett que j’espère faire traduire et publier, fait de ce criminel certes un forban sans vergogne, un pillard mais édulcore ses actions criminelles et surtout fait avorter son action la plus célèbre, le massacre de Lawrence où il assassina 162 civils. Le personnage stoppe le raid (imaginons un film où quelqu’un viendrait s’opposer au massacre d’Oradour). Tout le contexte politique du livre (la lutte entre les abolitionnistes et les esclavagistes, les reniements de Quantrell qui est dans le camp abolitionniste au début) est évacué du film. Normal on est à la Republic, studio ultra conformiste et familial. Cela dit Wayne est excellent et il a un charme fou même si sa romance avec Claire Trevor est moins complexe que chez Burnett. Roy Rogers sorti de ses westerns chantants, se révèle un acteur plus qu’acceptable. On peut préférer néanmoins LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT que je découvris à sa sortie au Triomphe et qui m’a toujours enthousiasmé par son allant, son dynamisme, la pulsion de la mise en scène (on a l’impression que la caméra pousse les personnages). Certes, ce remake d’AVENTURES EN BIRMANIE ne possède pas les enjeux, la force intérieure de l’original (les Séminoles sont un danger moins grand que les Japonais) mais le travail de Walsh est souvent exemplaire malgré quelques raccords en studio rajoutés par le producteur Milton Sperling (des plans de crocodiles qui ne raccordent pas avec les bayous). Belle musique de Max Steiner et l’intrigue sentimentale bien écrite par Niven Busch nous vaut deux scènes touchantes qui retournent brusquement le propos du film : Wyatt raconte comment sa femme indienne fut assassinée par des soldats.
I CAN GET IT FOR YOU WHOLESALE (zone 1, pas de sous-titres) mérite d’être découvert ne serait-ce que pour la description de l’univers du prêt-à-porter dans les années 50 et pour l’interprétation remarquable de Susan Hayward dont le personnage possède la force, la volonté, le cynisme, l’ambition que l’on donnait à des acteurs comme Cagney ou Gable. L’ESCADRON NOIR m’a semblé meilleur que dans mon souvenir et toute la partie « traditionnelle » (poursuites, meetings politiques, attaque de diligence) est filmée par Walsh avec son dynamisme habituel. La course de la diligence vers un à pic sera maintes fois imitée. Le traitement de Quantrell (bien joué par Walter Pidgeon) est plus problématique. Le scénario qui trahit sans vergogne un beau roman de WR Burnett que j’espère faire traduire et publier, fait de ce criminel certes un forban sans vergogne, un pillard mais édulcore ses actions criminelles et surtout fait avorter son action la plus célèbre, le massacre de Lawrence où il assassina 162 civils. Le personnage stoppe le raid (imaginons un film où quelqu’un viendrait s’opposer au massacre d’Oradour). Tout le contexte politique du livre (la lutte entre les abolitionnistes et les esclavagistes, les reniements de Quantrell qui est dans le camp abolitionniste au début) est évacué du film. Normal on est à la Republic, studio ultra conformiste et familial. Cela dit Wayne est excellent et il a un charme fou même si sa romance avec Claire Trevor est moins complexe que chez Burnett. Roy Rogers sorti de ses westerns chantants, se révèle un acteur plus qu’acceptable. On peut préférer néanmoins LES AVENTURES DU CAPITAINE WYATT que je découvris à sa sortie au Triomphe et qui m’a toujours enthousiasmé par son allant, son dynamisme, la pulsion de la mise en scène (on a l’impression que la caméra pousse les personnages). Certes, ce remake d’AVENTURES EN BIRMANIE ne possède pas les enjeux, la force intérieure de l’original (les Séminoles sont un danger moins grand que les Japonais) mais le travail de Walsh est souvent exemplaire malgré quelques raccords en studio rajoutés par le producteur Milton Sperling (des plans de crocodiles qui ne raccordent pas avec les bayous). Belle musique de Max Steiner et l’intrigue sentimentale bien écrite par Niven Busch nous vaut deux scènes touchantes qui retournent brusquement le propos du film : Wyatt raconte comment sa femme indienne fut assassinée par des soldats.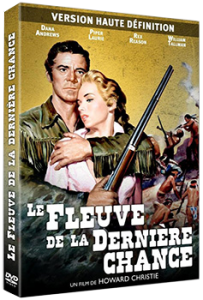 LE FLEUVE DE LA DERNIÈRE CHANCE de Jerry Hopper (dont sort l’agréable UNE AVENTURE DE BUFFALO BILL, western historique complètement faux mais fort amusant), n’est pas trop mal écrit avec des extérieurs dans le Colorado amples, spectaculaires. Le premier tiers est d’ailleurs plutôt efficace avec une bonne interprétation de William Tallman. Malheureusement, dès la descente de la rivière, d’horribles transparences figent la mise en scène et le propos.
LE FLEUVE DE LA DERNIÈRE CHANCE de Jerry Hopper (dont sort l’agréable UNE AVENTURE DE BUFFALO BILL, western historique complètement faux mais fort amusant), n’est pas trop mal écrit avec des extérieurs dans le Colorado amples, spectaculaires. Le premier tiers est d’ailleurs plutôt efficace avec une bonne interprétation de William Tallman. Malheureusement, dès la descente de la rivière, d’horribles transparences figent la mise en scène et le propos. Sortie chez Doriane de THE BROWNING VERSION d’Anthony Asquith d’après Terence Rattigan (la pièce fut montée par Didier Bezace) dont j’ai dit plusieurs fois ici tout le bien qu’il fallait en penser. Interprétation inoubliable de Michael Redgrave. On doit aussi à Terence Rattigan les scénarios du MUR DU SON, l’un des David Lean les plus secrets et les plus touchants et du ROCHER DE BRIGHTON de Roy Bouting.
Sortie chez Doriane de THE BROWNING VERSION d’Anthony Asquith d’après Terence Rattigan (la pièce fut montée par Didier Bezace) dont j’ai dit plusieurs fois ici tout le bien qu’il fallait en penser. Interprétation inoubliable de Michael Redgrave. On doit aussi à Terence Rattigan les scénarios du MUR DU SON, l’un des David Lean les plus secrets et les plus touchants et du ROCHER DE BRIGHTON de Roy Bouting.
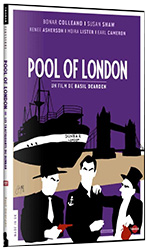
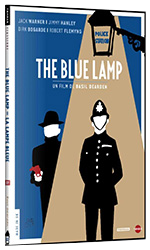

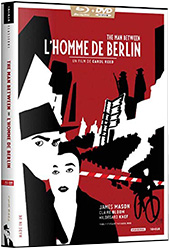
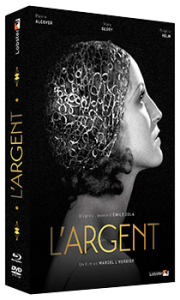 L’ARGENT de Marcel L’Herbier (Lobster), pour moi son chef d’œuvre le plus brillant, le plus inspiré, quasiment dépourvu des afféteries qui pèsent sur une partie de son œuvre : les séquences à la Bourse avec les travellings vertigineux qui surplombent les personnages, volent au dessus d’eux n’ont rien à envier au LOUP DE WALL STREET. Il ne faut pas manquer le remarquable AUTOUR DE L’ARGENT de Jean Dréville, sans doute le premier making of de l’Histoire du cinéma et l’un des plus réussis. Je ne me souviens plus qui avait écrit que Lherbier présentait un étrange air de ressemblance avec Jean-Luc Godard.
L’ARGENT de Marcel L’Herbier (Lobster), pour moi son chef d’œuvre le plus brillant, le plus inspiré, quasiment dépourvu des afféteries qui pèsent sur une partie de son œuvre : les séquences à la Bourse avec les travellings vertigineux qui surplombent les personnages, volent au dessus d’eux n’ont rien à envier au LOUP DE WALL STREET. Il ne faut pas manquer le remarquable AUTOUR DE L’ARGENT de Jean Dréville, sans doute le premier making of de l’Histoire du cinéma et l’un des plus réussis. Je ne me souviens plus qui avait écrit que Lherbier présentait un étrange air de ressemblance avec Jean-Luc Godard.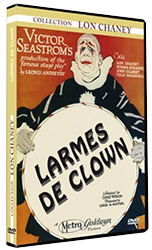 LARMES DE CLOWN (HE WHO GETS SLAPPED) chez Bach films, copie correcte. Deuxième film américain de Victor Sjöström rebaptisé Seastrom, après NAME THE MAN pour Samuel Goldwyn, HE WHO GETS SLAPPED est une œuvre noire, très européenne, qui traite de l’humiliation, de l’avilissement, de la bassesse humaine, sujets rarement abordés dans le cinéma américain. Il faut dire que Sjöström et son co-scénariste Carey Wilson adaptent en toute liberté un auteur réputé pour son pessimisme, Leonid Andreïev, écrivain et dramaturge russe, anti-tsariste et anti-bolchevique dont Gorki disait qu’il était « d’une effrayante perspicacité ». Un savant, Paul Baumont, se fait dépouiller de ses recherches et voler sa femme par le baron Regnard, un soi disant mécène qui l’humilie devant ses confrères de l’Académie des Sciences. Il va se réfugier dans un cirque en devenant clown, invente un numéro où, sans cesse giflé, il est à nouveau humilié mais remporte un triomphe. Il va retomber amoureux d’une belle écuyère (Norma Shearer, juste et gracieuse) et ce sera une nouvelle désillusion. Sjöström domine son sujet avec une incroyable maestria, passant avec une rare fluidité de l’allégorie tragique avec ce clown faisant tourner un ballon qui devient le globe terrestre – lancinant leitmotiv – cette piste aux étoiles symbolisant le monde dans ce qu’il a de plus aveugle, de pire, à des séquences réalistes qu’il traite avec une concision fulgurante : trois plans suffisent pour évoquer l’abjecte muflerie avec laquelle le baron renvoie sa femme, une fermeture à l’iris sur un collier signifie que le père de l’écuyère a vendu sa fille. Le ton du film, décapant, impitoyable, mais empreint de compassion, évoque l’univers d’Ibsen, de Strindberg et on comprend l’admiration que Bergman éprouvait pour Sjöström qu’il fit jouer dans LES FRAISES SAUVAGES et sans doute pour ce film auquel il rend hommage dans LA NUIT DES FORAINS. Interprétation géniale de Lon Chaney. Son plus grand rôle avec L’INCONNU de Todd Browning.
LARMES DE CLOWN (HE WHO GETS SLAPPED) chez Bach films, copie correcte. Deuxième film américain de Victor Sjöström rebaptisé Seastrom, après NAME THE MAN pour Samuel Goldwyn, HE WHO GETS SLAPPED est une œuvre noire, très européenne, qui traite de l’humiliation, de l’avilissement, de la bassesse humaine, sujets rarement abordés dans le cinéma américain. Il faut dire que Sjöström et son co-scénariste Carey Wilson adaptent en toute liberté un auteur réputé pour son pessimisme, Leonid Andreïev, écrivain et dramaturge russe, anti-tsariste et anti-bolchevique dont Gorki disait qu’il était « d’une effrayante perspicacité ». Un savant, Paul Baumont, se fait dépouiller de ses recherches et voler sa femme par le baron Regnard, un soi disant mécène qui l’humilie devant ses confrères de l’Académie des Sciences. Il va se réfugier dans un cirque en devenant clown, invente un numéro où, sans cesse giflé, il est à nouveau humilié mais remporte un triomphe. Il va retomber amoureux d’une belle écuyère (Norma Shearer, juste et gracieuse) et ce sera une nouvelle désillusion. Sjöström domine son sujet avec une incroyable maestria, passant avec une rare fluidité de l’allégorie tragique avec ce clown faisant tourner un ballon qui devient le globe terrestre – lancinant leitmotiv – cette piste aux étoiles symbolisant le monde dans ce qu’il a de plus aveugle, de pire, à des séquences réalistes qu’il traite avec une concision fulgurante : trois plans suffisent pour évoquer l’abjecte muflerie avec laquelle le baron renvoie sa femme, une fermeture à l’iris sur un collier signifie que le père de l’écuyère a vendu sa fille. Le ton du film, décapant, impitoyable, mais empreint de compassion, évoque l’univers d’Ibsen, de Strindberg et on comprend l’admiration que Bergman éprouvait pour Sjöström qu’il fit jouer dans LES FRAISES SAUVAGES et sans doute pour ce film auquel il rend hommage dans LA NUIT DES FORAINS. Interprétation géniale de Lon Chaney. Son plus grand rôle avec L’INCONNU de Todd Browning. Les muets de Clarence Brown sont introuvables sauf THE EAGLE dans une copie des plus médiocres chez Bach Film et le très beau visuellement THE FLESH AND THE DEVIL dans un coffret Garbo sorti par TCM, un de ses meilleurs films avec WOMAN OF AFFAIRS. Célèbre pour ses scènes d’amour passionnées et le duel célèbre avec ce gigantesque travelling arrière qui fait sortir du champ les deux adversaires qui se détachent sur la ligne d’horizon et les relègue en hors champs lors des coups de feu.
Les muets de Clarence Brown sont introuvables sauf THE EAGLE dans une copie des plus médiocres chez Bach Film et le très beau visuellement THE FLESH AND THE DEVIL dans un coffret Garbo sorti par TCM, un de ses meilleurs films avec WOMAN OF AFFAIRS. Célèbre pour ses scènes d’amour passionnées et le duel célèbre avec ce gigantesque travelling arrière qui fait sortir du champ les deux adversaires qui se détachent sur la ligne d’horizon et les relègue en hors champs lors des coups de feu.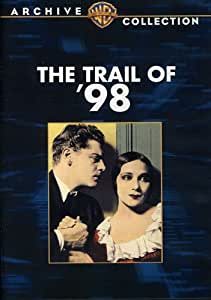 On trouve en zone 1 THE TRAIL OF 98 (Warner archive), évocation épique de la ruée de 1898 vers le Klondike pour y trouver de l’or qui inspira aussi Chaplin. Les scénaristes Benjamin Glazier et Waldemar Young choisissent au début une structure chorale, avec de multiples personnages, figures emblématiques du genre – jeunes gens sans expérience, un chauffeur de locomotive, couple de commerçants, un jeune garçon, aventuriers divers, escrocs – qui, peu à peu, s’épure, se resserre autour de quelques destins. Ces personnages sont souvent ballottés, voire noyés, dans la foule, ce qui nous vaut de nombreuses scènes avec des multitudes de figurants étonnantes de réalisme (elles sont truffées de détails pittoresques) et spectaculaires : embarquements sur des bateaux archi combles, camps de chercheur d’or, villes champignon en proie à l’agitation, à la folie, ascension de la terrible Chilkoot Pass. Les intérieurs sont tout aussi soignés du saloon remplis d’ivrognes, de joueurs aux décors misérables de cahutes, de cabanes où le héros abandonne sa fiancée, idée dramatique assez forte que son revirement ne parvient pas à combler. Voilà une des œuvres – il n’y en a pas tant que cela – qui renvoie à l’univers de Jack London.
On trouve en zone 1 THE TRAIL OF 98 (Warner archive), évocation épique de la ruée de 1898 vers le Klondike pour y trouver de l’or qui inspira aussi Chaplin. Les scénaristes Benjamin Glazier et Waldemar Young choisissent au début une structure chorale, avec de multiples personnages, figures emblématiques du genre – jeunes gens sans expérience, un chauffeur de locomotive, couple de commerçants, un jeune garçon, aventuriers divers, escrocs – qui, peu à peu, s’épure, se resserre autour de quelques destins. Ces personnages sont souvent ballottés, voire noyés, dans la foule, ce qui nous vaut de nombreuses scènes avec des multitudes de figurants étonnantes de réalisme (elles sont truffées de détails pittoresques) et spectaculaires : embarquements sur des bateaux archi combles, camps de chercheur d’or, villes champignon en proie à l’agitation, à la folie, ascension de la terrible Chilkoot Pass. Les intérieurs sont tout aussi soignés du saloon remplis d’ivrognes, de joueurs aux décors misérables de cahutes, de cabanes où le héros abandonne sa fiancée, idée dramatique assez forte que son revirement ne parvient pas à combler. Voilà une des œuvres – il n’y en a pas tant que cela – qui renvoie à l’univers de Jack London.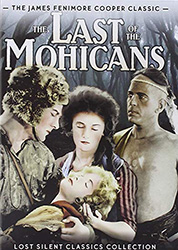 LE DERNIER DES MOHICANS est une belle et puissante adaptation du roman de Fenimore Cooper parue en 1826, dont la traduction vient enfin d’être revue en 2017, rétablissant aussi certains passages coupés ou censurés (éditions Gallmeister) et qui avait été immédiatement salué par George Sand comme le note François Guerif : « … par la voix tranquille mais retentissante du romancier, l’Amérique a laissé échapper ce cri de la conscience : Pour être ce que nous sommes, il nous a fallu tuer une grande race et ravager une grande nature… Ce que chante et pleure Cooper, c’est une noble race exterminée, c’est une nature sublime dévastée, c’est l’homme. » Un ou deux plans de paysage, amples, majestueux remplacent de longues descriptions d’autant que pour la première fois, Tourneur et Brown utilisaient la pellicule panchromatique permettant enfin de photographier les ciels et les nuages. Les plans très larges et très impressionnants tournés par Brown à Yosemite Park ont rarement été égalés et le combat entre Cora et Magua, sur un éperon rocheux, garde une puissance intacte, filmé au dessus du vide, On sait que ces séquences d’extérieurs furent tournée par Clarence Brown, Tourneur s’étant cassé la jambe après quelques jours de tournage au lac de Big Bear. Christine Leteux lui attribue environ 50% du film.
LE DERNIER DES MOHICANS est une belle et puissante adaptation du roman de Fenimore Cooper parue en 1826, dont la traduction vient enfin d’être revue en 2017, rétablissant aussi certains passages coupés ou censurés (éditions Gallmeister) et qui avait été immédiatement salué par George Sand comme le note François Guerif : « … par la voix tranquille mais retentissante du romancier, l’Amérique a laissé échapper ce cri de la conscience : Pour être ce que nous sommes, il nous a fallu tuer une grande race et ravager une grande nature… Ce que chante et pleure Cooper, c’est une noble race exterminée, c’est une nature sublime dévastée, c’est l’homme. » Un ou deux plans de paysage, amples, majestueux remplacent de longues descriptions d’autant que pour la première fois, Tourneur et Brown utilisaient la pellicule panchromatique permettant enfin de photographier les ciels et les nuages. Les plans très larges et très impressionnants tournés par Brown à Yosemite Park ont rarement été égalés et le combat entre Cora et Magua, sur un éperon rocheux, garde une puissance intacte, filmé au dessus du vide, On sait que ces séquences d’extérieurs furent tournée par Clarence Brown, Tourneur s’étant cassé la jambe après quelques jours de tournage au lac de Big Bear. Christine Leteux lui attribue environ 50% du film.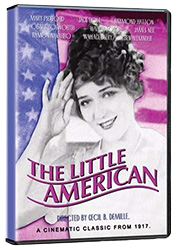 Dans les films de Mary Pickford sortis dans des copies correctes par Bach Films, il faut regarder THE LITTLE AMERICAN de Cecil B. DeMille, un film dont le tournage débuta sans doute avant que l’Amérique entre en guerre nous dit Patrick Brion. DeMille utilise le torpillage du Lusitania, ce qui lui inspire une assez belle séquence nocturne où l’on voit les passagers sauter dans l’eau, éclairés par de rares projecteurs. Les Allemands sont tous décrits comme des brutes sadiques qui violentent les domestiques et femmes de ménage (« mes hommes ont besoin de se relaxer », répond un officier allemand à Pickford), saccagent stupidement le mobilier et les tableaux, achèvent les blessés. Le ton est hyper patriotique et dès le générique, Pickford est drapée dans un drapeau américain (l’un de ses soupirants lui offre des bonbons avec tous les états et les étoiles). La course des amants qui se sont enfin retrouvés à travers les ruines nous vaut quelques plans admirables qui font oublier une interprétation très inégale (Pickford qui s’entendit mal avec le cinéaste est nettement plus juste que ses partenaires masculins) et les conventions mélodramatiques du scénario.
Dans les films de Mary Pickford sortis dans des copies correctes par Bach Films, il faut regarder THE LITTLE AMERICAN de Cecil B. DeMille, un film dont le tournage débuta sans doute avant que l’Amérique entre en guerre nous dit Patrick Brion. DeMille utilise le torpillage du Lusitania, ce qui lui inspire une assez belle séquence nocturne où l’on voit les passagers sauter dans l’eau, éclairés par de rares projecteurs. Les Allemands sont tous décrits comme des brutes sadiques qui violentent les domestiques et femmes de ménage (« mes hommes ont besoin de se relaxer », répond un officier allemand à Pickford), saccagent stupidement le mobilier et les tableaux, achèvent les blessés. Le ton est hyper patriotique et dès le générique, Pickford est drapée dans un drapeau américain (l’un de ses soupirants lui offre des bonbons avec tous les états et les étoiles). La course des amants qui se sont enfin retrouvés à travers les ruines nous vaut quelques plans admirables qui font oublier une interprétation très inégale (Pickford qui s’entendit mal avec le cinéaste est nettement plus juste que ses partenaires masculins) et les conventions mélodramatiques du scénario.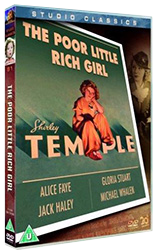 POOR LITTLE RICH GIRL de Maurice Tourneur est le deuxième et, hélas, dernier film qu’il tournera avec Pickford. Pour une fois, elle ne joue pas une orpheline mais une petite fille que ses parents fort riches délaissent : son père est absorbé par ses combines financières et sa mère par ses soins de beauté et ses occupations mondaines. La gamine est abandonnée à des domestiques, à une gouvernante acariâtre et rigide qui lui interdit de se promener à pied, d’inviter des amis. Le ton du film, écrit par la grande Frances Marion, est vraiment adulte et ambitieux si l’on excepte une médiocre bagarre dans la boue que Tourneur ne voulait pas filmer, la trouvant hors sujet comme l’écrit Christine Leteux. Quand Pickford tombe malade, le ton devient onirique et côtoie le fantastique. On y croise des silhouettes maléfiques (la mort ?), des animaux étranges et l’on passe sans cesse de la réalité au rêve. A découvrir.
POOR LITTLE RICH GIRL de Maurice Tourneur est le deuxième et, hélas, dernier film qu’il tournera avec Pickford. Pour une fois, elle ne joue pas une orpheline mais une petite fille que ses parents fort riches délaissent : son père est absorbé par ses combines financières et sa mère par ses soins de beauté et ses occupations mondaines. La gamine est abandonnée à des domestiques, à une gouvernante acariâtre et rigide qui lui interdit de se promener à pied, d’inviter des amis. Le ton du film, écrit par la grande Frances Marion, est vraiment adulte et ambitieux si l’on excepte une médiocre bagarre dans la boue que Tourneur ne voulait pas filmer, la trouvant hors sujet comme l’écrit Christine Leteux. Quand Pickford tombe malade, le ton devient onirique et côtoie le fantastique. On y croise des silhouettes maléfiques (la mort ?), des animaux étranges et l’on passe sans cesse de la réalité au rêve. A découvrir.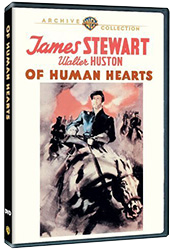 OF HUMAN HEARTS (Warner Archive), une vraie découverte, est moins handicapé par les conventions dramaturgiques même si, vers la fin, une ou deux coïncidences permettent de résoudre des problèmes et tirent le film vers la fable. Brown avait acheté quelque années après sa parution en 1917, les droits de BENEFITS FORGOTS, une longue nouvelle de Honore Morrow, incluse dans une de ses biographies de Lincoln (il en écrira au moins deux autres par la suite). Le titre reprend une citation de Shakespeare dans COMME IL VOUS PLAIRA que cite Lincoln face à une fenêtre, dans le film : « Gèle, Gèle, ciel rigoureux / Ta morsure est moins cruelle / est moins cruelle/ Que celle d’une bienfait oublié ». Véritable hymne à l’amour maternel, cette chronique pastorale, tout comme THE YEARLING, se révèle étonnamment complexe, voire sombre. Là où l’on attendait une exaltation des petites communautés provinciales – l’action se déroule dans une bourgade de l’Ohio – refuge des valeurs traditionnelles, on a droit à un portait sans complaisance de villageois égoïstes, avares qui rabiotent le salaire du pasteur, donnent leurs habits les plus usés. Ils sont ragoteurs, étroits d’esprit. Leur pauvreté n’excuse pas une radinerie manifeste sans parler du désir de voler et gruger l’autre, à l’image de cet épicier prêteur sur gages qu’incarne excellemment Guy Kibbee. Remis vertement à sa place par le pasteur (Walter Huston), il n’en continuera pas moins à dépouiller sa femme tout en l’ensevelissant sous les compliments cauteleux. Les rapports familiaux sous des dehors rassurants sont tout aussi conflictuels, empreints de dureté, comme dans THE GOOSE WOMAN, THE YEARLING, INTRUDER IN THE DUST. Le pasteur, droit, courageux, vit pratiquement aux crochets de sa femme qu’il n’écoute guère, fait preuve envers son fils Jason de rigidité, d’intolérance, lui interdisant de lire les livres qu’il n’a pas choisis, jetant les revues données par le médecin du village, parce que c’est un ivrogne qui joue aux cartes. Un plan poignant nous montre le jeune garçon (remarquable Gene Reynolds, si bien choisi) prostré dans une étable, éclairée par une seule lampe. Et quelques années plus tard, Jason (James Stewart dans une interprétation sous-estimée) finira par se battre avec son père pour pouvoir partir étudier la médecine. Mais loin de se transformer en héros idéaliste, son personnage avec ses pulsions égoïstes, sa vanité, anticipe sur les personnages complexes, tourmentés qu’il jouera chez Mann, Hitchcock, Capra.
OF HUMAN HEARTS (Warner Archive), une vraie découverte, est moins handicapé par les conventions dramaturgiques même si, vers la fin, une ou deux coïncidences permettent de résoudre des problèmes et tirent le film vers la fable. Brown avait acheté quelque années après sa parution en 1917, les droits de BENEFITS FORGOTS, une longue nouvelle de Honore Morrow, incluse dans une de ses biographies de Lincoln (il en écrira au moins deux autres par la suite). Le titre reprend une citation de Shakespeare dans COMME IL VOUS PLAIRA que cite Lincoln face à une fenêtre, dans le film : « Gèle, Gèle, ciel rigoureux / Ta morsure est moins cruelle / est moins cruelle/ Que celle d’une bienfait oublié ». Véritable hymne à l’amour maternel, cette chronique pastorale, tout comme THE YEARLING, se révèle étonnamment complexe, voire sombre. Là où l’on attendait une exaltation des petites communautés provinciales – l’action se déroule dans une bourgade de l’Ohio – refuge des valeurs traditionnelles, on a droit à un portait sans complaisance de villageois égoïstes, avares qui rabiotent le salaire du pasteur, donnent leurs habits les plus usés. Ils sont ragoteurs, étroits d’esprit. Leur pauvreté n’excuse pas une radinerie manifeste sans parler du désir de voler et gruger l’autre, à l’image de cet épicier prêteur sur gages qu’incarne excellemment Guy Kibbee. Remis vertement à sa place par le pasteur (Walter Huston), il n’en continuera pas moins à dépouiller sa femme tout en l’ensevelissant sous les compliments cauteleux. Les rapports familiaux sous des dehors rassurants sont tout aussi conflictuels, empreints de dureté, comme dans THE GOOSE WOMAN, THE YEARLING, INTRUDER IN THE DUST. Le pasteur, droit, courageux, vit pratiquement aux crochets de sa femme qu’il n’écoute guère, fait preuve envers son fils Jason de rigidité, d’intolérance, lui interdisant de lire les livres qu’il n’a pas choisis, jetant les revues données par le médecin du village, parce que c’est un ivrogne qui joue aux cartes. Un plan poignant nous montre le jeune garçon (remarquable Gene Reynolds, si bien choisi) prostré dans une étable, éclairée par une seule lampe. Et quelques années plus tard, Jason (James Stewart dans une interprétation sous-estimée) finira par se battre avec son père pour pouvoir partir étudier la médecine. Mais loin de se transformer en héros idéaliste, son personnage avec ses pulsions égoïstes, sa vanité, anticipe sur les personnages complexes, tourmentés qu’il jouera chez Mann, Hitchcock, Capra.