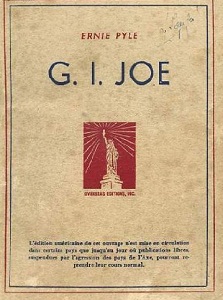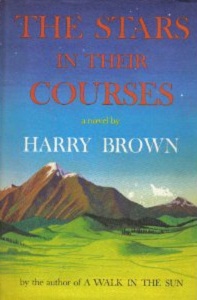Dans l’indispensable collection rouge de la Gaumont, quelques curiosités. En premier lieu, LE RIDEAU ROUGE, seule réalisation du metteur en scène de théâtre André Barsacq (le résultat n’est pas totalement concluant), écrite (et codirigée ?) par Anouilh, lequel donne son vrai ton, sa vraie couleur, son originalité au film. On retrouve certains de ses thèmes, de ses préoccupations, les rapports entre le théâtre et la vie.
Dans l’indispensable collection rouge de la Gaumont, quelques curiosités. En premier lieu, LE RIDEAU ROUGE, seule réalisation du metteur en scène de théâtre André Barsacq (le résultat n’est pas totalement concluant), écrite (et codirigée ?) par Anouilh, lequel donne son vrai ton, sa vraie couleur, son originalité au film. On retrouve certains de ses thèmes, de ses préoccupations, les rapports entre le théâtre et la vie.
Des comédiens répètent Macbeth sous la direction d’un metteur en scène tyrannique (Michel Simon) qui est assassiné. Lors de l’enquête policière, on découvre les correspondances entre la pièce et la vie, la manière dont la vie privée des protagonistes recoupait, décalquait l’intrigue shakespearienne. Le flic qui s’acharne à voir Macbeth jusqu’au bout (Olivier Hussenot, très marrant), découvrira le meurtrier et son mobile, triomphant sur son collègue, pétri d’ignorance, qui déteste le théâtre (l’excellent Jean Brochard). Cet étrange plaidoyer pour l’Art Dramatique, assez raide dans ses effets de miroirs, nous permet de voir le théâtre de l’Atelier, la place et les rues qui l’entourent. Je trouve que Brasseur est un Macbeth tonitruant et pas du tout convaincant, qu’il a du mal à apprivoiser la langue de Shakespeare et que Monelle Valentin est nulle. En revanche, Noel Roquevert, formidable en cabot qui veut vous faire profiter de tous les rôles qu’il a joués, vole le film même si d’autres acteurs sont savoureux, en particulier Marcel Peres, en bruiteur.

 Viennent de sortir DEUX SOUS DE VIOLETTES, le seul film vraiment réalisé par Anouilh, et LA CHAMBRE ARDENTE que j’ai trouvé plus visible que je m’y attendais. Certes, Duvivier et Spaak dans leur adaptation, massacrent l’énigmatique et complexe roman de John Dickson Carr (incompréhension de cette famille de scénaristes devant une littérature policière anglo-saxonne ; cf. l’échec du MEURTRIER, de Lara et d’Aurenche), n’en retiennent pas la construction, délocalisent l’intrigue dans la Forêt Noire (pourquoi n’avoir pas gardé la France ? Il faudrait étudier l’attrait néfaste que l’Allemagne a exercé sur certains cinéastes français dans les années 50, notamment Duvivier qui y tourne MARIANNE DE MA JEUNESSE, L’AFFAIRE MAURIZIUS ; ce n’est pas seulement une affaire de coproduction) ce qui rend tout solennel et difficile à comprendre (comment relier la marquise de Brinvilliers et l’Allemagne ?). Mais Claude Rich (qui avait su apprivoiser Duvivier) est formidable, Brialy pas mal, Edith Scob (Duvivier reprend des acteurs de la nouvelle génération) défend un personnage incompréhensible. Mais la palme revient à Piéplu qui s’est fait une tête irrésistible de policier allemand et qui bénéficie du meilleur dialogue. Il justifie la vision du film. Duvivier, qui était très en souffrance à cette époque face au mépris qu’on lui témoignait (j’aurais dû le rencontrer, lui parler), lutte pour dynamiser cette histoire, aligne des cadres recherchés, sophistiqués, des plongées, s’essaie au cinéma de genre. Au passage, de manière presque godardienne, il mélange musique et dialogue lors du dernier dialogue entre Brialy et Nadia Tiller, laquelle remet plusieurs fois ses bas, ce qui était l’une de ses spécialités.
Viennent de sortir DEUX SOUS DE VIOLETTES, le seul film vraiment réalisé par Anouilh, et LA CHAMBRE ARDENTE que j’ai trouvé plus visible que je m’y attendais. Certes, Duvivier et Spaak dans leur adaptation, massacrent l’énigmatique et complexe roman de John Dickson Carr (incompréhension de cette famille de scénaristes devant une littérature policière anglo-saxonne ; cf. l’échec du MEURTRIER, de Lara et d’Aurenche), n’en retiennent pas la construction, délocalisent l’intrigue dans la Forêt Noire (pourquoi n’avoir pas gardé la France ? Il faudrait étudier l’attrait néfaste que l’Allemagne a exercé sur certains cinéastes français dans les années 50, notamment Duvivier qui y tourne MARIANNE DE MA JEUNESSE, L’AFFAIRE MAURIZIUS ; ce n’est pas seulement une affaire de coproduction) ce qui rend tout solennel et difficile à comprendre (comment relier la marquise de Brinvilliers et l’Allemagne ?). Mais Claude Rich (qui avait su apprivoiser Duvivier) est formidable, Brialy pas mal, Edith Scob (Duvivier reprend des acteurs de la nouvelle génération) défend un personnage incompréhensible. Mais la palme revient à Piéplu qui s’est fait une tête irrésistible de policier allemand et qui bénéficie du meilleur dialogue. Il justifie la vision du film. Duvivier, qui était très en souffrance à cette époque face au mépris qu’on lui témoignait (j’aurais dû le rencontrer, lui parler), lutte pour dynamiser cette histoire, aligne des cadres recherchés, sophistiqués, des plongées, s’essaie au cinéma de genre. Au passage, de manière presque godardienne, il mélange musique et dialogue lors du dernier dialogue entre Brialy et Nadia Tiller, laquelle remet plusieurs fois ses bas, ce qui était l’une de ses spécialités.
 L’ASSASSIN HABITE AU 21, premier film coécrit et réalisé par Clouzot, est une réussite. Mineure peut-être, quand on pense au CORBEAU et à QUAI DES ORFÈVRES, mais très prometteuse et réjouissante. J’avoue ne pas comprendre la hargne de Paul Vecchiali contre Clouzot. On ressent dans ce film, traité parfois à la blague, un plaisir à raconter une histoire, à inventer des coups de théâtre, une manière de faire feu de tout bois. Les meurtres filmés en caméra subjective, la description de la pension de famille avec ses personnages hauts en couleur, les échanges dévastateurs entre Mademoiselle Vania et le docteur Linz, Roquevert, encore une fois génial (« Vous avez regardé par le trou de la serrure » – « Je n’aime pas le spectacle des ruines » ou alors « J’ai une idée brillante » – « Vous abandonnez la littérature »), la manière dont l’inspecteur Wens comprend ce qui se passe et surtout la manière dont la Suzy Delair – merveilleuse – le réalise à son tour au milieu de son tour de chant, tout cela est du meilleur Clouzot.
L’ASSASSIN HABITE AU 21, premier film coécrit et réalisé par Clouzot, est une réussite. Mineure peut-être, quand on pense au CORBEAU et à QUAI DES ORFÈVRES, mais très prometteuse et réjouissante. J’avoue ne pas comprendre la hargne de Paul Vecchiali contre Clouzot. On ressent dans ce film, traité parfois à la blague, un plaisir à raconter une histoire, à inventer des coups de théâtre, une manière de faire feu de tout bois. Les meurtres filmés en caméra subjective, la description de la pension de famille avec ses personnages hauts en couleur, les échanges dévastateurs entre Mademoiselle Vania et le docteur Linz, Roquevert, encore une fois génial (« Vous avez regardé par le trou de la serrure » – « Je n’aime pas le spectacle des ruines » ou alors « J’ai une idée brillante » – « Vous abandonnez la littérature »), la manière dont l’inspecteur Wens comprend ce qui se passe et surtout la manière dont la Suzy Delair – merveilleuse – le réalise à son tour au milieu de son tour de chant, tout cela est du meilleur Clouzot.
On doit voir aussi la première des aventures de Monsieur Wens, toujours joué par Fresnay, avec encore Suzy Delair et écrite par Clouzot d’après Stanislas André Steeman, LE DERNIER DES SIX, dirigé par Georges Lacombe à qui on doit les excellents CAFÉ DE PARIS, DERRIÈRE LA FAÇADE, l’émouvant LA NUIT EST MON ROYAUME et le beaucoup moins bon PAYS SANS ÉTOILE sans oublier le terne MARTIN ROUMAGNAC. Le résultat est des plus divertissants, avec des dialogues assez marrants. On sait que Lacombe refusa de tourner une scène de music-hall qu’il jugeait pléonastique, il fut remplacé, je crois par Jean Dréville et vit son contrat à la Continental annulé. Fresnay et Susy Delair sont là aussi formidables.

 Je n’avais jamais vu et j’en ai honte DAÏNAH LA MÉTISSE de Jean Grémillon. Ou plutôt ce qu’il en reste, car le film fut massacré. Il reste 4 bobines, suffisamment fortes, intrigantes pour nous faire rêver sur ce qui a pu être coupé. Première originalité, l’histoire qui met en scène parmi les personnages principaux, un docteur noir (joué avec élégance par Habib Benglia ; y a-t-il un personnage équivalent dans le cinéma américain de l’époque ?), sa femme Daïnah, à la peau plus claire (on pense à SAPPHIRE) qui attire toutes les convoitises sexuelles. Il est possible que Grémillon et Charles Spaak aient pensé à Othello.
Je n’avais jamais vu et j’en ai honte DAÏNAH LA MÉTISSE de Jean Grémillon. Ou plutôt ce qu’il en reste, car le film fut massacré. Il reste 4 bobines, suffisamment fortes, intrigantes pour nous faire rêver sur ce qui a pu être coupé. Première originalité, l’histoire qui met en scène parmi les personnages principaux, un docteur noir (joué avec élégance par Habib Benglia ; y a-t-il un personnage équivalent dans le cinéma américain de l’époque ?), sa femme Daïnah, à la peau plus claire (on pense à SAPPHIRE) qui attire toutes les convoitises sexuelles. Il est possible que Grémillon et Charles Spaak aient pensé à Othello.
On rentre dans l’histoire comme par effraction (il y a 34 plans – de mer, d’oiseaux, de bateau – entre le générique et la première scène) mais il y a tant de détails insolites, tant de plans étranges, esthètes (caméra basse avec avant-plan, contre-plongée à effet, plongées dans les coursives, les escaliers) qu’on reste accroché, touché, ému malgré les trous. Et il y a cette incroyable séquence de danse, avec ces passagers masqués qui vont être témoins du numéro incroyablement sensuel que Daïnah, oubliant son partenaire, effectue sur la piste. Moment violent, rare, unique. A noter qu’on entend beaucoup de morceaux de jazz, Chloe, Little White Lies, St Louis Blues, Limehouse Blues et I’m Confessing. Paul Vecchiali qui parle si bien de Grémillon est muet sur ce film dans son Encinéclopédie.
Dans LES TRUANDS, pochade assez quelconque de Carlo Rim, on peut retenir la prestation d’Yves Robert qui finit par jouer un ultra-centenaire et Eddie Constantine, aux prises avec Noël-Noël. La ballade des truands écrite par Rim est une très bonne chanson et il en existe une version par Constantine.
Il me reste à revoir L’ALIBI, L’AFFAIRE MAURIZIUS de Duvivier.

 J’ai adoré revoir LE SAUVAGE de Jean-Paul Rappeneau, très bien restauré par Studio Canal. C’est une comédie éblouissante qui retrouve le rythme, l’allant, le charme, le sex-appeal des meilleures comédies américaines. Tout ce qui se passe sur l’île est une merveille, avec un dialogue inspiré de Jean-Loup Dabadie, une très belle musique de Michel Legrand (l’installation des deux héros dans la maison devrait être étudiée par tous ceux qui veulent devenir compositeur pour le cinéma, la manière dont Legrand joue avec les dialogues, s’insinue dans les actions, les épouse et en décuple le charme). Rappeneau passe de la cocasserie la plus débridée (la manière dont Deneuve pourrit la vie de Montand, lui pique son poisson, le harcèle d’offres commerciales) à de soudaines bouffées d’émotions, de vérité, de vie. Deneuve est inouïe de rapidité, de drôlerie, de vivacité. Elle est craquante à chaque instant, sensuelle, sexy (le premier et seul baiser est magistralement amené ; sa manière de dire « Quelle heure est-il ? » et d’embrasser Montand vous emplit de bonheur), imprévisible (sa manière de partir à vélo sur le ponton). Montand trouve là le rôle de sa vie, avec les Sautet, et on est même un peu surpris de découvrir à quel point il avait peur du rôle, du film. Il a souvent eu des principes rigides, des idées idiotes (Montand ne peut pas être juste un garçon, il doit être maître d’hôtel) qui ont abîmé des films comme justement GARÇON où il a fait rajouter des tas de scènes pour justifier qu’il ne soit que garçon. Sautet en a éliminé pas mal dans le DVD. Mais il est aussi génial dans LE SAUVAGE que dans CÉSAR ET ROSALIE.
J’ai adoré revoir LE SAUVAGE de Jean-Paul Rappeneau, très bien restauré par Studio Canal. C’est une comédie éblouissante qui retrouve le rythme, l’allant, le charme, le sex-appeal des meilleures comédies américaines. Tout ce qui se passe sur l’île est une merveille, avec un dialogue inspiré de Jean-Loup Dabadie, une très belle musique de Michel Legrand (l’installation des deux héros dans la maison devrait être étudiée par tous ceux qui veulent devenir compositeur pour le cinéma, la manière dont Legrand joue avec les dialogues, s’insinue dans les actions, les épouse et en décuple le charme). Rappeneau passe de la cocasserie la plus débridée (la manière dont Deneuve pourrit la vie de Montand, lui pique son poisson, le harcèle d’offres commerciales) à de soudaines bouffées d’émotions, de vérité, de vie. Deneuve est inouïe de rapidité, de drôlerie, de vivacité. Elle est craquante à chaque instant, sensuelle, sexy (le premier et seul baiser est magistralement amené ; sa manière de dire « Quelle heure est-il ? » et d’embrasser Montand vous emplit de bonheur), imprévisible (sa manière de partir à vélo sur le ponton). Montand trouve là le rôle de sa vie, avec les Sautet, et on est même un peu surpris de découvrir à quel point il avait peur du rôle, du film. Il a souvent eu des principes rigides, des idées idiotes (Montand ne peut pas être juste un garçon, il doit être maître d’hôtel) qui ont abîmé des films comme justement GARÇON où il a fait rajouter des tas de scènes pour justifier qu’il ne soit que garçon. Sautet en a éliminé pas mal dans le DVD. Mais il est aussi génial dans LE SAUVAGE que dans CÉSAR ET ROSALIE.


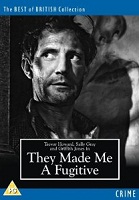
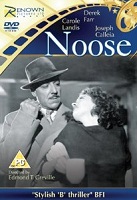



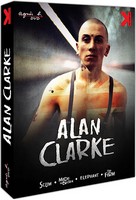 Très bon article de Pierre Charrel de la revue TEMPS NOIR sur DVD CLASSIK
Très bon article de Pierre Charrel de la revue TEMPS NOIR sur DVD CLASSIK 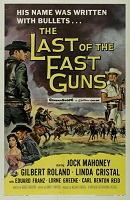


 Revoir dans une meilleure copie ANGEL ON THE AMAZON (TAM-TAM SUR L’AMAZONE), autre John H. Auer, a rafraîchi, revivifié de très anciens souvenirs. Nous avions projeté ce film en VF au Nickel Odéon en 63/64 et je ne l’avais revu. Cela dit ce que nous écrivions dans 50 ANS (je le comparais déjà à John Farrow) est assez juste mais devrait être développé et précisé. C’est vrai que toutes les séquences de jungle sont tournées avec un vrai sens du suspense, de la progression dramatique, des recherches formelles évidentes, souvent élégantes. Nous mentionnions la menace que font peser des chasseurs de têtes invisibles dont la présence n’est marquée que par leurs tambours et des bruits dans les feuillages. Tout ce que l’on verra, c’est un membre de l’expédition surgir de la forêt et tomber avec une flèche dans le dos.
Revoir dans une meilleure copie ANGEL ON THE AMAZON (TAM-TAM SUR L’AMAZONE), autre John H. Auer, a rafraîchi, revivifié de très anciens souvenirs. Nous avions projeté ce film en VF au Nickel Odéon en 63/64 et je ne l’avais revu. Cela dit ce que nous écrivions dans 50 ANS (je le comparais déjà à John Farrow) est assez juste mais devrait être développé et précisé. C’est vrai que toutes les séquences de jungle sont tournées avec un vrai sens du suspense, de la progression dramatique, des recherches formelles évidentes, souvent élégantes. Nous mentionnions la menace que font peser des chasseurs de têtes invisibles dont la présence n’est marquée que par leurs tambours et des bruits dans les feuillages. Tout ce que l’on verra, c’est un membre de l’expédition surgir de la forêt et tomber avec une flèche dans le dos.