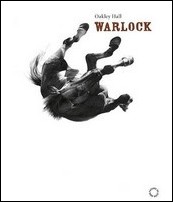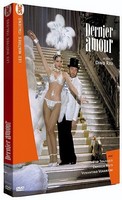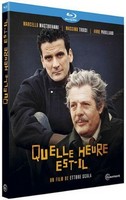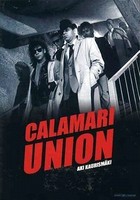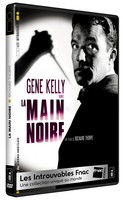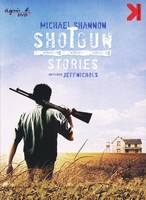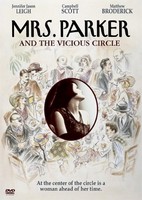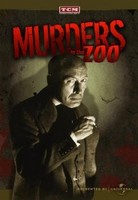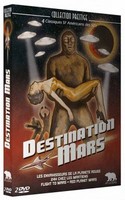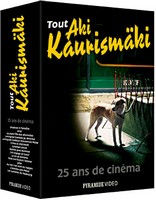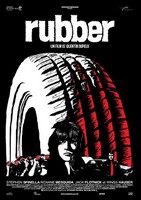Les USA et Criterion rendent un hommage à un cinéaste francais majeur, Jean Grémillon, avec ce coffret. L’oeuvre de Grémillon était jusqu’à ces derniers mois, peu diffusée en DVD. Il y avait une fort belle édition de REMORQUES chez MK2, dans une fort belle copie et L’ÉTRANGE MADAME X chez René Chateau. Ces derniers mois, Gaumont a sorti DAINAH LA METISSE et L’AMOUR D’UNE FEMME, deux films majeurs. Mais en regroupant les trois films tournés sous l’Occupation, Criterion accomplit un travail éditorial très en avance sur la France.
Lire la suite »LECTURES
Tout d’abord plusieurs livres que j’ai adorés, le GENE KELLY d’Alain Masson, indispensable pour tous les amateurs de comédies musicales.
Le revigorant CETTE OBSCURE ENVIE DE PERDRE À GAUCHE de Jean-Philippe Domecq (à qui on doit l’essentiel LA FIN DE ROBESPIERRE) : le décryptage de la manière dont Al Gore et Jospin ont perdu vous empoigne et vous met la rage au cœur. Ralph Nader, en rêvant d’une écologie plus maximaliste que celle d’Al Gore, a remis les clés du pouvoir à Bush qui a napalmé l’écologie.
Enfin, j’ai acheté WARLOCK, roman qu’on dit remarquable et qui a inspiré L’HOMME AUX COLTS D’OR.
FILMS ITALIENS
 Critérion, dans sa collection Eclipse, vient de sortir un coffret consacré à Raffaello Matarazzo qui comprend quatre de ses mélodrames des années 40/50 : CHAINS(le Mensonge d’une mère), TORMENTO (Bannie du Foyer), NOBODY’S CHILDREN (le Fils de Personne) et THE WHITE ANGEL. Les titres donnent le ton de ces films qu’il faut avoir vu. Matarazzo dont Freda vantait l’intelligence, croit dans son matériau et le transcende à force de sincérité. Il ne joue jamais au plus malin, accepte les conventions, les affronte et en triomphe. Le couple Amedeo Nazzari-Yvonne Sanson tient la vedette dans nombre de ses films y compris dans un titre qui ne figure pas dans ce coffret et qui adaptait Alphonse de Lamartine.
Critérion, dans sa collection Eclipse, vient de sortir un coffret consacré à Raffaello Matarazzo qui comprend quatre de ses mélodrames des années 40/50 : CHAINS(le Mensonge d’une mère), TORMENTO (Bannie du Foyer), NOBODY’S CHILDREN (le Fils de Personne) et THE WHITE ANGEL. Les titres donnent le ton de ces films qu’il faut avoir vu. Matarazzo dont Freda vantait l’intelligence, croit dans son matériau et le transcende à force de sincérité. Il ne joue jamais au plus malin, accepte les conventions, les affronte et en triomphe. Le couple Amedeo Nazzari-Yvonne Sanson tient la vedette dans nombre de ses films y compris dans un titre qui ne figure pas dans ce coffret et qui adaptait Alphonse de Lamartine.
D’autres films de Matarrazo sont disponibles sur Amazon Italie : L’AVVENTURIERA DEL PIANO DI SOPRA avec Vittorio de Sica (sous-titres français) dont le scénario fut co écrit par Riccardo Freda ; LA SCHIAVA DEL PECCATO (sous-titres italiens) avec Silvana Pampanini ; L’INTRUSA (sous-titres français) avec Amedeo Nazzari et Léa Padovani ; SONO STATO IO avec Eduardo, Peppino et Titina de Filippo (sous-titres italiens), casting unique ; JOE IL ROSSO ; GIU IL SIPARIO (sous-titres italiens). Ces derniers titres semblent être des farces qui marquent sa première période entre TRENO POPOLARE et les mélodrames.
J’ai aussi obtenu un film de Cottafavi qui m’avait été signalé par des cinéphiles intervenant sur le blog. Il s’agit de UNA DONNA HA UCCISO (sous-titres anglais).
 Livraison très riche de SND. Et d’abord un chef d’œuvre, CASANOVA, UN ADOLESCENT À VENISE de Luigi Comencini. Admirable film historique, l’un des plus beaux, des plus profonds, des plus inspirés de la décennie. On est plongé au milieu de l’époque, on est projeté parmi les personnages. On ne regarde jamais de loin. On capte l’âme de l’époque. La première partie confronte Casanova enfant à la violence de son époque, à la corruption, à la mort. La découverte d’un cadavre est une séquence inoubliable. On retrouve toute l’attention que Comencini porte à l’enfance qu’il filme comme personne. Et je renvoie à cet autre chef d’œuvres qu’est L’INCOMPRIS. La seconde partie évoque un Casanova adolescent qui découvre l’amour, les traîtrises, les désillusions, le libertinage. Comencini nous parle de l’érosion, de la perte de l’innocence. Grandiose composition de Lionel Stander qui avait fuit les Etats-Unis après sa déposition percutante devant la Commission des Activités anti-américaines.
Livraison très riche de SND. Et d’abord un chef d’œuvre, CASANOVA, UN ADOLESCENT À VENISE de Luigi Comencini. Admirable film historique, l’un des plus beaux, des plus profonds, des plus inspirés de la décennie. On est plongé au milieu de l’époque, on est projeté parmi les personnages. On ne regarde jamais de loin. On capte l’âme de l’époque. La première partie confronte Casanova enfant à la violence de son époque, à la corruption, à la mort. La découverte d’un cadavre est une séquence inoubliable. On retrouve toute l’attention que Comencini porte à l’enfance qu’il filme comme personne. Et je renvoie à cet autre chef d’œuvres qu’est L’INCOMPRIS. La seconde partie évoque un Casanova adolescent qui découvre l’amour, les traîtrises, les désillusions, le libertinage. Comencini nous parle de l’érosion, de la perte de l’innocence. Grandiose composition de Lionel Stander qui avait fuit les Etats-Unis après sa déposition percutante devant la Commission des Activités anti-américaines.
Quelques Dino Risi épatants comme LA CARRIÈRE D’UNE FEMME DE CHAMBRE, un des meilleurs, des plus décapants. Et deux œuvres dramatiques : DERNIER AMOUR, variation sur la FIN DU JOUR, qui m’avait touché à l’époque (l’interprétation de Tognazzi, admirable en acteur vieillissant, la beauté d’Ornella Mutti) ; ÂMES PERDUES, fable noire et rêveuse, plus mélancolique, très bien jouée par Deneuve et Gassman avec un dénouement un peu trop téléphoné. LE SEXE FOU est plus inégal mais deux ou trois moments sont irrésistibles.
J’ai adoré revoir METELLO, peut être le chef d’oeuvre de Bolognini (quel beau double programme avec les CAMARADES de Monicelli). Cette défense du syndicalisme est filmée avec un raffinement, un gout, une somptuosité visuelle qui, pourtant, n’étouffent pas l’émotion. Premiers plans inoubliables : dans le petit matin, un homme sort de prison et va retrouver sa femme et son enfant. La couleur des murs, la grâce inspirée de la photo, l’intelligence des cadres, tout cela retrouve l’inspiration lyrique du meilleur Zola, de Dabit, Charles Louis Philippe. Et il y a évidemment Ottavia Piccolo, formidable en ouvrière amoureuse, réservée et pourtant fière, qui va triompher de sa rivale (la très belle et très sensuelle Tina Aumont). Beau personnage de femme, finalement plus forte, plus droite que son mari. Et Florence, filmée avec amour.
Dans ROGOPAG, je passerai sur les deux premiers sketches qui m’ont indifféré pour m’arrêter sur celui de Pasolini, La Ricotta qui est une vraie réussite. On y retrouve le regard acéré, lucide, jamais hautain de cet amateur de paradoxe et de vérité. Qui savait débusquer la seconde derrière le premier. Conte cruel et compatissant qui met à nu les rapports de pouvoir (intellectuel, social), épingle les comportements odieux. Le récit est constamment ironique (comment se nourrir en se faisant passer pour un saint, comment vendre un chien aussi abusif que sa maîtresse). Sous le regard narquois d’un Orson Welles qui récite – hélas doublé en italien – du Pasolini. A ne pas manquer.
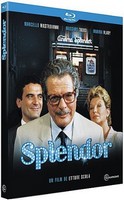 J’ai enfin découvert SPLENDOR d’Ettore Scola dans le magnifique Blu-ray sorti et restauré par Gaumont en même temps que QUELLE HEURE EST-IL ?, toujours de Scola (que je vais revoir), et ET VOGUE LE NAVIRE qui m’avait touché. SPLENDOR, qui avait été occulté par CINEMA PARADISO, m’a enchanté. C’est un hommage émouvant, chaleureux au cinéma qui a marqué Scola, depuis « les roues dentées de Metropolis » (Beau monologue du petit garçon face caméra), les chefs d’œuvres du néo réalisme, célébrés déjà dans NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS, jusqu’à des œuvres plus récentes. Une variété de personnages pittoresques ou touchants déambulent au hasard du récit et sont traités par Scola avec un grand sens de l’hospitalité : le projectionniste obsessionnel qui fait louer des films qui se ramassent, le critique communiste qui avoue avoir avalé des couleuvres et finit par se recycler à la télé, le libraire amoureux du cinéma et de Marina Vlady, qui laisse ouverte sa librairie : « Qui volerait un livre dans cette ville ? ». On aperçoit au début Simon Mizrahi, ami cher qui fit tant pour le cinéma italien, en directeur de troupe odieux. Il y a un moment formidable qui concrétise le talent de Scola : le cinéma est vide et le projectionniste se retrouve sur la place. A la terrasse du café des dizaines de consommateurs, vautrés, somnolent. « Vous seriez mieux au cinéma », leur dit le projectionniste. On lui rétorque que la télé présente plein de films et l’un des buveurs cite une douzaine de titres. « Lequel vous allez voir ? » – « Aucun », lui répond son interlocuteur. Echange admirable qui résume tout un état de jachère mentale où l’on est déjà gavé face à l’offre, sans qu’il soit besoin de consommer.
J’ai enfin découvert SPLENDOR d’Ettore Scola dans le magnifique Blu-ray sorti et restauré par Gaumont en même temps que QUELLE HEURE EST-IL ?, toujours de Scola (que je vais revoir), et ET VOGUE LE NAVIRE qui m’avait touché. SPLENDOR, qui avait été occulté par CINEMA PARADISO, m’a enchanté. C’est un hommage émouvant, chaleureux au cinéma qui a marqué Scola, depuis « les roues dentées de Metropolis » (Beau monologue du petit garçon face caméra), les chefs d’œuvres du néo réalisme, célébrés déjà dans NOUS NOUS SOMMES TANT AIMÉS, jusqu’à des œuvres plus récentes. Une variété de personnages pittoresques ou touchants déambulent au hasard du récit et sont traités par Scola avec un grand sens de l’hospitalité : le projectionniste obsessionnel qui fait louer des films qui se ramassent, le critique communiste qui avoue avoir avalé des couleuvres et finit par se recycler à la télé, le libraire amoureux du cinéma et de Marina Vlady, qui laisse ouverte sa librairie : « Qui volerait un livre dans cette ville ? ». On aperçoit au début Simon Mizrahi, ami cher qui fit tant pour le cinéma italien, en directeur de troupe odieux. Il y a un moment formidable qui concrétise le talent de Scola : le cinéma est vide et le projectionniste se retrouve sur la place. A la terrasse du café des dizaines de consommateurs, vautrés, somnolent. « Vous seriez mieux au cinéma », leur dit le projectionniste. On lui rétorque que la télé présente plein de films et l’un des buveurs cite une douzaine de titres. « Lequel vous allez voir ? » – « Aucun », lui répond son interlocuteur. Echange admirable qui résume tout un état de jachère mentale où l’on est déjà gavé face à l’offre, sans qu’il soit besoin de consommer.
ADDITIF KAURISMAKI
Dans le coffret KAURISMAKI, je voudrais signaler CALAMARI UNION, film étrange et formidable où tous les protagonistes s’appellent Frank. Ils tentent de traverser une ville (Helsinki), abîmée par les crottes de chien et dans cette odyssée calquée sur RED RIVER, meurent l’un après l’autre. Au passage, dans un café, on récite intégralement et en français le poème de Jacques Prévert : « il est terrible le petit bruit de l’oeuf dur… ».
Lire la suite »FILMS AMÉRICAINS EN DVD
Outre JOHNNY EAGER, un des meilleurs Le Roy hors sa période Warner, Wild Side nous offre dans la collection des Introuvables, LA MAIN NOIRE de Richard Thorpe. Des décors soignés, une belle photo, la présence de Gene Kelly et de ses efforts pour jouer un rôle dramatique et ethnique (ses interjections italiennes sont réjouissantes), un bon retournement dramatique (la mort du flic) permettent au film de faire illusion pendant une demi-heure. Mais hélas, le scénario devient vite prévisible, mollasson et extraordinairement conventionnel. Tous les clichés sont au rendez-vous. Pardon, cher Patrick Brion pour ce crime de lèse-majesté envers Richard Thorpe.
 PATTERNS de Fiedler Cook sur un sujet de Rod Serling sur les mœurs dans une grosse société (intéressant et très actuel), est incroyablement mal mis en scène, terne, académique avec des acteurs d’habitude formidables mais qui là, farcis d’intentions et de directions, vous expliquent, vous soulignent tout dans leur jeu. C’est encore accentué par la façon dont ils sont cadrés, qui est toujours redondante. Ce fut d’abord une dramatique télévisuelle qui remporta un tel succès critique et public qu’on la redonna une semaine après. C’est à dire qu’on dut, vu qu’elle était en direct, la faire rejouer, la filmer une seconde fois. C’était une première dans les annales de la télévision. Dans le film Van Heflin remplace Richard Kiley mais les deux autres acteurs, Ed Begley et Everett Sloane reprennent leurs rôles. Aucun des trois n’est vraiment bon, phénomène unique pour Van Heflin. La comparaison avec la TOUR DES AMBITIEUX est écrasante pour Cook. Ce qui prouve que de super collaborateurs (Boris Kauffman, Richard Sylbert) ne parviennent pas à inspirer ou à sauver la mise en scène.
PATTERNS de Fiedler Cook sur un sujet de Rod Serling sur les mœurs dans une grosse société (intéressant et très actuel), est incroyablement mal mis en scène, terne, académique avec des acteurs d’habitude formidables mais qui là, farcis d’intentions et de directions, vous expliquent, vous soulignent tout dans leur jeu. C’est encore accentué par la façon dont ils sont cadrés, qui est toujours redondante. Ce fut d’abord une dramatique télévisuelle qui remporta un tel succès critique et public qu’on la redonna une semaine après. C’est à dire qu’on dut, vu qu’elle était en direct, la faire rejouer, la filmer une seconde fois. C’était une première dans les annales de la télévision. Dans le film Van Heflin remplace Richard Kiley mais les deux autres acteurs, Ed Begley et Everett Sloane reprennent leurs rôles. Aucun des trois n’est vraiment bon, phénomène unique pour Van Heflin. La comparaison avec la TOUR DES AMBITIEUX est écrasante pour Cook. Ce qui prouve que de super collaborateurs (Boris Kauffman, Richard Sylbert) ne parviennent pas à inspirer ou à sauver la mise en scène.
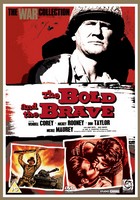 THE BOLD AND THE BRAVE, revu grâce au DVD anglais d’Optimum dans un excellent transfert mais avec un format 4/3. Le film était sorti en SuperScope, procédé qui élargissait l’image au tirage. Il est difficile de savoir comment étaient cadrés de tels films, si ce choix était prévu dès le début ou bien décidé durant le tournage ou la post-production. J’ai parfois senti que le cadre était serré mais sans avoir l’impression d’une image vraiment amputée (pourtant IMDB donne un format large). En tout cas cette vision récente confirme les qualités du film, de loin le plus ambitieux de Lewis R. Foster dont il faut voir CAPTAIN CHINA, L’OR DE LA NOUVELLE GUINÉE. Une ambition présente dès le scénario de Robert Lewin (nommé pour l’Oscar du meilleur scénario original) inspiré par ses souvenirs de guerre qui tourne quasiment autour de 3 personnages masculins et d’une femme et qui est aussi divisé en trois parties :
THE BOLD AND THE BRAVE, revu grâce au DVD anglais d’Optimum dans un excellent transfert mais avec un format 4/3. Le film était sorti en SuperScope, procédé qui élargissait l’image au tirage. Il est difficile de savoir comment étaient cadrés de tels films, si ce choix était prévu dès le début ou bien décidé durant le tournage ou la post-production. J’ai parfois senti que le cadre était serré mais sans avoir l’impression d’une image vraiment amputée (pourtant IMDB donne un format large). En tout cas cette vision récente confirme les qualités du film, de loin le plus ambitieux de Lewis R. Foster dont il faut voir CAPTAIN CHINA, L’OR DE LA NOUVELLE GUINÉE. Une ambition présente dès le scénario de Robert Lewin (nommé pour l’Oscar du meilleur scénario original) inspiré par ses souvenirs de guerre qui tourne quasiment autour de 3 personnages masculins et d’une femme et qui est aussi divisé en trois parties :
1) la vie du détachement (la plus conventionnelle) et le début d’une amitié entre les trois protagonistes, le riche héritier oisif et qui ne veut pas tuer, le combinard jovial et le soldat pétri de religion et de principes.
2) La rencontre arrangée de « Pasteur » qui est visiblement puceau et d’une fille à soldat italienne, jouée bien sûr (le choix s’imposait) par une actrice française, Nicole Maurey, qui s’en sort honorablement. Ce qui était une plaisanterie devient une histoire d’amour. La découverte de la vérité est terrible.
3) Enfin, la guerre avec la revanche de Pasteur et la réhabilitation de Wendell Corey. Nous saluions à juste titre la longue séquence ou Wendell Corey se bat contre un tank dans un paysage désolé de rocailles plus que de forêt. C’est le début de l’attaque qui se passe dans un bois d’arbres morts. Toute aussi réussie est la longue partie de dés où un Mickey Rooney survolté gagne une fortune. Foster a la modestie, l’intelligence de ne pas découper la scène, de limiter les inserts sur les dés, de supprimer les plans de coupe. Il se concentre sur le Rooney, son visage, sa gestuelle, ses invocations et cela nous enchante. Il entraîne, dynamise toute la séquence qui est anthologique, lui donne une incroyable vérité. Dès qu’il apparaît dans le film, on a l’impression qu’il improvise son dialogue ; met à mal le côté un peu statique des premiers échanges. Il fut lui aussi nommé pour un Oscar. Le personnage de fanatique religieux que joue de manière convaincante Don Taylor est le plus intéressant et le plus original du film. Le travail de Foster est simple et sans affectation. Il sait ne pas surdramatiser les moments signifiants et trouve le rythme qui convient aux moments de comédie. IMDB déclare que Mickey Rooney réalisa certains plans. Soit il filma quelques raccords, soit il commença le film et le producteur Hal Chester fit appel à Lewis Foster avec qui il avait fait CRASHOUT. Photo de Sam Leavitt et musique de Hershell Burke Gilbert qui brode des variations sur certains thèmes de NAKED DAWN. Horrible chanson de générique due à Mickey Rooney et Ross Bagdassarian.
SHOTGUN STORIES, premier film de Jeff Nichols est une manière de chef d’œuvre qui autopsie comment des personnages introvertis, repliés sur eux-mêmes, inarticulés, vont sombrer peu à peu dans la violence, ce qui n’est absolument pas dans leurs intentions. Une volonté maladroite, véhémente, de dire la vérité, une vérité, lors d’un enterrement, qui va provoquer un conflit qui va peu à peu dégénérer. L’atmosphère sudiste, le manque de manières, d’éducation sont évoquées sans ostentation, sans paternalisme, sans mépris absolument formidable.
MRS PARKER AND THE VICIOUS CIRCLE : ce film, qu’on trouve uniquement en zone 1 dans un DVD Image avec deux autres réalisations, phénomène exceptionnel dans le cinéma américain, ne parle pratiquement que de personnages, hommes et femmes, qu’on peut qualifier « d’intellectuels » new yorkais : dramaturges, éditorialistes, humoristes, journalistes sportifs, critiques, directeur de magazine (le New Yorker). Avec un nombre très important de scènes chorales, collectives où une vingtaine de personnages se coupent la parole. Leurs rencontres quotidiennes, autour d’une table ronde de l’Hôtel Algonquin, leurs repas donnaient en effet lieu à des festivals de vacheries, de bons mots, d’aphorismes (ils recyclaient les meilleurs dans les journaux auxquels ils collaboraient). Alan Rudolph nous montre, à travers le destin tourmenté de Dorothy Parker, figure énigmatique, fascinante et tragique, comment un groupe peut imposer mais aussi étouffer un artiste, malmener sa vie privée, sujet original s’il en est. Elle devient prisonnière et aussi victime de leurs pratiques, de leurs égos, de leurs jalousies (Groucho Marx disait que pour faire partie du club, il fallait « avoir une langue de serpent et un poignard à demi caché »). De cette façon de privilégier le trait d’esprit sur tout sentiment durable. Un psychiatre lui fait remarquer que la vie du groupe prend le pas sur la vraie vie. Rudolph évoque avec beaucoup de sensibilité, de délicatesse l’amitié tendre qui l’unit au talentueux humoriste Robert Benchley (qui partira faire carrière à Hollywood comme auteur et acteur ; on se souvient de ses courts métrages, Comment faire un film, la Vie sexuelle des Polypes, qui ont été réunis dans un coffret et de ses apparitions dans de nombreux film dont CORRESPONDANT 17). Cette chronique poignante des faux pas, des occasions manquées, des aveuglements, trouve en Jennifer Jason Leigh l’actrice idéale. Nul mieux qu’elle ne sait montrer les fêlures et de l’âme et du corps. Sa diction étrange – elle étudia longuement la voix de Dorothy Parker et l’entendre dire ses poèmes justifie déjà la vision du film, sa gestuelle inspirée, sa liberté, sa manière de faire corps avec ses émotions sans les expliquer permettent d’explorer des zones d’ombre rares. Et finalement on se dit que comme elle l’écrivit plus tard : « On subissait la terrible dictature du bon mot (wisecrack) qui empêchait absolument d’atteindre à une quelconque vérité. » Une occasion de revoir d’autre films d’Alan Rudolph comme WANDA’S CAFE, CHOOSE ME.
 LONE STAR (1996) : sans doute, jusqu’à présent, le chef d’œuvre de John Sayles et l’un des très rares films où la moindre péripétie, le moindre rebondissement sont vus avec un regard neuf, semblent ne rien devoir à personne. Tout comme cette scène qui démystifie l’histoire de Fort Alamo et remet tout en perspective. Le scénario avec ses intrigues entremêlées, la multitude des personnages, tous vivants et intéressants, ses ruptures spatio-temporelles, est à la fois complexe et incroyablement fluide. Les flashes back sont amenés avec autant d’élégance que d’évidence et le récit coule, comme une rivière, vers une conclusion qu’on ne devine pas. Cette enquête sur un meurtre vieux de 30 ans, relie passé et présent, montre qu’on ne peut échapper au poids de l’Histoire, révèle le poids du nationalisme, des préjugés raciaux, du révisionnisme social, des conflits de génération, de la censure. Le tout traité avec subtilité, sans jamais donner l’impression d’une œuvre à thèse où l’auteur impose ses vues et ses idées. Au contraire, tout semble organique, couler de source. Le film magistralement écrit, brillamment dialogué, avec acuité, ironie et concision, s’impose comme l’un des meilleurs – sinon le meilleur – scénarios de la décennie. La dernière scène et la dernière réplique sont anthologiques. Sayles filme avec invention, intelligence, respectant ses personnages sans jouer au plus malin, épousant le rythme intérieur d’acteurs époustouflants : le génial Chris Cooper, Elizabeth Pena, Kris Kristofferson.
LONE STAR (1996) : sans doute, jusqu’à présent, le chef d’œuvre de John Sayles et l’un des très rares films où la moindre péripétie, le moindre rebondissement sont vus avec un regard neuf, semblent ne rien devoir à personne. Tout comme cette scène qui démystifie l’histoire de Fort Alamo et remet tout en perspective. Le scénario avec ses intrigues entremêlées, la multitude des personnages, tous vivants et intéressants, ses ruptures spatio-temporelles, est à la fois complexe et incroyablement fluide. Les flashes back sont amenés avec autant d’élégance que d’évidence et le récit coule, comme une rivière, vers une conclusion qu’on ne devine pas. Cette enquête sur un meurtre vieux de 30 ans, relie passé et présent, montre qu’on ne peut échapper au poids de l’Histoire, révèle le poids du nationalisme, des préjugés raciaux, du révisionnisme social, des conflits de génération, de la censure. Le tout traité avec subtilité, sans jamais donner l’impression d’une œuvre à thèse où l’auteur impose ses vues et ses idées. Au contraire, tout semble organique, couler de source. Le film magistralement écrit, brillamment dialogué, avec acuité, ironie et concision, s’impose comme l’un des meilleurs – sinon le meilleur – scénarios de la décennie. La dernière scène et la dernière réplique sont anthologiques. Sayles filme avec invention, intelligence, respectant ses personnages sans jouer au plus malin, épousant le rythme intérieur d’acteurs époustouflants : le génial Chris Cooper, Elizabeth Pena, Kris Kristofferson.
 Face à PRIME CUT de Michael Ritchie, j’ai éprouvé la même déception que lors de la sortie du film. On attendait beaucoup de Ritchie après DOWNHILL RACER, aigu, brillant, si bien écrit par James Salter. Mais là le scénario de Robert Dillon est si plat, si conventionnel que le film semble totalement inerte. Lee Marvin vient se venger de Gene Hackman avec une bande de tueurs et, de chasseur, devient gibier. Ne cherchez rien d’autre sinon des rapports étranges entre Hackman et son frère et deux ou trois échanges dont le dernier entre les deux protagonistes. Le seul intérêt du film est son cadre, rarement filmé : le Kansas des marchands de viande, des bouseux, avec sa vulgarité, ses foires, ses exhibitions machistes : des filles, dont la merveilleuse Sissy Spacek, sont exhibées nues, dans un parc à viande. Même la séquence de la poursuite de Marvin et Spacek par une moissonneuse batteuse, pastiche de LA MORT AUX TROUSSES, que nous louions dans 50 Ans, m’a paru molle, interminable, avec ces longues focales qui écrasent l’espace.
Face à PRIME CUT de Michael Ritchie, j’ai éprouvé la même déception que lors de la sortie du film. On attendait beaucoup de Ritchie après DOWNHILL RACER, aigu, brillant, si bien écrit par James Salter. Mais là le scénario de Robert Dillon est si plat, si conventionnel que le film semble totalement inerte. Lee Marvin vient se venger de Gene Hackman avec une bande de tueurs et, de chasseur, devient gibier. Ne cherchez rien d’autre sinon des rapports étranges entre Hackman et son frère et deux ou trois échanges dont le dernier entre les deux protagonistes. Le seul intérêt du film est son cadre, rarement filmé : le Kansas des marchands de viande, des bouseux, avec sa vulgarité, ses foires, ses exhibitions machistes : des filles, dont la merveilleuse Sissy Spacek, sont exhibées nues, dans un parc à viande. Même la séquence de la poursuite de Marvin et Spacek par une moissonneuse batteuse, pastiche de LA MORT AUX TROUSSES, que nous louions dans 50 Ans, m’a paru molle, interminable, avec ces longues focales qui écrasent l’espace.
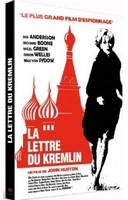 En revanche THE KREMLIN LETTER de John Huston (Opening) tient formidablement le coup. Il s’agit d’un des films d’espionnages les plus noirs, les plus pessimistes. Les notions de cause, d’engagement idéologique, de patriotisme sont bafouées, piétinées. Tout le monde trahit. C’est le règne de l’argent et cela dans les deux camps. C’est un personnage que joue Huston qui fait d’ailleurs ce constat et il est difficile de sympathiser avec un personnage, tant le film lamine la notion de héros et rend opaque la moindre action. Le DVD permet enfin de comprendre cette ténébreuse affaire où la lettre du titre est vite reléguée à l’état de prétexte et où le coup de théâtre final – d’une ironie toute hustonienne – vous glace. Tout ce que montre le film, la corruption, les mœurs sexuelles, s’est révélé, avec les années, d’une profonde justesse. C’est du sur-John le Carré. Au passage, plutôt que de voir LA TAUPE, exercice esthétisant et inerte, mieux vaut revoir la version de la BBC de TINKER TAILOR SOLDIER SPY (et aussi de SMILEY’S PEOPLE). Alec Guinness est très supérieur à Gary Oldman.
En revanche THE KREMLIN LETTER de John Huston (Opening) tient formidablement le coup. Il s’agit d’un des films d’espionnages les plus noirs, les plus pessimistes. Les notions de cause, d’engagement idéologique, de patriotisme sont bafouées, piétinées. Tout le monde trahit. C’est le règne de l’argent et cela dans les deux camps. C’est un personnage que joue Huston qui fait d’ailleurs ce constat et il est difficile de sympathiser avec un personnage, tant le film lamine la notion de héros et rend opaque la moindre action. Le DVD permet enfin de comprendre cette ténébreuse affaire où la lettre du titre est vite reléguée à l’état de prétexte et où le coup de théâtre final – d’une ironie toute hustonienne – vous glace. Tout ce que montre le film, la corruption, les mœurs sexuelles, s’est révélé, avec les années, d’une profonde justesse. C’est du sur-John le Carré. Au passage, plutôt que de voir LA TAUPE, exercice esthétisant et inerte, mieux vaut revoir la version de la BBC de TINKER TAILOR SOLDIER SPY (et aussi de SMILEY’S PEOPLE). Alec Guinness est très supérieur à Gary Oldman.
J’ai acheté MURDERS IN THE ZOO d’Edward Sutherland (zone 1 sans sous-titres) après une description alléchante d’un participant au blog. Et c’est vrai que l’ouverture est sidérante : cet homme dont on coud les lèvres et qu’on abandonne dans la jungle. La suite est malheureusement desservie par une intrigue rudimentaire, des moments de « soulagement comique » (comic relief) exaspérants, interminables. La photo est belle et Lionel Atwill inquiétant à souhait. Randolph Scott joue les bellâtres.
Artus Films vient de sortir dans un coffret trois nanars de science-fiction : RED PLANET MARS de Harry Horner, INVADERS FROM MARS de William Cameron Menzies et FLIGHT TO MARS de Lesley Selander. Le pire des trois est le minable FLIGHT TO MARS, décors hideux et dialogues d’une sottise confondante : « Savez- vous déjà comment vous allez revenir de Mars ? », demande un journaliste au chef de l’expédition, la veille du départ – « Vous savez, je suis un alpiniste. Ce qui comptait c’était atteindre le sommet, pas redescendre. » Je n’ai jamais compris la petite réputation dont jouit INVADERS FROM MARS aux USA. Certes le décor de la petite colline devant la maison, du sentier avec la barrière, est une jolie réussite où l’on reconnaît la patte du génial décorateur William Cameron Menzies (Le VOLEUR DE BAGDAD avec Fairbanks, GONE WITH THE WIND, REIGN OF TERROR). Certes plusieurs plans filmés du point de vue de l’enfant sont efficaces, avec leurs perspectives faussées, les dimensions exagérées mais là encore les dialogues sont souvent idiots et les acteurs vraiment médiocres. Dans la dernière partie, tout se dégrade, le scénario, les situations, les décors. En particulier ces grottes d’une dizaine de mètres que les figurants parcourent une centaine de fois dans tous les sens jusqu’à ce qu’on en ait la nausée (pour être honnête, il faut dire que Menzies ne put contrôler le montage et que la production ajouta des flashes back de manœuvres militaires et multiplia ces plans de courses sur douze mètres carré). L’idéologie anti-rouge et belliciste colore le film (la peur, la haine de l’étranger). THINGS TO COME toujours de Menzies d’après Wells m’avait semblé statique, compassé. Son meilleur film reste ADDRESS UNKNOWN, disponible en zone 1 d’après le livre de Kressman Taylor qui écrivit le scénario.
RED PLANET MARS est aussi réalisé par un décorateur très talentueux, Harry Horner (THE WONDERFUL COUNTRY, L’ARNAQUEUR, ON ACHEVE BIEN LES CHEVAUX), auteur de quelques films intéressants. C’est une œuvre incroyablement solennelle, hyper religieuse qui détaille une escroquerie insensée effectuée par un agent double soviétique depuis la Cordillère des Andes, lequel veut faire croire que les martiens écoutent le sermon sur la montagne, ce qui va se révéler exact. Il y a des rebondissements ahurissants (la révolte en Russie où on nomme un Pope à la place du Soviet suprême). Les Russes commencent par dire : « Parlons en anglais pour qu’ils ne comprennent rien. » A plusieurs, malgré ou à cause de l’emphase du récit, on peut s’éclater. C’est le vrai nanar anti-rouge, tourné pourtant par un homme intelligent et cultivé.
 Sidonis va bientôt sortir le western de Jacques Tourneur STRANGER ON A HORSEBACK. Voici ce que j’en disais dans une chronique précédente : « STRANGER ON A HORSEBACK avait été une des plus heureuses surprises de la rétrospective Tourneur. On avait découvert un film original, d’une légèreté aérienne qui s’impose dès les premiers plans : Joel McCrea avance à cheval, en lisant un livre de loi et passe près d’une tombe qu’on est en train de creuser. Pas de dialogue… Juste un léger travelling latéral subjectif coupé par un plan serré d’une femme, plan inattendu qui s’enchaîne sur un plan large où McCrea, à droite du cadre, s’éloigne de la tombe. Un peu plus tard, un chat roux prend une place importante dans le bureau du marshal et sa présence décale les scènes. On le verra sauter du bureau quand trois hommes font brusquement irruption pour délivrer Kevin McCarthy. Ce dernier joue le rejeton du potentat local, violent, dégénéré, tyrannique et pourtant charmeur qui semble débarrassé de tous les clichés qui alourdissent ce personnage archétypal. Et la manière dont McCrea qui refuse de se servir de ses armes, le réduit à l’impuissance, est irrésistible. Il se débarrassera de la même manière d’un homme de main qui le provoque après un échange jubilatoire : l’homme l’arrose quand il passe près d’un abreuvoir. McCrea se contente de dire « il fait chaud ». Quand il revient sur ses pas, l’autre l’arrête : « je n’ai pas aimé ce que vous avez dit ». – « J’ai dit qu’il faisait chaud. » – « J’ai pas aimé le ton sur lequel vous l’avez dit. » Le ton, le traitement sont constamment inhabituels. McCrea, juge itinérant, découvre presque accidentellement qu’il y a eu un meurtre et commence à souligner toute une série d’actes délictueux. Tourneur filme tout cela de manière feutrée, presque dédramatisée : les rapports entre le juge et John Carradine, procureur corrompu qui essaie de sauver les suspects, sont extrêmement amusants et dégraissés des effets comiques redondants.
Sidonis va bientôt sortir le western de Jacques Tourneur STRANGER ON A HORSEBACK. Voici ce que j’en disais dans une chronique précédente : « STRANGER ON A HORSEBACK avait été une des plus heureuses surprises de la rétrospective Tourneur. On avait découvert un film original, d’une légèreté aérienne qui s’impose dès les premiers plans : Joel McCrea avance à cheval, en lisant un livre de loi et passe près d’une tombe qu’on est en train de creuser. Pas de dialogue… Juste un léger travelling latéral subjectif coupé par un plan serré d’une femme, plan inattendu qui s’enchaîne sur un plan large où McCrea, à droite du cadre, s’éloigne de la tombe. Un peu plus tard, un chat roux prend une place importante dans le bureau du marshal et sa présence décale les scènes. On le verra sauter du bureau quand trois hommes font brusquement irruption pour délivrer Kevin McCarthy. Ce dernier joue le rejeton du potentat local, violent, dégénéré, tyrannique et pourtant charmeur qui semble débarrassé de tous les clichés qui alourdissent ce personnage archétypal. Et la manière dont McCrea qui refuse de se servir de ses armes, le réduit à l’impuissance, est irrésistible. Il se débarrassera de la même manière d’un homme de main qui le provoque après un échange jubilatoire : l’homme l’arrose quand il passe près d’un abreuvoir. McCrea se contente de dire « il fait chaud ». Quand il revient sur ses pas, l’autre l’arrête : « je n’ai pas aimé ce que vous avez dit ». – « J’ai dit qu’il faisait chaud. » – « J’ai pas aimé le ton sur lequel vous l’avez dit. » Le ton, le traitement sont constamment inhabituels. McCrea, juge itinérant, découvre presque accidentellement qu’il y a eu un meurtre et commence à souligner toute une série d’actes délictueux. Tourneur filme tout cela de manière feutrée, presque dédramatisée : les rapports entre le juge et John Carradine, procureur corrompu qui essaie de sauver les suspects, sont extrêmement amusants et dégraissés des effets comiques redondants.
Ce film fut tourné en Ansco Color, procédé étrange qui semble bichrome et donne des teintes étranges qui dans les plans larges ne sont pas désagréables. Tourneur en tire quelques effets heureux.
Je viens de voir un épisode de JOHNNY STACCATO (ZONE 1) dirigé par John Cassavetes pas terrible malgré Charles McGraw en musicien has been qui veut revenir (MURDER FOR CREDIT). Un autre (THE NAKED TRUTH), moins bon encore, dirigé par Pevney. Ce qu’il y a de mieux, ce sont les plans d’extérieurs de New York (tout comme dans NAKED CITY mais là, les scénarios paraissent plus soignés) et la musique d’Elmer Bernstein. Deux autres épisodes sont un peu mieux écrits.

SORTIES
La sortie du magnifique LE HAVRE est une bonne occasion de revoir des Kaurismäki comme LA FILLE AUX ALLUMETTES, L’HOMME SANS PASSÉ. On peut s’étonner du petit nombre de DVD dont beaucoup sont en finlandais sans sous-titres. Mais il y a un coffret.
Profitons de TOUTES NOS ENVIES, pour revoir L’ÉQUIPIER, WELCOME, TOMBÉS DU CIEL de Philippe Lioret.
Et du splendide L’EXERCICE DE L’ÉTAT pour acheter le prometteur VERSAILLES de Pierre Schöller.

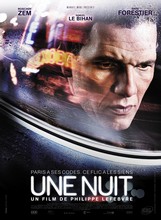 UNE NUIT de Philippe Lefebvre (son premier film de cinéma depuis le TRANSFUGE et le JUGE) est une excellente surprise qui s’apparente à un sous genre, le « street movie ». En effet les deux héros, Rochdy Zem et Sara Forestier sillonnent, parcourent, traversent un nombre incroyables de rues, de ponts, d’artères, des Champs Elysées à la rue de Richelieu, de la rue de Douai aux alentours de l’Étoile, de Pigalle à Montparnasse (UNE NUIT comprend le plus grand nombre de scènes nocturnes, de plans subjectifs depuis EXTÉRIEURS NUIT de Jacques Bral). Lefebvre, aidé de ses deux coscénaristes Philippe Izard et Simon Michael, évite bien des pièges, ne se livre à aucune surenchère, aucune démonstration de testostérone. Au contraire, il suit méthodiquement ses héros dans leurs incessantes visites cycliques dans des bars à putes, des boîtes échangistes, des clubs plus ou moins louches, des cafés où le père du barman dort par terre, abruti par l’anisette. On y croise des travestis plus ou moins déglingués, des camés, des patrons de bar qui biaisent sans cesse avec la loi, des prostitués qui tapinent dans les sanisettes du cours de Vincennes (j’avais filmé des scènes analogues dans L.627). Nulle fusillade, pas de règlements de compte spectaculaires mais des interrogatoires teigneux, une plongée dans un monde trouble où les amitiés anciennes, les trahisons, les combines, l’exercice même du métier de flic de la mondaine gangrènent les frontières de la morale, pointent toutes les dérives qui minent l’application de la loi. Nul manichéisme. Lefevbre sait garder ses distances, montrer la complexité de ses personnages. Son héros « borderline », admirablement joué par Rochdy Zem, navigue sans cesse dans des eaux interlopes, entre deux mondes, ne parvient plus à trouver ses repères. Sara Forestier est impeccable de discrétion et de justesse et j’ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir Samuel Le Bihan, tout à fait remarquable. Gerald Laroche, Jean-Paul Muel, Sophie Broustal campent des figures inoubliables et Richard Borhinger fait une fulgurante apparition.
UNE NUIT de Philippe Lefebvre (son premier film de cinéma depuis le TRANSFUGE et le JUGE) est une excellente surprise qui s’apparente à un sous genre, le « street movie ». En effet les deux héros, Rochdy Zem et Sara Forestier sillonnent, parcourent, traversent un nombre incroyables de rues, de ponts, d’artères, des Champs Elysées à la rue de Richelieu, de la rue de Douai aux alentours de l’Étoile, de Pigalle à Montparnasse (UNE NUIT comprend le plus grand nombre de scènes nocturnes, de plans subjectifs depuis EXTÉRIEURS NUIT de Jacques Bral). Lefebvre, aidé de ses deux coscénaristes Philippe Izard et Simon Michael, évite bien des pièges, ne se livre à aucune surenchère, aucune démonstration de testostérone. Au contraire, il suit méthodiquement ses héros dans leurs incessantes visites cycliques dans des bars à putes, des boîtes échangistes, des clubs plus ou moins louches, des cafés où le père du barman dort par terre, abruti par l’anisette. On y croise des travestis plus ou moins déglingués, des camés, des patrons de bar qui biaisent sans cesse avec la loi, des prostitués qui tapinent dans les sanisettes du cours de Vincennes (j’avais filmé des scènes analogues dans L.627). Nulle fusillade, pas de règlements de compte spectaculaires mais des interrogatoires teigneux, une plongée dans un monde trouble où les amitiés anciennes, les trahisons, les combines, l’exercice même du métier de flic de la mondaine gangrènent les frontières de la morale, pointent toutes les dérives qui minent l’application de la loi. Nul manichéisme. Lefevbre sait garder ses distances, montrer la complexité de ses personnages. Son héros « borderline », admirablement joué par Rochdy Zem, navigue sans cesse dans des eaux interlopes, entre deux mondes, ne parvient plus à trouver ses repères. Sara Forestier est impeccable de discrétion et de justesse et j’ai eu beaucoup de plaisir à redécouvrir Samuel Le Bihan, tout à fait remarquable. Gerald Laroche, Jean-Paul Muel, Sophie Broustal campent des figures inoubliables et Richard Borhinger fait une fulgurante apparition.
Voilà un autre polar qui m’a surpris, après POLISSE, le simenonien COUP D’ÉCLAT de José Alcala, bien écrit et si bien joué par Catherine Frot, l’inoxydable Liliane Rovère et Marie Reynal (déjà admirée dans ALEX, le précédent Alcala), entre autres et le frénétique NUIT BLANCHE de Frédéric Jardin, photographié, excusez du peu, par l’eastwoodien Tom Stern. Le film noir français se porte bien.
QUELQU’UN a-t-il vu RUBBER qui bénéficie d’une belle édition DVD ?
Lire la suite »