Documentaires et westerns
21 avril 2011 par Bertrand Tavernier - DVD
REPENTIRS
 J’ai finalement vu THE WOMAN IN QUESTION d’Anthony Asquith, film criminel qui retrace le portrait d’une jeune diseuse de bonne aventure, assassinée dans un hôtel minable, à travers cinq témoignages contradictoires qui la peignent tantôt comme une femme rangée, tantôt comme une prostituée, tantôt comme une arriviste ou quelqu’un qui est exploitée. Et bien sûr tous les autres personnages changent avec elles. Le film est sorti en 1950 tout comme RASHOMON, un an après LA FERME DES 7 PÉCHÉS de Jean Devaivre, sans oublier CITIZEN KANE.
J’ai finalement vu THE WOMAN IN QUESTION d’Anthony Asquith, film criminel qui retrace le portrait d’une jeune diseuse de bonne aventure, assassinée dans un hôtel minable, à travers cinq témoignages contradictoires qui la peignent tantôt comme une femme rangée, tantôt comme une prostituée, tantôt comme une arriviste ou quelqu’un qui est exploitée. Et bien sûr tous les autres personnages changent avec elles. Le film est sorti en 1950 tout comme RASHOMON, un an après LA FERME DES 7 PÉCHÉS de Jean Devaivre, sans oublier CITIZEN KANE.
Plus que la résolution de l’intrigue criminelle, on sent que c’est l’expérimentation narrative qui inspire Asquith : va et vient dans le temps, changements dans les costumes, le décor selon le point de vue, le narrateur, flashes back introduits et interrompus – parfois au milieu d’une scène – par des effets sonores, un montage cut audacieux pour l’époque. Autre qualité réelle, l’utilisation du cadre – une petite ville balnéaire à demi déserte, traversée par un train. L’hôtel où se déroulent la plupart des interrogatoires, doit être situé tout près des voies ce qui nous vaut de brusques irruptions de fumée, effets saisissants qu’Asquith utilise très habilement, derrière la fenêtre des chambres, accentués par le vacarme du train. Le style de jeu des acteurs change aussi selon les points de vue ; Jean Kent paraît un peu caricaturale dans le premier épisode puis se transforme peu à peu. Elle est excellente dans l’épisode qui épouse le point de vue de sa sœur. Dirk Bogarde est très beau, mais on le sent parfois gêné par le fait de jouer un Américain.
 Autre film britannique que j’aurais dû signaler : MORGAN, A SUITABLE CASE FOR TREATMENT, magnifique film de Karel Reisz que je ne me lasse pas de redécouvrir. Les séquences sur la tombe de Karl Marx sont anthologiques. Brillant dialogue de David Mercer.
Autre film britannique que j’aurais dû signaler : MORGAN, A SUITABLE CASE FOR TREATMENT, magnifique film de Karel Reisz que je ne me lasse pas de redécouvrir. Les séquences sur la tombe de Karl Marx sont anthologiques. Brillant dialogue de David Mercer.
 THE WORLD TEN TIMES OVER, écrit et réalisé avec quelques éclairs de style par Wolf Rilla (le réalisateur du VILLAGE DES DAMNÉS que je trouve surestimé qui devint hôtelier et restaurateur dans le sud est de la France) évoque la destinée de deux prostituées que le film rebaptise pudiquement « hôtesses ».Le film fut pourtant interdit aux mineurs, ramené à moins de 12 ans maintenant. Il est pourtant fort chaste et les deux actrices ne sont pas du tout déshabillées. June Ritchie s’en sort le moins bien avec un personnage assez exaspérant et écrit de manière monocorde. La gracieuse Sylvia Syms est meilleure et les scènes où elle affronte son père qui refuse de voir, de comprendre son activité sont parmi les plus réussies. A commencer par cette déambulation nocturne dans Soho de William Hartnell au milieu des enseignes, des néons publicisant de multiples offres sexuelles. La séquence a peu d’équivalents dans le cinéma britannique de l’époque (1963). La variété et l’importance des extérieurs fait d’ailleurs le principal intérêt de cette œuvre.
THE WORLD TEN TIMES OVER, écrit et réalisé avec quelques éclairs de style par Wolf Rilla (le réalisateur du VILLAGE DES DAMNÉS que je trouve surestimé qui devint hôtelier et restaurateur dans le sud est de la France) évoque la destinée de deux prostituées que le film rebaptise pudiquement « hôtesses ».Le film fut pourtant interdit aux mineurs, ramené à moins de 12 ans maintenant. Il est pourtant fort chaste et les deux actrices ne sont pas du tout déshabillées. June Ritchie s’en sort le moins bien avec un personnage assez exaspérant et écrit de manière monocorde. La gracieuse Sylvia Syms est meilleure et les scènes où elle affronte son père qui refuse de voir, de comprendre son activité sont parmi les plus réussies. A commencer par cette déambulation nocturne dans Soho de William Hartnell au milieu des enseignes, des néons publicisant de multiples offres sexuelles. La séquence a peu d’équivalents dans le cinéma britannique de l’époque (1963). La variété et l’importance des extérieurs fait d’ailleurs le principal intérêt de cette œuvre.
Avant de passer aux documentaires, je tiens à signaler le livre passionnant de Daniel Mendelsohn (le splendide les DISPARUS), SI BEAU, SI FRAGILE, recueil d’essais passionnants, décapants sur la manière de monter Tennessee Williams, Virginia Woolf mais aussi sur Almodovar, Tarantino. Les analyses de TROIE, de 300 sont particulièrement jubilatoires et radiographient l’inculture et le manque de goût des auteurs.
DOCUMENTAIRES
Ces derniers temps sont sortis un nombre considérable de documentaires de premier ordre. Je voudrais en louer, en recenser quelques uns en espérant que mes propos donneront l’envie d’en acheter ou louer certains.
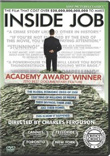 A tout seigneur, tout honneur, commençons par Charles Ferguson avec son imparable, magnifique INSIDE JOB analyse au scalpel de la crise financière, de ses causes, de ses conséquences qu’hélas Obama laisse en jachère. Beaucoup de films policiers paraissent ternes, palots à côté de cette enquête qui met en lumière les liens entre les banques, les structures financières et tous les présidents américains depuis Reagan. J’ai été vraiment étonné qu’un économiste aussi brillant que Bernard Maris n’ait pas trouvé le temps de voir le film et de le commenter, de s’en servir. Très souvent les commentateurs, les politiques qui devraient être les premiers concernés paraissent dédaigner le cinéma. Christine Boutin avait découvert avec stupéfaction trois ou quatre ans après sa sortie CA COMMENCE AUJOURD’HUI dont beaucoup de thèmes la concernaient au premier chef.
A tout seigneur, tout honneur, commençons par Charles Ferguson avec son imparable, magnifique INSIDE JOB analyse au scalpel de la crise financière, de ses causes, de ses conséquences qu’hélas Obama laisse en jachère. Beaucoup de films policiers paraissent ternes, palots à côté de cette enquête qui met en lumière les liens entre les banques, les structures financières et tous les présidents américains depuis Reagan. J’ai été vraiment étonné qu’un économiste aussi brillant que Bernard Maris n’ait pas trouvé le temps de voir le film et de le commenter, de s’en servir. Très souvent les commentateurs, les politiques qui devraient être les premiers concernés paraissent dédaigner le cinéma. Christine Boutin avait découvert avec stupéfaction trois ou quatre ans après sa sortie CA COMMENCE AUJOURD’HUI dont beaucoup de thèmes la concernaient au premier chef.
 Avant INSIDE JOB, Ferguson avait réalisé l’extraordinaire NO END IN SIGHT (zone 1) sur la période qui suivit la chute de Saddam Hussein. Ces quelques années durant lesquelles un groupe d’homme a réussi à force d’incompétence, d’ignorance, d’arrogance (il ne faut oublier aucun de ces trois termes comme le démontre le film) à plonger le pays dans le chaos, la misère, l’horreur. Et conséquences terribles, à déstabiliser le monde, doper le terrorisme, faire haïr l’Amérique et la démocratie, donner une vraie et inespérée crédibilité à l’Iran. Ferguson oppose à la mise en sac de l’Irak commise par Paul Bremer, ses chefs (Donald Rumsfeld) et leurs conseillers dont pas un ne parlait l’une des langues du pays, n’avait la moindre notion de son Histoire, de celle des différents courants religieux ou n’avait participé à la moindre opération de reconstruction, la décision de Roosevelt de réunir des petits groupes d’experts parlant allemand ou japonais qui préparaient l’après guerre dès 1942. Les personnes chargées de reconstruire l’Irak furent pratiquement choisies, au contraire, lors de la chute de Bagdad. Barbara Bodine raconte qu’elle se retrouva dotée d’un bureau, d’une table et d’un ordinateur et assista, impuissante, aux conneries criminelles de Bremer, au gigantesque gaspillage. Plusieurs milliards de dollars s’évanouirent dans la nature.
Avant INSIDE JOB, Ferguson avait réalisé l’extraordinaire NO END IN SIGHT (zone 1) sur la période qui suivit la chute de Saddam Hussein. Ces quelques années durant lesquelles un groupe d’homme a réussi à force d’incompétence, d’ignorance, d’arrogance (il ne faut oublier aucun de ces trois termes comme le démontre le film) à plonger le pays dans le chaos, la misère, l’horreur. Et conséquences terribles, à déstabiliser le monde, doper le terrorisme, faire haïr l’Amérique et la démocratie, donner une vraie et inespérée crédibilité à l’Iran. Ferguson oppose à la mise en sac de l’Irak commise par Paul Bremer, ses chefs (Donald Rumsfeld) et leurs conseillers dont pas un ne parlait l’une des langues du pays, n’avait la moindre notion de son Histoire, de celle des différents courants religieux ou n’avait participé à la moindre opération de reconstruction, la décision de Roosevelt de réunir des petits groupes d’experts parlant allemand ou japonais qui préparaient l’après guerre dès 1942. Les personnes chargées de reconstruire l’Irak furent pratiquement choisies, au contraire, lors de la chute de Bagdad. Barbara Bodine raconte qu’elle se retrouva dotée d’un bureau, d’une table et d’un ordinateur et assista, impuissante, aux conneries criminelles de Bremer, au gigantesque gaspillage. Plusieurs milliards de dollars s’évanouirent dans la nature.
 GONZO d’Alex Gibney est un fascinant documentaire consacré à Hunter Thompson, ce maître du journalisme gonzo, méthode d’investigation journalistique axée sur l’ultra-subjectivité, inventée par Bill Cardoso et qu’il popularisa, pour écrire Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang. Ce que l’on entend de ses textes donne envie de lire tous ses essais et surtout ceux sur les campagnes électorales de Mc Govern ou Carter.
GONZO d’Alex Gibney est un fascinant documentaire consacré à Hunter Thompson, ce maître du journalisme gonzo, méthode d’investigation journalistique axée sur l’ultra-subjectivité, inventée par Bill Cardoso et qu’il popularisa, pour écrire Hell’s Angels: The Strange and Terrible Saga of the Outlaw Motorcycle Gang. Ce que l’on entend de ses textes donne envie de lire tous ses essais et surtout ceux sur les campagnes électorales de Mc Govern ou Carter.
 CLEVELAND CONTRE WALL STREET est une œuvre utile, estimable, souvent touchante. Je trouve simplement que l’avocat qui lance la procédure contre Wall Street paraît prisonnier de ses bonnes intentions. Il manque de réparties, de pugnacité face à son adversaire, ne trouve pas le temps de rétorquer, quand ce dernier comparant les subprimes aux armes, déclare qu’elles ne sont mauvaises que quand on s’en sert mal, de rétorquer que même le commerce de ces armes est régulé : on ne peut pas vendre à quelqu’un qui a un casier judiciaire, à un mineur. Ces contraintes, très légères, s’opposent au libéralisme absolu des subprimes. Il y a dans ce film, un personnage stupéfiant, véritable sujet de long-métrage : ce vendeur de drogue noir, très charismatique, qui se trouve propulsé par hasard dans le monde des subprimes, y fait de carrière, avant de tout plaquer, jugeant que c’est bien pire que la drogue.
CLEVELAND CONTRE WALL STREET est une œuvre utile, estimable, souvent touchante. Je trouve simplement que l’avocat qui lance la procédure contre Wall Street paraît prisonnier de ses bonnes intentions. Il manque de réparties, de pugnacité face à son adversaire, ne trouve pas le temps de rétorquer, quand ce dernier comparant les subprimes aux armes, déclare qu’elles ne sont mauvaises que quand on s’en sert mal, de rétorquer que même le commerce de ces armes est régulé : on ne peut pas vendre à quelqu’un qui a un casier judiciaire, à un mineur. Ces contraintes, très légères, s’opposent au libéralisme absolu des subprimes. Il y a dans ce film, un personnage stupéfiant, véritable sujet de long-métrage : ce vendeur de drogue noir, très charismatique, qui se trouve propulsé par hasard dans le monde des subprimes, y fait de carrière, avant de tout plaquer, jugeant que c’est bien pire que la drogue.
 THE CAT, THE REVEREND AND THE SLAVE est une vraie expérience : pendant plusieurs mois, les réalisateurs ont approché et filmé trois communautés emblématiques du monde virtuel Second Life : les Furries, les Evangélistes, et les Goréens. On voit toute une série de personnages d’américains moyens se perdre, s’affronter et parfois refaire leur vie à travers un univers virtuel, celui de Second Life. Ils passent des heures devant leur ordinateur, parfois entre trois et cinq heures du matin, avant d’aller au boulot. Je n’ai pas réussi à comprendre vraiment comment certains pouvaient s’enrichir, avec la devise de Second Life, voire faire des opérations immobilières.
THE CAT, THE REVEREND AND THE SLAVE est une vraie expérience : pendant plusieurs mois, les réalisateurs ont approché et filmé trois communautés emblématiques du monde virtuel Second Life : les Furries, les Evangélistes, et les Goréens. On voit toute une série de personnages d’américains moyens se perdre, s’affronter et parfois refaire leur vie à travers un univers virtuel, celui de Second Life. Ils passent des heures devant leur ordinateur, parfois entre trois et cinq heures du matin, avant d’aller au boulot. Je n’ai pas réussi à comprendre vraiment comment certains pouvaient s’enrichir, avec la devise de Second Life, voire faire des opérations immobilières.
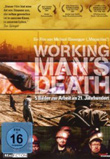 WORKINGMAN’S DEATH de Michael Glawogger vous coupe le souffle. Ces cinq portraits du travail au XXIème siècle vous clouent sur votre fauteuil. Glawogger a choisi 5 pays où des hommes sont exploités dans des conditions d’une violence qui exclut toutes règles sociales, tout humanisme. Des Russes exploitent illégalement une mine de charbon où ils ne peuvent travailler qu’allongés (ce qui ne les empêche pas de se raconter des histoires, des blagues lors d’une scène inoubliable), des Pakistanais désossent un pétrolier qui va être dépecé sous nos yeux. Il y a là des images extrêmement belle (trop ?), proches parfois du vidéo art : des énormes pans de ferraille tombent dans la mer En Indonésie, des hommes vont chercher des blocs de soude au milieu de geysers brûlants et toxiques, sur un sentier qui jouxte un précipice. Des touristes demandent le poids de la charge : « 115 kilos », répond le porteur – « C’est beaucoup » – « Certainement ». Pas de commentaires mais des images terribles. A ne pas manquer.
WORKINGMAN’S DEATH de Michael Glawogger vous coupe le souffle. Ces cinq portraits du travail au XXIème siècle vous clouent sur votre fauteuil. Glawogger a choisi 5 pays où des hommes sont exploités dans des conditions d’une violence qui exclut toutes règles sociales, tout humanisme. Des Russes exploitent illégalement une mine de charbon où ils ne peuvent travailler qu’allongés (ce qui ne les empêche pas de se raconter des histoires, des blagues lors d’une scène inoubliable), des Pakistanais désossent un pétrolier qui va être dépecé sous nos yeux. Il y a là des images extrêmement belle (trop ?), proches parfois du vidéo art : des énormes pans de ferraille tombent dans la mer En Indonésie, des hommes vont chercher des blocs de soude au milieu de geysers brûlants et toxiques, sur un sentier qui jouxte un précipice. Des touristes demandent le poids de la charge : « 115 kilos », répond le porteur – « C’est beaucoup » – « Certainement ». Pas de commentaires mais des images terribles. A ne pas manquer.
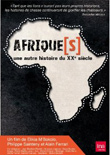 Parmi les œuvres conçues pour la télévision, je voudrais retenir AFRIQUES, UNE AUTRE HISTOIRE DU XXÈME SIÉCLE une série de Elikia M’Bokolo, Philippe Sainteny et Alain Ferrari, réalisée par Alain Ferrari (INA), épisodes qui passent au crible, avec intelligence, acuité 100 années de l’histoire de l’Afrique. Documents et interviews passionnants remettent en cause bien des clichés, des idées reçues, réhabilitent des combattants oubliés, pointent les erreurs et les sottises… Voilà une œuvre que nos politiques et nos conseillers auraient bien fait de visionner avant le triste discours de Dakar. Je n’ai pas oublié ce moment où une institutrice fait défiler ses gamins devant des fresques médiocres représentants Marx, Engels, Lénine… pendant qu’ils ânonnent tous ces noms.
Parmi les œuvres conçues pour la télévision, je voudrais retenir AFRIQUES, UNE AUTRE HISTOIRE DU XXÈME SIÉCLE une série de Elikia M’Bokolo, Philippe Sainteny et Alain Ferrari, réalisée par Alain Ferrari (INA), épisodes qui passent au crible, avec intelligence, acuité 100 années de l’histoire de l’Afrique. Documents et interviews passionnants remettent en cause bien des clichés, des idées reçues, réhabilitent des combattants oubliés, pointent les erreurs et les sottises… Voilà une œuvre que nos politiques et nos conseillers auraient bien fait de visionner avant le triste discours de Dakar. Je n’ai pas oublié ce moment où une institutrice fait défiler ses gamins devant des fresques médiocres représentants Marx, Engels, Lénine… pendant qu’ils ânonnent tous ces noms.
 NOTRE POISON QUOTIDIEN (INA ARTE) de Monique Robin dénonce de manière très documentée la présence, l’importance des pesticides, des agents chimiques dans notre nourriture quotidienne. Ce qu’elle montre des instances de régulation tant en France, en Europe qu’aux USA a de quoi faire peur. La non transparence des dossiers, des décisions prises à l’OMS, au CIRC, à la FDA, le poids financier des lobby de l’industrie chimique qui commande des dizaines études qui lui sont toutes favorables (C’est sur 3 de ces études que certaines décisions ont été prises qui exonèrent les fabricants des biberons en plastique). Le dossier de l’Aspartame est tout à fait symptomatique. Donald Rumsfeld, ancien PDG de Searle qui le fabrique, vient de rentrer au gouvernement Reagan. Il va nommer le président de la FDA et cet édulcorant qui avait été interdit en 1974, va être autorisé en 1981. Monique Robin trouve beaucoup d’exemples similaires et dénonce la présence de scientifiques travaillant pour ces firmes. Aucun parti politique ne semble vouloir s’attaquer à ce problème majeur, source de multiples cancers, de maladies nombreuses et cause de la stérilité qui grandit dans nos pays.
NOTRE POISON QUOTIDIEN (INA ARTE) de Monique Robin dénonce de manière très documentée la présence, l’importance des pesticides, des agents chimiques dans notre nourriture quotidienne. Ce qu’elle montre des instances de régulation tant en France, en Europe qu’aux USA a de quoi faire peur. La non transparence des dossiers, des décisions prises à l’OMS, au CIRC, à la FDA, le poids financier des lobby de l’industrie chimique qui commande des dizaines études qui lui sont toutes favorables (C’est sur 3 de ces études que certaines décisions ont été prises qui exonèrent les fabricants des biberons en plastique). Le dossier de l’Aspartame est tout à fait symptomatique. Donald Rumsfeld, ancien PDG de Searle qui le fabrique, vient de rentrer au gouvernement Reagan. Il va nommer le président de la FDA et cet édulcorant qui avait été interdit en 1974, va être autorisé en 1981. Monique Robin trouve beaucoup d’exemples similaires et dénonce la présence de scientifiques travaillant pour ces firmes. Aucun parti politique ne semble vouloir s’attaquer à ce problème majeur, source de multiples cancers, de maladies nombreuses et cause de la stérilité qui grandit dans nos pays.
 Signalons aussi aux Editions Montparnasse, qui font un travail exemplaire pour le documentaire de création, le coffret de 10 DVD consacré aux films du Prix Albert Londres. Des Khmers rouges filmés par Ritty Panh à l’affaire Farewell en passant par la bande de Gaza et le procès de Klaus Barbie. On retrouve des films de Xavier de Lestrade, Christophe de Ponfilly, Philippe Rochot, Monique Robin etc.
Signalons aussi aux Editions Montparnasse, qui font un travail exemplaire pour le documentaire de création, le coffret de 10 DVD consacré aux films du Prix Albert Londres. Des Khmers rouges filmés par Ritty Panh à l’affaire Farewell en passant par la bande de Gaza et le procès de Klaus Barbie. On retrouve des films de Xavier de Lestrade, Christophe de Ponfilly, Philippe Rochot, Monique Robin etc.
 On ne saurait conclure sans parler de Ken Burns et de deux de ses dernières œuvres : THE NATIONAL PARKS sous-titré America’s best idea sur la création des parcs nationaux, les combats qu’il a fallu mener pour les imposer. Aux politiques, à des élus locaux, aux industriels. Combat pour préserver la nature (Burns filme une variété inouïe de paysages sublimes), la faune, combat écologique avant la lettre. D’ailleurs une des premières décisions de George W Bush et Rumsfeld a été de vouloir céder des milliers d’hectares aux compagnies pétrolières et minières, décision qui a pu être en partie repoussée. Depuis la projection du film, la fréquentation a été incroyablement dopée, a plus que quadruplé, retrouvant le nombre de visiteur qu’ils avaient sous Roosevelt.
On ne saurait conclure sans parler de Ken Burns et de deux de ses dernières œuvres : THE NATIONAL PARKS sous-titré America’s best idea sur la création des parcs nationaux, les combats qu’il a fallu mener pour les imposer. Aux politiques, à des élus locaux, aux industriels. Combat pour préserver la nature (Burns filme une variété inouïe de paysages sublimes), la faune, combat écologique avant la lettre. D’ailleurs une des premières décisions de George W Bush et Rumsfeld a été de vouloir céder des milliers d’hectares aux compagnies pétrolières et minières, décision qui a pu être en partie repoussée. Depuis la projection du film, la fréquentation a été incroyablement dopée, a plus que quadruplé, retrouvant le nombre de visiteur qu’ils avaient sous Roosevelt.
Baseball the Tenth Ining est un constat sans complaisance sur le sport national de l’Amérique, son évolution, les dangers qui le menacent.
WESTERNS
TRUE GRIT.
L’immense succès du beau western des frères Coen, TRUE GRIT m’a donné envie de revoir la version de Henry Hathaway, distribuée en France uniquement en Blue Ray. Et de lire le livre de Charles Portis (éditions Nova). Une première constatation s’impose. J’ai lu de multiples articles tant en France qu’aux USA (l’excellente analyse de Frank Rich dans le New York Times), entendu de multiples déclarations (sur France Inter ou France Culture), claironnant qu’il ne s’agissait pas d’un remake, que, de toutes les manières, la première version était banale, « juste un western gorgé de Technicolor », dirigé par un « homme à tout faire », assertions qui sont plus que discutables, expression polie pour dire qu’elles sont complètement fausses.
 Les deux films sont souvent très proches pour la bonne et simple raison qu’ils sont tous les deux très fidèles au magnifique roman qu’ils adaptent. Mon ami Pat Mc Gilligan a relevé plus de 30 scènes qui reprennent mot pour mot le même dialogue, celui de Portis (le tribunal, les discussions financières avec Stonehill, la plupart des échanges entre Mattie et Rooster, la longue séquence dans la cabane et bien d’autres). Marguerite Roberts, la scénariste de la première version, adorait le livre tout comme Hathaway et les frères Coen. C’était une femme talentueuse, comme le prouvent ses premiers scripts, HOLLYWOOD BOULEVARD, SAILOR’S LUCK, qui travailla sous contrat à la MGM (citons surtout THE BRIBE, ESCAPE, IVANHOE) bien qu’ayant adhéré au parti communiste qu’elle quitta en 1947. Mais elle et son mari John Sanford refusèrent de donner des noms, de témoigner et furent mis sur la liste noire de 1951 à 1962. Il est assez ironique que son principal titre de gloire soit un film avec Wayne, anti communiste féroce mais qui était suffisamment intelligent et ouvert pour dire que c’était le meilleur scénario qu’on lui avait donné.
Les deux films sont souvent très proches pour la bonne et simple raison qu’ils sont tous les deux très fidèles au magnifique roman qu’ils adaptent. Mon ami Pat Mc Gilligan a relevé plus de 30 scènes qui reprennent mot pour mot le même dialogue, celui de Portis (le tribunal, les discussions financières avec Stonehill, la plupart des échanges entre Mattie et Rooster, la longue séquence dans la cabane et bien d’autres). Marguerite Roberts, la scénariste de la première version, adorait le livre tout comme Hathaway et les frères Coen. C’était une femme talentueuse, comme le prouvent ses premiers scripts, HOLLYWOOD BOULEVARD, SAILOR’S LUCK, qui travailla sous contrat à la MGM (citons surtout THE BRIBE, ESCAPE, IVANHOE) bien qu’ayant adhéré au parti communiste qu’elle quitta en 1947. Mais elle et son mari John Sanford refusèrent de donner des noms, de témoigner et furent mis sur la liste noire de 1951 à 1962. Il est assez ironique que son principal titre de gloire soit un film avec Wayne, anti communiste féroce mais qui était suffisamment intelligent et ouvert pour dire que c’était le meilleur scénario qu’on lui avait donné.
Ce sont les différences entre les deux films qui sont révélatrices. La Mattie des frères Coen est évidemment l’atout majeur du film et un choix brillant, avec son extrême jeunesse. Kim Darby est plus âgée mais je la trouve vraiment bonne (elle se bonifie à chaque vision) et il faut dire que Hathaway se battit pour imposer la très jeune Sally Field, superbe idée de distribution rejetée par Hal Wallis qui lui préférait Mia Farrow que je n’arrive pas à imaginer en paysanne. Quand elle lâcha le film, Hathaway découvrir Darby dans un téléfilm. Personnellement je trouve Wayne plus fort, plus impressionnant, plus crédible en tueur que Jeff Bridges qui joue les durs. Les méchants sont aussi bons dans les deux films mais je garde un faible pour Robert Duvall et Dennis Hooper et Jeff Corey est un peu plus effrayant que Josh Brolin, alors que Matt Damon surpasse Glenn Campbel (que j’ai trouvé aussi meilleur que dans mon souvenir).
Je regrette la disparition du chat, le général Sterling Price, et la diminution du rôle du Chinois Lee dans la version des Coen et me demande si, en revanche, certains ajouts réjouissants ne frôlent pas la préciosité (Mattie dormant dans un cercueil, le type déguisé en ours). La chevauchée nocturne est plus lyrique chez les Coen mais je trouve que Hathaway et Roberts ont eu raison de faire tuer Laboeuf, ce qui donne du poids à cette quête. Il y a eu un prix à payer.
La pendaison, au début, est aussi bien traitée dans les deux œuvres (j’ai quand même l’impression qu’elle est plus naturelle chez Hathaway) et les moments de violence dans la cabane se valent. Ils sont très proches, aussi réussis chez l’un que chez l’autre. La musique d’Elmer Bernstein est peut être plus conventionnelle encore qu’elle soit très habile au début.
Et surtout, la fin, est beaucoup plus émouvante chez Hathaway que chez les Coen qui, pourtant, restent fidèle à Portis. En trahissant le livre, en inventant cette dernière rencontre dans un cimetière enneigé, il réussit une séquence magistrale, chargée d’une mélancolique nostalgie. On devine ce que deviendra cette adolescente, si rangée, si précise et le moment où elle demande à Wayne de se faire enterrer à coté de la place qu’elle s’est choisie me bouleverse à chaque vision. Cette fin donne tout son sens à l’histoire mieux que la séquence du cirque qui fait commentaire.
Signalons aussi la splendide WINTER’S BONES qui montre que l’univers de TRUE GRIT n’a pas disparu.
Joseph H Lewis
 Deux films très différents dont la juxtaposition soulève bien des questions. 7th CAVALRY(qui m’avait paru médiocre lors d’une vision lointaine à la Cinémathèque) est pire, plus inerte et plat que dans mon souvenir. Le manque d’action qui aurait pu conférer une rigueur, une austérité analytique, vire à la mollesse. Les deux bagarres avec leur utilisation maladroite et abusive des doublures, sont aussi interminables que pauvrement filmées. La pauvreté des cadres, la banalité des mouvements d’appareil, l’absence d’idées visuelles étonnent, venant d’un réalisateur aussi brillant, esthète que Lewis dans certains films (souvenez vous du hold-up du DEMON DES ARMES filmé en un seul plan). Les cavalcades sont filmées frontalement, avec des panoramiques monotones, dans des extérieurs pour la plupart extrêmement ternes. Le sujet avait été déjà traité de manière assez similaire et avec une autre force dramatique, une autre invention scénaristique par Charles Marquis Warren dans LITTLE BIG HORN (zone 1VCI sans sous titre).
Deux films très différents dont la juxtaposition soulève bien des questions. 7th CAVALRY(qui m’avait paru médiocre lors d’une vision lointaine à la Cinémathèque) est pire, plus inerte et plat que dans mon souvenir. Le manque d’action qui aurait pu conférer une rigueur, une austérité analytique, vire à la mollesse. Les deux bagarres avec leur utilisation maladroite et abusive des doublures, sont aussi interminables que pauvrement filmées. La pauvreté des cadres, la banalité des mouvements d’appareil, l’absence d’idées visuelles étonnent, venant d’un réalisateur aussi brillant, esthète que Lewis dans certains films (souvenez vous du hold-up du DEMON DES ARMES filmé en un seul plan). Les cavalcades sont filmées frontalement, avec des panoramiques monotones, dans des extérieurs pour la plupart extrêmement ternes. Le sujet avait été déjà traité de manière assez similaire et avec une autre force dramatique, une autre invention scénaristique par Charles Marquis Warren dans LITTLE BIG HORN (zone 1VCI sans sous titre).
La vision de Custer est incroyablement pauvre, timorée par rapport à FORT APACHE, à TOMAHAWK ou AU MEPRIS DES LOIS, voire au livre lyrique et passionnant d’Ernest Haycox, BUGLES IN THE AFTERNOON (qu’on peut trouver sur des sites US). On est plus proche de la minable adaptation qu’en avait tiré Roy Rowland, LES CLAIRONS SONNENT LA CHARGE.
Les quelques éléments qui auraient pu être intéressants (un débat contradictoire autour de Custer) sont rapidement écartés, balayés par le personnage que joue Scott dont le coté buté, étroit d’esprit, finit par être déplaisant. La manière dont il parle aux Indiens en leur expliquant que leurs croyances, c’est de la superstition, témoigne d’une grande arrogance qui semble avoir dix ans de retard sur de très nombreux westerns.
On est loin de l’autre western de JH Lewis avec Scott, Lawless Street (VILLE SANS LOI). La différence est même sidérante.
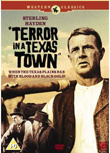 Elle l’est encore plus avec TERROR IN A TEXAS TOWN que je viens de revoir dans une belle copie (DVD MGM zone 1 sous-titres français) Certaines de mes réserves (pauvreté des décors, solennité du ton) disparaissent lors de cette nouvelle vision. Je ne sais pas si je le qualifierai de « bon film » un bon film car ses défauts, interprétation parfois hiératique, étrange accent suédois de Hayden, peuvent déconcerter, mais le ton glacé du film, la longueur de certains plans (dans le saloon), la débauche de cadrages insolites privilégiant les amorces (énorme roue, colonnade) qui tordent l’espace, statufient l’action, lui confèrent un coté baroque, sur mise en scène, qui jure avec la simplicité de l’intrigue, tout cela donne un ton vraiment insolite, accentué par la musique de Gerald Fried qui est tout sauf une musique de western : éclats de trompette qui ne dépareraient pas une mise en scène de Laurence Olivier, dissonances à la Paul Dessau, lamento percussif. Les extérieurs sont réduits au minimum et sont d’un dépouillement qui frôle l’abstraction. Le film est d’ailleurs beaucoup plus proche d’un film noir claustrophobique dans le style de SO DARK IS THE NIGHT, l’un des titres majeurs de Lewis, que d’un western. Le dialogue de Trumbo (sous le pseudonyme de Ben Perry) est très écrit, très volontariste et les allusions à la liste noire sont évidentes.
Elle l’est encore plus avec TERROR IN A TEXAS TOWN que je viens de revoir dans une belle copie (DVD MGM zone 1 sous-titres français) Certaines de mes réserves (pauvreté des décors, solennité du ton) disparaissent lors de cette nouvelle vision. Je ne sais pas si je le qualifierai de « bon film » un bon film car ses défauts, interprétation parfois hiératique, étrange accent suédois de Hayden, peuvent déconcerter, mais le ton glacé du film, la longueur de certains plans (dans le saloon), la débauche de cadrages insolites privilégiant les amorces (énorme roue, colonnade) qui tordent l’espace, statufient l’action, lui confèrent un coté baroque, sur mise en scène, qui jure avec la simplicité de l’intrigue, tout cela donne un ton vraiment insolite, accentué par la musique de Gerald Fried qui est tout sauf une musique de western : éclats de trompette qui ne dépareraient pas une mise en scène de Laurence Olivier, dissonances à la Paul Dessau, lamento percussif. Les extérieurs sont réduits au minimum et sont d’un dépouillement qui frôle l’abstraction. Le film est d’ailleurs beaucoup plus proche d’un film noir claustrophobique dans le style de SO DARK IS THE NIGHT, l’un des titres majeurs de Lewis, que d’un western. Le dialogue de Trumbo (sous le pseudonyme de Ben Perry) est très écrit, très volontariste et les allusions à la liste noire sont évidentes.
A noter que c’est un des rares films où l’on voit un cavalier sauter de sa monture et se diriger vers un bâtiment tandis que son cheval s’échappe dans la rue (ce qui foule au pied un cliché). La pauvreté du budget fait que Lewis utilise deux fois le même cadrage et un autre personnage laisse aussi partir sa monture.
 J’avais un relatif manque d’intérêt pour THE NEVADAN (l’HOMME DU NEVADA, zone 2 Sidonis) de Gordon Douglas. J’ai trouvé, heureuse surprise, la première heure bien filmée (les plans durant le générique sont remarquables) et les scénaristes parmi lesquels le mystérieux George W George et…Rowland Brown, l’auteur de QUICK MILLIONS (crédité pour les dialogues additionnels) parsèment le récit de petites trouvailles plaisantes. Le ton, plutôt décontracté, solde les rebondissements dont certains sont prévisibles. Rien de tout cela n’est très sérieux et l’ombre des comédies westerns à la Marshall plane sur le film : un shérif est davantage préoccupé par son travail de dentiste que par maintenir l’ordre, deux frères se houspillent sans avoir l’air de comprendre ce qui leur arrive. Dorothy Malone est joliment filmée dans un registre léger et plaisant et l’on passe une bonne partie du film à se demander si Randolph Scott est du côté de la loi ou dans le camp opposé. Il confère une ambiguïté souriante à son personnage, signe distinctif de ses meilleurs films. Dans le dernier tiers la minceur du propos, la rapidité du tournage diminue l’intérêt malgré quelques extérieurs rocailleux à la Boetticher et une assez bonne bagarre dans une mine qui s’effondre. Le dvd français a tenté de respecter les teintes verdâtres du Cinecolor mais fait précéder le générique d’un carton absurde : » le négatif 16/9ème ayant été détruit nous avons utilisé celui en 4 tiers ». En 1950 personne ne tournait en panoramique.
J’avais un relatif manque d’intérêt pour THE NEVADAN (l’HOMME DU NEVADA, zone 2 Sidonis) de Gordon Douglas. J’ai trouvé, heureuse surprise, la première heure bien filmée (les plans durant le générique sont remarquables) et les scénaristes parmi lesquels le mystérieux George W George et…Rowland Brown, l’auteur de QUICK MILLIONS (crédité pour les dialogues additionnels) parsèment le récit de petites trouvailles plaisantes. Le ton, plutôt décontracté, solde les rebondissements dont certains sont prévisibles. Rien de tout cela n’est très sérieux et l’ombre des comédies westerns à la Marshall plane sur le film : un shérif est davantage préoccupé par son travail de dentiste que par maintenir l’ordre, deux frères se houspillent sans avoir l’air de comprendre ce qui leur arrive. Dorothy Malone est joliment filmée dans un registre léger et plaisant et l’on passe une bonne partie du film à se demander si Randolph Scott est du côté de la loi ou dans le camp opposé. Il confère une ambiguïté souriante à son personnage, signe distinctif de ses meilleurs films. Dans le dernier tiers la minceur du propos, la rapidité du tournage diminue l’intérêt malgré quelques extérieurs rocailleux à la Boetticher et une assez bonne bagarre dans une mine qui s’effondre. Le dvd français a tenté de respecter les teintes verdâtres du Cinecolor mais fait précéder le générique d’un carton absurde : » le négatif 16/9ème ayant été détruit nous avons utilisé celui en 4 tiers ». En 1950 personne ne tournait en panoramique.
Deux autres Gordon Douglas sont disponibles en zone 1 sur le site Warner Archives : FORT DOBBS et YELLOWSTONE KELLY, tous les deux co-écrits par Burt Kennedy (avec encore Georges W George). Les dialogues de FORT DOBBS, épurés, cinglants, ramassés ne dépareraient pas les westerns de Boetticher et les rapports entre l’excellent Brian Keith et Clint Walker renvoient aux affrontement Scott Claude Akins ou Lee Marvin. Les extérieurs arides, rocailleux, très bien utilisés, font très Boetticher. Les deux premiers tiers du film sont brillants, notamment cette attaque nocturne de la ferme où Douglas ne filme pratiquement que le point de vue de Clint Walker, point de vue qu’obscurcit le cadre d’une fenêtre, un poteau ce qui dramatise les plans. La conclusion est plus classique.
 YELLOWSTONE KELLY (nom d’un personnage historique, éclaireur qui pouvait dit on, réciter Shakespeare, en écorchant un ours) est plus ample, plus majestueux et Douglas filme magnifiquement de vastes paysages plus verdoyants que ceux de Ford Dobbs. Ce qui n’empêche pas de soudaines explosions de violence : les moments où Walker brise la cervicale d’un guerrier, où Anse se fait surprendre par les Indiens en sortant de la cabane et reçoit une flèche, sont magistraux. Douglas sait filmer les surgissements des personnages, cf l’irruption d’une grande fluidité de Kelly qui débouche le long de la colonne des soldats en haut et à droite du cadre. Et les affrontements : ceux qui opposent Kelly au major pétri de certitude sont aussi remarquables : « avez vous essayé de tuer un ours avec une baguette ? », demande-t-il. Le scénario conjugue plusieurs thèmes dont chacun fait partie de l’essence du genre : l’éducation d’un pied tendre (Edward Byrnes qui fournit un excellent contrepoint à Walker, même s’il est trop gominé), les affrontements raciaux (dans chaque camp, il a des têtes brûlées), l’arrogance stupide de certains officiers blancs qui refusent d’écouter Kelly et vont faire massacrer leurs troupes parmi lesquelles Claude Akins et Warren Oates. La belle Andra Martin est censée, à grand renfort de maquillage, être une indienne (aux yeux bleus) mais Douglas traite son personnage avec respect et légèreté et elle introduit un érotisme délicat peu fréquent dans le genre qui culmine quand elle dit à Kelly : « tu m’as regardée », magnifique réplique qui se poursuit par : « tu as sauvé ma vie et je dors dans ta couverture…Tout peut arriver d’ici le printemps », fort belle et intense déclaration d’amour même si l’on peut regretter qu’Andra Martin, comme les autres Indiens, s’exprime dans un anglais impeccable.
YELLOWSTONE KELLY (nom d’un personnage historique, éclaireur qui pouvait dit on, réciter Shakespeare, en écorchant un ours) est plus ample, plus majestueux et Douglas filme magnifiquement de vastes paysages plus verdoyants que ceux de Ford Dobbs. Ce qui n’empêche pas de soudaines explosions de violence : les moments où Walker brise la cervicale d’un guerrier, où Anse se fait surprendre par les Indiens en sortant de la cabane et reçoit une flèche, sont magistraux. Douglas sait filmer les surgissements des personnages, cf l’irruption d’une grande fluidité de Kelly qui débouche le long de la colonne des soldats en haut et à droite du cadre. Et les affrontements : ceux qui opposent Kelly au major pétri de certitude sont aussi remarquables : « avez vous essayé de tuer un ours avec une baguette ? », demande-t-il. Le scénario conjugue plusieurs thèmes dont chacun fait partie de l’essence du genre : l’éducation d’un pied tendre (Edward Byrnes qui fournit un excellent contrepoint à Walker, même s’il est trop gominé), les affrontements raciaux (dans chaque camp, il a des têtes brûlées), l’arrogance stupide de certains officiers blancs qui refusent d’écouter Kelly et vont faire massacrer leurs troupes parmi lesquelles Claude Akins et Warren Oates. La belle Andra Martin est censée, à grand renfort de maquillage, être une indienne (aux yeux bleus) mais Douglas traite son personnage avec respect et légèreté et elle introduit un érotisme délicat peu fréquent dans le genre qui culmine quand elle dit à Kelly : « tu m’as regardée », magnifique réplique qui se poursuit par : « tu as sauvé ma vie et je dors dans ta couverture…Tout peut arriver d’ici le printemps », fort belle et intense déclaration d’amour même si l’on peut regretter qu’Andra Martin, comme les autres Indiens, s’exprime dans un anglais impeccable.
AUDIE MURPHY
 WALK THE PROUD LAND, est plus visible. Ce qu’il raconte est vraiment intéressant même si le scénario reste très en dessous de la réalité, que le propos est édulcoré avec une fin mielleuse. Le vrai John P Clum, après avoir capturé Geronimo avec ses policiers indiens, se vit refuser toutes ses propositions, ses réformes, par le pouvoir politique. Il démissionna et l’armée commit l’intense connerie de libérer Geronimo, prolongeant de 7 ans les guerres indiennes et provoquant des centaines de morts. Clum devint le directeur du journal de Tombstone et un grand ami de Wyatt Earp. Les scénaristes ajoutent des scènes doucereuses avec des enfants au lieu d’aborder le coeur du sujet. Mais il y a de beaux extérieurs. Mieux filmés que dans les productions Universal analogues. Audie Murphy est crédible et Anne Bancroft, très belle, parvient à se faire sinon accepter du moins admirer comme Indienne surtout face à la désastreuse Pat Crowley.
WALK THE PROUD LAND, est plus visible. Ce qu’il raconte est vraiment intéressant même si le scénario reste très en dessous de la réalité, que le propos est édulcoré avec une fin mielleuse. Le vrai John P Clum, après avoir capturé Geronimo avec ses policiers indiens, se vit refuser toutes ses propositions, ses réformes, par le pouvoir politique. Il démissionna et l’armée commit l’intense connerie de libérer Geronimo, prolongeant de 7 ans les guerres indiennes et provoquant des centaines de morts. Clum devint le directeur du journal de Tombstone et un grand ami de Wyatt Earp. Les scénaristes ajoutent des scènes doucereuses avec des enfants au lieu d’aborder le coeur du sujet. Mais il y a de beaux extérieurs. Mieux filmés que dans les productions Universal analogues. Audie Murphy est crédible et Anne Bancroft, très belle, parvient à se faire sinon accepter du moins admirer comme Indienne surtout face à la désastreuse Pat Crowley.
Mieux vaut oublier COLUMN SOUTH (L’HEROIQUE LIEUTENANT) de Fréderic de Cordoba : plat, mal écrit, mal joué, mal filmé.
A BULLET FOR A BADMAN de RG Springsteen est plombé par un début catastrophique : extérieurs nuls, cadrages ternes, toujours à plat (la photo, médiocre, est pourtant de Joseph Biroc), décors ultra conventionnels et peu imaginatifs. Mais soudain, apparaissent plusieurs actrices bizarres et assez sexy, pas très bonnes, fort improbables dans un western mais dont la présence pimente le récit sans qu’on sache s’il lorgne vers un ton semi parodique ou non. Les rebondissements s’accumulent, les extérieurs deviennent plus intéressants et si les séquences nocturnes restent toujours aussi plates, Springsteen réussit quelques cadrages plus dynamiques. Dans cette variation de série sur l’APPAT de Mann, tous les personnages de la patrouille qui poursuivent Darren McGavin, rivalisent de cynisme. Il faudra un jour que j’arrive à trouver ce mélodrame de Springsteen, COME NEXT SPRING sur lequel délire Philippe Garnier.
 LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE (THE GUNS OF FORT PETTITCOAT) est un George Marshall amusant, pas mal filmé, une plaisante surprise quand on pense à la pléiade d’œuvres routinières exécutées par le cinéaste à cette époque. La mise en scène, souvent astucieuse, utilise bien le décor, incorpore quelques jolis extérieurs. Plusieurs scènes sont bien écrites et même si la photo reste conventionnelle, trop éclairée. Ce film prend sa place parmi les meilleurs AUDIE MURPHY avec son trio de hors la loi assez violents pour l’époque. Voilà la seconde surprise que m’a donné Marshall après les PILLIERS DU CIEL, même s’il lui manque toujours ce je ne sais quoi qui transformerait une séquence agréable en une vraie réussite. Marshall reste toujours à la surface, tente souvent de s’en sortir par un gag plus ou moins nécessaire. Il aime tant la comédie qu’il la prive de sérieux. Le résultat, plus qu’agréable plane au dessus de RIDE CLEAR OF DIABLO (CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE) d’où j’ai surtout envie de retenir le toujours remarquable Dan Dureya
LE FORT DE LA DERNIERE CHANCE (THE GUNS OF FORT PETTITCOAT) est un George Marshall amusant, pas mal filmé, une plaisante surprise quand on pense à la pléiade d’œuvres routinières exécutées par le cinéaste à cette époque. La mise en scène, souvent astucieuse, utilise bien le décor, incorpore quelques jolis extérieurs. Plusieurs scènes sont bien écrites et même si la photo reste conventionnelle, trop éclairée. Ce film prend sa place parmi les meilleurs AUDIE MURPHY avec son trio de hors la loi assez violents pour l’époque. Voilà la seconde surprise que m’a donné Marshall après les PILLIERS DU CIEL, même s’il lui manque toujours ce je ne sais quoi qui transformerait une séquence agréable en une vraie réussite. Marshall reste toujours à la surface, tente souvent de s’en sortir par un gag plus ou moins nécessaire. Il aime tant la comédie qu’il la prive de sérieux. Le résultat, plus qu’agréable plane au dessus de RIDE CLEAR OF DIABLO (CHEVAUCHÉE AVEC LE DIABLE) d’où j’ai surtout envie de retenir le toujours remarquable Dan Dureya
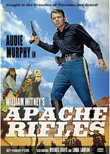 APACHE RIFLES de William Whitney : sur un sujet des plus traditionnels pas trop mal écrit par Charles Smith (un officier raciste découvre le bien fondé de ce que réclament les Indiens mais se fait écarter par ses supérieurs jusqu’à l’affrontement final qui lui donne raison) on ne peut que louer la recherche dont témoignent certains cadres (camera très basse, entrée de champ brutale), des mouvements d’appareil qui dynamisent l’action, un découpage précis et efficace, le choix et l’importance des extérieurs : Whitney incorpore même la caverne et le canyon où Wayne rejoint Nathalie Wood dans The SEARCHERS. Audie Murphy est très crédible même si son retournement est survolé plutôt que traité. Michael Dante essaie d’être crédible en Indien mais la surprise de Linda Lawson qui est belle, juste et donne une vraie fierté à son personnage d’institutrice à demi indienne.
APACHE RIFLES de William Whitney : sur un sujet des plus traditionnels pas trop mal écrit par Charles Smith (un officier raciste découvre le bien fondé de ce que réclament les Indiens mais se fait écarter par ses supérieurs jusqu’à l’affrontement final qui lui donne raison) on ne peut que louer la recherche dont témoignent certains cadres (camera très basse, entrée de champ brutale), des mouvements d’appareil qui dynamisent l’action, un découpage précis et efficace, le choix et l’importance des extérieurs : Whitney incorpore même la caverne et le canyon où Wayne rejoint Nathalie Wood dans The SEARCHERS. Audie Murphy est très crédible même si son retournement est survolé plutôt que traité. Michael Dante essaie d’être crédible en Indien mais la surprise de Linda Lawson qui est belle, juste et donne une vraie fierté à son personnage d’institutrice à demi indienne.
LANG, KING, PARRISH
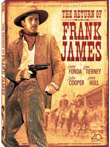 THE RETURN OF FRANK JAMES est en revanche vraiment terne et quasi anonyme. On peut trouver un charme à la photo de George Barnes, aux couleurs, aux robes pastel de Gene Tierney, mais le film est insipide, avec des stéréotypes raciaux (le personnage de Pinky très Jim Crow), des clichés et un discours gênants même pour l’époque : la morale farouchement sudiste de Henry Hull, qui prône l’assassinat de ses adversaires, est assez désagréable compte tenu du contexte de l’époque et de la nationalité du réalisateur. Surnagent quelques plans nocturnes, de très beaux extérieurs dans la Sierra Nevada, gâchés par des raccords en studio où Fonda fait semblant de faire du cheval. Je n’aime pas beaucoup les westerns de Lang et reste perplexe quand il déclare dans ses interviews qu’il était un fanatique du genre et qu’il a fait de nombreuses recherches. Ce film tout comme WESTERN UNION a l’air aussi authentique dans ses décors, costumes, sa figuration, ses dialogues que les bandes de séries avec William Boyd ou Ray Corrigan.
THE RETURN OF FRANK JAMES est en revanche vraiment terne et quasi anonyme. On peut trouver un charme à la photo de George Barnes, aux couleurs, aux robes pastel de Gene Tierney, mais le film est insipide, avec des stéréotypes raciaux (le personnage de Pinky très Jim Crow), des clichés et un discours gênants même pour l’époque : la morale farouchement sudiste de Henry Hull, qui prône l’assassinat de ses adversaires, est assez désagréable compte tenu du contexte de l’époque et de la nationalité du réalisateur. Surnagent quelques plans nocturnes, de très beaux extérieurs dans la Sierra Nevada, gâchés par des raccords en studio où Fonda fait semblant de faire du cheval. Je n’aime pas beaucoup les westerns de Lang et reste perplexe quand il déclare dans ses interviews qu’il était un fanatique du genre et qu’il a fait de nombreuses recherches. Ce film tout comme WESTERN UNION a l’air aussi authentique dans ses décors, costumes, sa figuration, ses dialogues que les bandes de séries avec William Boyd ou Ray Corrigan.
 THE GUNFIGHTER (LA CIBLE HUMAINE : film magnifique, ample, lyrique. On devrait ajouter quelques lignes pour louer l’excellent scénario de William Bowers et William Sellers d’après un script original de Bowers et de Toth. Ce dernier voulait faire le film. Il avait eu l’idée du sujet, inspiré par ce qui arrivait à Flynn, Bogart, Joe Louis dans les bars quand il les accompagnait. Il y avait toujours un jeune type qui les provoquait. De Toth voulait Gary Cooper (choix splendide) et tourner le film en couleurs désaturées, proches du sépia. Ce qui fit très peur à Zanuck tenant d’un Technicolor plus que flamboyant dont témoignent ses comédies musicales. Et Cooper n’était pas sous contrat. Il proposa Peck et de Toth pensait que Peck était trop civilisé. C’est partiellement vrai et la moustache rattrape un peu mais Peck est très bon dans le film, s’entendant très bien avec King. Ce dernier imposa sa patte dans le scénario, développant le rôle des enfants qui deviennent l’un des trois choeurs antiques qui commentent, étoffent, ouvrent le film. On les entend autant qu’on les voit et ils remplacent tout commentaire musical. Le seul moment musical, très fort, très bien écrit, presque Hermannien, se situe pendant le générique.
THE GUNFIGHTER (LA CIBLE HUMAINE : film magnifique, ample, lyrique. On devrait ajouter quelques lignes pour louer l’excellent scénario de William Bowers et William Sellers d’après un script original de Bowers et de Toth. Ce dernier voulait faire le film. Il avait eu l’idée du sujet, inspiré par ce qui arrivait à Flynn, Bogart, Joe Louis dans les bars quand il les accompagnait. Il y avait toujours un jeune type qui les provoquait. De Toth voulait Gary Cooper (choix splendide) et tourner le film en couleurs désaturées, proches du sépia. Ce qui fit très peur à Zanuck tenant d’un Technicolor plus que flamboyant dont témoignent ses comédies musicales. Et Cooper n’était pas sous contrat. Il proposa Peck et de Toth pensait que Peck était trop civilisé. C’est partiellement vrai et la moustache rattrape un peu mais Peck est très bon dans le film, s’entendant très bien avec King. Ce dernier imposa sa patte dans le scénario, développant le rôle des enfants qui deviennent l’un des trois choeurs antiques qui commentent, étoffent, ouvrent le film. On les entend autant qu’on les voit et ils remplacent tout commentaire musical. Le seul moment musical, très fort, très bien écrit, presque Hermannien, se situe pendant le générique.
Dans ce scénario très bien dialogué, je retiens une scène très originale : Peck discute avec son ami Millard Michel, devenu marsala. Ils abordent un sujet grave – le fait que l’homme de loi veut faire partir le pistolero – et sont interrompus par un homme qui se confond en excuses et regrette de faire irruption dans cette conversation. Il leur annonce qu’un type est en train de brûler sa maison : – » Vous avez essayé de l’arrêter » – » Oui mais il m’a pas écouté » – » Il est ivre ? » – » Sa conduite ne témoigne pas d’une vraie sobriété ». Toute cette scène jusqu’au départ de Mitchell est filmée en un seul plan général, sans raccords et King s’arrange pour que les acteurs soldent la scène, lui retirent tout pittoresque, la rendent aussi quotidienne que possible. Et cela évite un long affrontement moral entre les deux protagonistes.
 J’ai adoré revoir SADDLE THE WIND malgré quelques transparences gênantes et certains raccords en studio. Tous les seconds rôles sont superbement écrits, joués, distribués (Jay Adler en barman, Royal Dano en squatter sur de son droit, Charles McGraw en tueur sont formidables) et le film, sans en avoir l’air, subvertit, remet en cause beaucoup des archétypes du genre : le cattle baron joué par Donald Crisp est pacifiste et préfère renoncer à ses chères clôtures que de tuer pour les protéger. Pour Parrish et Serling les conséquences d’une action sont aussi importantes sinon plus que cette action elle-même. Position morale rare dans le cinéma américain. Ce que les auteurs remettent en cause, c’est moins la violence de Cassavetes que son amour de la violence, que l’aura, le prestige que lui donne aux yeux de quelques uns, cette violence. Les morts, toutes impressionnantes, prennent une importance démesurée : Dano , Mc Graw mettent un temps long à mourir.
J’ai adoré revoir SADDLE THE WIND malgré quelques transparences gênantes et certains raccords en studio. Tous les seconds rôles sont superbement écrits, joués, distribués (Jay Adler en barman, Royal Dano en squatter sur de son droit, Charles McGraw en tueur sont formidables) et le film, sans en avoir l’air, subvertit, remet en cause beaucoup des archétypes du genre : le cattle baron joué par Donald Crisp est pacifiste et préfère renoncer à ses chères clôtures que de tuer pour les protéger. Pour Parrish et Serling les conséquences d’une action sont aussi importantes sinon plus que cette action elle-même. Position morale rare dans le cinéma américain. Ce que les auteurs remettent en cause, c’est moins la violence de Cassavetes que son amour de la violence, que l’aura, le prestige que lui donne aux yeux de quelques uns, cette violence. Les morts, toutes impressionnantes, prennent une importance démesurée : Dano , Mc Graw mettent un temps long à mourir.
Pour une fois, on donne à un Nordiste (Dano) un discours très digne alors que les confédérés sont montrés comme des assassins sans honneur, ivres d’alcool et de brutalité immature et stupide. L’affrontement archétypal entre les deux frères possède un vrai tragique et se conclut, fait exceptionnel, par un suicide. Tout est ainsi décalé, détourné, petit à petit, sans qu’on s’en rende compte, de même qu’on mettait du temps à réaliser que les soldats qu’on avait sous les yeux appartenaient à un régiment noir dans l’AVENTURIER DU RIO GRANDE, tant le traitement était subtil et peu souligné. Même le personnage de Julie London témoigne d’une absence de calculs, d’une franchise exempte de tout puritanisme sur ce que fut sa vie. Parmi de magnifiques extérieurs, Parrish inclut une des villes de western les plus plausibles ces maisons de guingois, ces porches déglingués, les plus intéressantes, qui rivalise avec celle de LA CHEVAUCHÉE DES BANIS, de WILL PENNY.
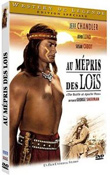 Je rappelle rapidement AU MEPRIS DES LOIS, excellent western de George Sherman qui me fit reconsidérer ce réalisateur. On sent sa présence tout au long de ce film, dans une façon de placer à contre-jour un dialogue conventionnel, de filmer en un plan un raid indien, d’utiliser les paysages ou le décor d’un fort dont chaque mur est différent. Le film, sorte de prélude à la FLECHE BRISÉE, prend ses libertés avec l’Histoire et mélange deux batailles, éloignées de deux ans mais pose un regard chaleureux sur les Indiens, regard qui fait tout le prix de TOMAHAWK, autre western pro indien, qui sort prochainement en attendant d’autres Sherman comme, REPRISAL au contenu anti raciste très affirmé, DUEL DANS LA SIERRA que j’avais aimés et SLEEPING CITY, SPY HUNT, SWORD IN THE DESERT, TARGET UNKNOWN découverts grâce à Dave Kehr, grand avocat de Sherman.
Je rappelle rapidement AU MEPRIS DES LOIS, excellent western de George Sherman qui me fit reconsidérer ce réalisateur. On sent sa présence tout au long de ce film, dans une façon de placer à contre-jour un dialogue conventionnel, de filmer en un plan un raid indien, d’utiliser les paysages ou le décor d’un fort dont chaque mur est différent. Le film, sorte de prélude à la FLECHE BRISÉE, prend ses libertés avec l’Histoire et mélange deux batailles, éloignées de deux ans mais pose un regard chaleureux sur les Indiens, regard qui fait tout le prix de TOMAHAWK, autre western pro indien, qui sort prochainement en attendant d’autres Sherman comme, REPRISAL au contenu anti raciste très affirmé, DUEL DANS LA SIERRA que j’avais aimés et SLEEPING CITY, SPY HUNT, SWORD IN THE DESERT, TARGET UNKNOWN découverts grâce à Dave Kehr, grand avocat de Sherman.
AU PAYS DE LA PEUR d’Andrew Marton m’a paru fort terne, sauf peut être dans son dernier tiers avec cette attaque de loups. Marton esquive ce qui aurait pu donner du poids aux rapports entre Stewart Granger, terne, et Wendell Corey, bien meilleur. Cyd Charisse est totalement gâchée dans un improbable rôle d’Indienne. Cela dit le scénario de Frank Fenton ne compte pas parmi ses meilleurs.
 NEW MEXICO (Bach films) est le premier western de Peckimpah et l’on peu s’interroger sur le choix du titre français qui est très vite démenti par un carton du générique remerciant les autorités de l’Arizona d’avoir permis le tournage. On sent poindre dans quelques touches sarcastiques, drolatiques, la personnalité de Peckimpah (le bar qu’on ferme pour permettre au pasteur d’officier dans le même local), le personnage de Brian Keith mais j’ai été frappé par la maladresse des scènes d’action, de violence. Je crois me souvenir qu’il n’avait pas monté le film. C’est Maureen O’hara (qui dézingue Peckimpah dans ses mémoires) qui chante la chanson du générique. Fort bien.
NEW MEXICO (Bach films) est le premier western de Peckimpah et l’on peu s’interroger sur le choix du titre français qui est très vite démenti par un carton du générique remerciant les autorités de l’Arizona d’avoir permis le tournage. On sent poindre dans quelques touches sarcastiques, drolatiques, la personnalité de Peckimpah (le bar qu’on ferme pour permettre au pasteur d’officier dans le même local), le personnage de Brian Keith mais j’ai été frappé par la maladresse des scènes d’action, de violence. Je crois me souvenir qu’il n’avait pas monté le film. C’est Maureen O’hara (qui dézingue Peckimpah dans ses mémoires) qui chante la chanson du générique. Fort bien.
Continuez votre lecture avec
- Article suivant : Raretés
- Article précédent : Livres, classiques français, italiens et anglais…
Articles similaires
Commentaires (243)
Laisser un commentaire
(Seuls les messages ayant attrait aux DVD - thème de ce blog - seront publiés.)


Avez-vous un avis sur THE WAY TO THE STARS de Asquith? Le dvd me fait de l’oeil à un prix ridicule. Jean Tulard (de l’Institut) dit que c’est démodé ça doit être bien!
A Martin Brady
J’avais été décu
ah, dommage, merci!
Great article. I will be dealing with many of these issues as well..
J’ai été fort déçu par THE BATTLE OF APACHE PASS. Je l’ai trouvé lourd, plat (les acteurs, même Chandler, sont raides au point qu’on a parfois l’impression qu’ils n’ont pas entendus « action »), à la limite de la caricature (très manichéen, Jack Elam joue pour la Xe fois une immonde crapule, dialogues consternants, amorce d’une histoire d’amour entre John Lund et Berverly Tyler sans queue ni tête) et prévisible en raison de la volonté d’être proche de la vérité historique (on sait ainsi « à l’avance » que ni Cochise ni Geronimo ne mourront dans leur duel final et que les tuniques bleues ne tueront pas Geronimo alors qu’ils en ont la possibilité). De Sherman, j’ai nettement préféré THE LAST OF THE FAST GUNS (qui sera toujours un de mes westerns favoris), BORDER RIVER et même BLACK BART, CALAMITY JANE AND SAM BASS et COMANCHE TERRITORY. Je trouve que les faiblesses de ces derniers films relèvent plus de la distribution que du scénario (tant pis parfois pour la vérité historique)ou de la mise en scène.
A Edward
Pas d’accord. Je préfère ce film à BORDER RIVER et je vois plein d’idées de mise en scène pour pallier à la faiblesse de certains interprètes (en les filmant à contre jour, ou en contre plongée), dynamiser une scène d’action : le raid des Indiens filmé en 1 plan séquence, donner de l’intéret à un décor (ce fort dont les 4 murs sont de matières différentes). Elam a pratiquement toujours joué les immondes crapules et Chandler n’est pas raide. Il aimait bien Sherman avec qui il avait fait SWORD IN THE DESERT. Je vous trouve injuste
Je ne remets certainement pas en cause l’ingéniosité (notamment à compenser les faiblesses d’un scénario ou de la distribution) de Sherman ni sa capacité à filmer l’Ouest. Je l’apprécie même quand certains peuvent parfois trouver son travail routinier (au vu du nombre de films qu’il faisait par an, c’était sans doute inévitable). Je pense que notre seul point de désaccord en fin de compte porte sur le jeu de Chandler que je persiste à trouver raide dans ce film (voire même dans WAR ARROW). Je l’ai beaucoup plus apprécié dans MERRIL’S MARAUDERS (où je ne lui vois pas de raideur militaire). J’admets aussi connaître très mal sa filmographie de telle sorte que je n’étends certainement pas mon jugement sur quelques films – a fortiori s’il est comme vous le pensez erroné – à l’ensemble de sa carrière. Pour en revenir à THE BATTLE OF APACHE PASS, je me demande si ma déception ne vient pas de ce que le film est relativement court (au point même parfois de me donner l’impression qu’il a été coupé), de ce que le personnage de Bruce Cowling (Baylor) aurait pu être plus développé – un peu à la manière dont Sherman avait traité les mauvais dans COMANCHE TERRITORY – bref de ce que la dramaturgie aurait pu être plus développée (sans vouloir que Sherman fasse du Sirk). Le film est plutôt sec, s’en tenant essentiellement à l’action. Peut-être aussi était-ce ce qui était demandé en l’espèce à Sherman ?
A propos de Jack Elam, je viens de voir SUPPORT YOUR LOCAL SHERIFF dans lequel il me paraît avoir le rôle le plus dialogué de sa carrière et démontrer qu’il aurait mérité des rôles plus consistants que ceux qui lui furent attribués la plupart du temps
Pour continuer sur Jack Elam, il est curieux qu’il ait été si souvent cantoné à des rôles peu dialogués quand on voit la consistance avec laquelle il a joué dès RAWHIDE
M.Tavernier, j’ai confondu « Manhunt » avec « From hell to Texas », je vous prie de m’en excuser. J’en profite pour vous signaler deux coquilles dans « 50 ans de cinéma américain » que vous avez sûrement déjà constatées, depuis 1995 : elles figurent page 529 et 530, dans le texte consacré à Henri Hathaway. Page 529, à propos de « Souls at sea » : un petit garçon provoque l’incendie. Eh non, c’est une petite fille. Page 530, à propos de « Garden of evil » : Pedro Armendariz meurt en insultant d’invisibles indiens… Eh bien non, l’acteur en question est Victor Manuel Mendoza. Mais ne vous méprenez pas, M. Tavernier, votre livre est une vraie bible pour moi et c’est bien pour cette raison que je vous parle de ces coquilles.
A propos de « Boss nigger » (tout juste édité chez Sidonis) vous disiez n’avoir pas vu dans « 50 ans de cinéma américain » je dois dire vous et M. Coursodon n’aviez pas manqué grand-chose. Le film croule sous les références, en particulier « L’homme des hautes plaines » de Clint Eastwood, la musique est épouvantable et totalement déplacée, incongrue, le scénario bourré d’invraisemblances, d’incohérences, les rares décors naturels sont mal filmés, franchement, à part la prestation irréprochable de R.G. Armstrong (admirable dans « Manhunt » d’Henry Hathaway) je ne vois pas ce l’on peut sauver dans ce film, apparemment très mal monté, en plus. Le film le plus violent que j’ai vu de Jack Arnold mais vraiment pas le meilleur.
Je viens de visionner « La belle aventurière » que j’ai adoré, surtout pour l’humour qui s’en dégage et Yvonne De Carlo qui éclipse tous ses partenaires. Mais, M. Tavernier, dans votre présentation vous semblez curieusement manquer de mémoire, comme si vous ne l’aviez pas vu depuis longtemps. Ainsi, vous citez une réplique de Charles Coburn : « S’attendre au meilleur, espérer le pire et être prêt à accepter n’importe quoi ». En réalité, la réplique en question est « Espérer le meilleur, s’attendre au pire et se contenter du juste milieu ». Juste après vous citez une autre réplique d,Yvonne De Carlo, « You own the country », I own the ambition ». Pas de chance, c’est John Russel qui prononce cette phrase, mais totalement inversée : « You own the ambition, I own the country ». D’autre part, vous parlez de deux frères alors que ce sont deux cousins et déclarez que la fin du film ne contient aucun morceau de bravoure. C’est oublier la formidable bagarre entre les deux cousins, justement vers la fin du film. Tout cela pèse peu à côté de l’admiration que je vous voue. Au fait, y aura-t-il un « 60 ans de cinéma américain » ?
A Dominique, désolé, j’ai essayé de noter les répliques durant une projection et me suis trompé. Quant aux frères, j’ai pris cela dans un résumé du film. De toutes façons, j’en ai vu six ou sept tous différents
Pas de soucis, M. Tavernier, vos présentations pour SIDONIS sont toujours passionnantes. Je dirais même plus que Patrick Brion qui est plus un historien qu’un analyste. Je dois dire que j’ai pratiquement toute la collection des westerns de légende – cette appellation m’a souvent laissé songeur – et je comprends pourquoi vous renoncez à présenter certains films.
Je m’intercale ( en vous demandant pardon si besoin ) . Je possède personnellement 772 DVD westerns . C’est vous dire Si je suis intéressé ! Mais Surtout aujourd’hui , j’apprécie tout particulièrement les romans récemment du genre édités par Bertrand Tavernier . J’aimerais beaucoup en parler avec lui si le temps le lui permet , car je crois , sans forfanterie ,posséder tous les romans western parus en langue française .
Je viens de revoir « Hannie Caulder » (Un colt pour 3 salopards) de Burt Kennedy, réalisateur qui m’inspire moyennement et pour lequel j’ai peu d’affinités mais je dois avouer que je l’ai préféré à ma première vision.
J’aime bien le rôle de Robert Culp, chasseur de primes qui finit – sans l’avouer – par tomber amoureux de Raquel Welch (on le serait à moins).
Mais ce film est très marqué « spaghetti » (trognes patibulaires dont l’immense Jack Elam, décors espagnols, violence et casting international mélant acteurs US et anglais : Christopher Lee et Stephen Boyd – non crédité et muet -ou plutôt sans dialogues !!)
To Martin-Brady, A little research on amazon reveals that Mr. Kennedy was faithful to Mr. Doctorow’s conclusion. So it would appear that both book and film are a kind of anti-STRAW DOGS. Where in Peckinpah’s film, Hoffman’s initial passivity helps to precipitate the final bloodbath, Messrs K and D are telling us that resistance is futile. Stay out of Aldo’s way and he just might get bored or run out of bullets before he gets round to perforating you. Maybe. But stand up to him and you’re REALLY for the chop. There must be some middle ground between « I AM THE NRA! » and « You’ll take it and like it. » Best, Michael
To Monsieur Martin-Brady, My reservations about …HARD TIMES really begin with Aldo Ray’s return, continue with the ridiculous (well, to me) poetic justice accidental way one of the major characters (mustn’t give anything away)is dispatched a few minutes from the end of the film, and become overwhelming with that dawn of a new day conclusion that seems to be contrived to prevent the audience from collectively cutting themselves a slice of throat upon leaving the theatre. I’m with your high opinion of the opening and the initial supernaturally evil (i.e. Hammer, wish I’d thought of that) appearance of Mr. Ray. Maybe I need to see …HARD TIMES again. I mean, I could be wrong. Best, Michael I wonder if that aforementioned dawn of etc can be found in E L Doctorow’s original novel. I’ve read that Doctorow was not well pleased with the film.
To Michael Rawls: Oui, vous avez raison encore, la fin est extrêmement faible, j’ai une forte capacité à occulter les parties faibles d’un film, le début m’avait frappé surtout pour son absence de parole (le début de Rio Bravo est terriblement excitant pour ça), Fonda apparaît un peu comme un grand benêt (a goofy kind of a hero?), je suis sentimentalement attaché à tous ces « supporting actors » qui nous régalent, peut-être par nostalgie, excusez du peu: Warren Oates, Elisha Cook, Keenan Wynn, Edgar Buchanan, Royal Dano, Paul Fix, Lon Chaney Jr STOP! Et Janice en cerise sur le gâteau! Le début semble partir dans le fantastique, ce qui est « kinky » pour un western (la même ambiance fantastique baigne les 4/5èmes d’un grand western des mêmes années, The Shooting de Hellman), mais c’est vrai que mon excitation adolescente avait faibli avec le retour de A1do, l’un des acteurs les plus attachants des 50-60… Je me demande comment les 60 finissants n’ont pas autorisé Kennedy à finir dans le noir, et comment Doctorow avait-il « tourné » ça? Ce Doctorow a donné pas mal de romans au cinéma, je devrais les lire pour les comparer aux films…
Au fait, c’est justement dans Fort Apache qu’on trouve le premier bad-guy fondaien avant Firecreek, et 20 ans avant? Bonne journée et bravo pour votre compréhension du français, l’anglais c’est plus facile comme langue…
To Monsieur Martin-Brady, But ONCE UPON A TIME IN THE WEST does not mark Henry Fonda’s first appearance as a bad guy. That was in FIRECREEK, opposite mild mannered Sheriff James Stewart, who takes a bit too long to stand up to outlaw Fonda (as good guy Fonda had tried to avoid confronting embodiment of evil Aldo Ray in Fonda’s previous film WELCOME TO HARD TIMES). FIRECREEK is written by TV western veteran Calvin Clements (GUNSMOKE, WAGON TRAIN, THE RIFLEMAN, this last series created by Sam Peckinpah). I prefer FIRECREEK to … HARD TIMES, finding the latter ludicrously downbeat and capped with a laughable last minute hope for the future scene (« Yep! This here town’s growin’! »). But, of course, Fonda was even better in ONCE… and was in fact hired by Leone just for that reputed excess of integrity , so that when the audience witnessed his effectively ordering the shooting of that little boy they would exclaim « Jesus Christ! It’s Henry Fonda! »
To Mr Rawls: You MUST be right! Jamais vu Firecreek… Notez que le début de Hard Times est hors du commun (first rate?) avec les invraisemblables apparitions de Aldo Ray qui semblent sorties d’un Hammer des années 50-60, amicalement…