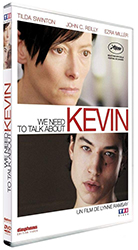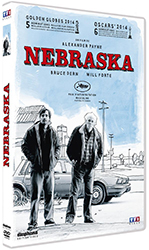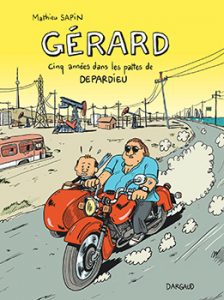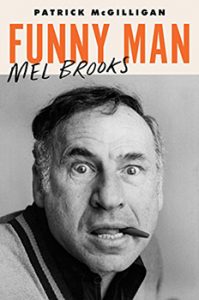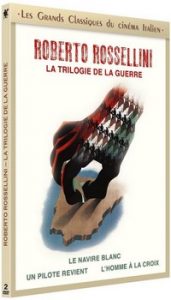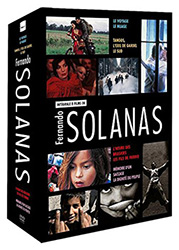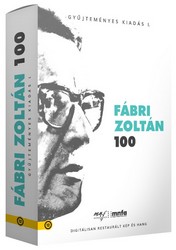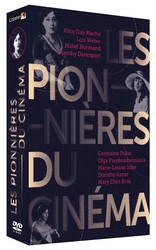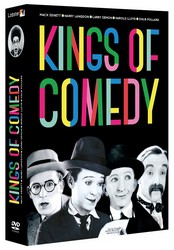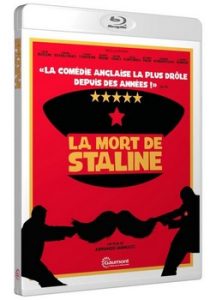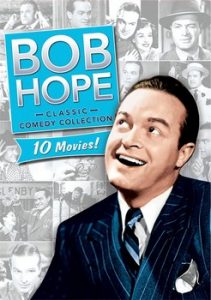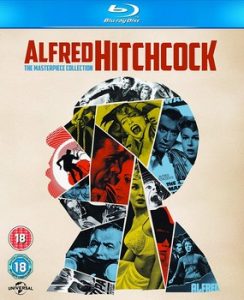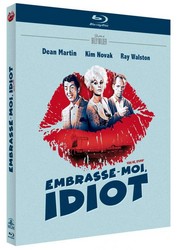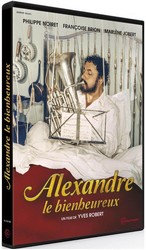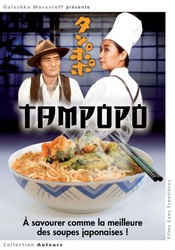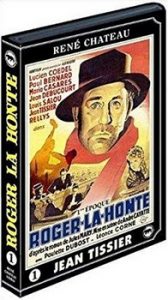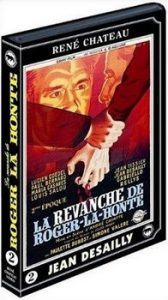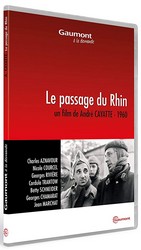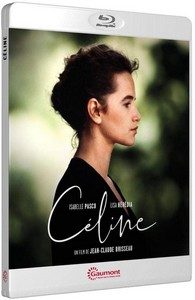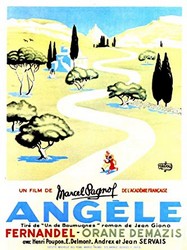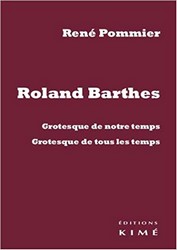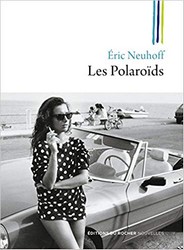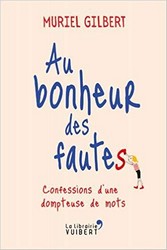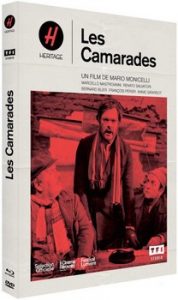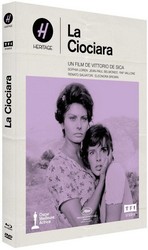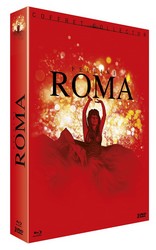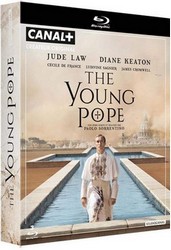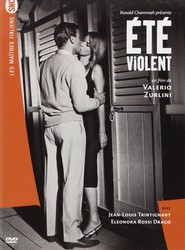CINÉMA MUET
 On parle trop rarement ici du cinéma muet même si récemment plusieurs contributeurs ont évoqué la figure de Lon Chaney. Notons quand même que quand on tape Lon Chaney sur le site de la Fnac, on obtient en premier LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS. Et un peu plus loin FORT INVINCIBLE… C’est dire le soin avec lequel est tenu le site. Chaney, inoubliable dans dans VICTORY de Maurice Tourneur (une belle édition de ce film chez Lobster en compagnie du DERNIER DES MOHICANS qu’il faut revoir – l’affrontement final sur un éperon rocheux reste inégalé dans sa splendeur visuelle), dans le FANTÔME DE L’OPÉRA, NOTRE DAME DE PARIS et surtout dans l’extraordinaire L’INCONNU de Tod Browning.
On parle trop rarement ici du cinéma muet même si récemment plusieurs contributeurs ont évoqué la figure de Lon Chaney. Notons quand même que quand on tape Lon Chaney sur le site de la Fnac, on obtient en premier LE TRAIN SIFFLERA TROIS FOIS. Et un peu plus loin FORT INVINCIBLE… C’est dire le soin avec lequel est tenu le site. Chaney, inoubliable dans dans VICTORY de Maurice Tourneur (une belle édition de ce film chez Lobster en compagnie du DERNIER DES MOHICANS qu’il faut revoir – l’affrontement final sur un éperon rocheux reste inégalé dans sa splendeur visuelle), dans le FANTÔME DE L’OPÉRA, NOTRE DAME DE PARIS et surtout dans l’extraordinaire L’INCONNU de Tod Browning.
L’HOMME QUI RIT de Paul Leni (Combo Blu-ray/DVD chez Elephant Film) : Paul Leni respecte le foisonnement baroque du livre, son aspect onirique (les décors sont une réussite absolue), retranscrit visuellement les affrontement antinomiques (« l’homme qui rit est une cariatide du monde qui pleure »), retrouve le côté initiatique du récit même s’il fait l’impasse sur les digressions, souvent géniales qui composaient une durée romanesque faite d’accélération, de ralentissements et même d’une certaine stagnation et d’une multitude de chemins où il paraît possible de se perdre comme on se perd dans une rêverie sans fond » (Jean Gaudon). Le moment où le jeune Gwymplaine, errant dans une forêt de pendus, en pleine tempête, rencontre Dea, est un triomphe expressionniste. Léni et son scénariste refusent la fin hugolienne (le suicide de Gwymplaine découvrant sa fiancée morte) qui aurait paru trop volontariste au profit d’un happy end.
HENRY KING
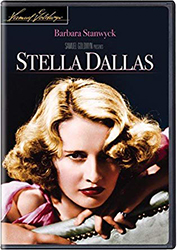 J’ai découvert le sublime STELLA DALLAS de Henry King qui constitue le bonus de la version du King Vidor (DVD MGM Zone 1), un bonus intitulé featurette. Or, on a le droit à l’intégralité du film, première adaptation du best-seller d’Olive Higgins Pouty et sans doute la meilleure des trois. Stella, une jeune femme honteusement exploitée par son père (des plans fulgurants le montrent incapable de se lever pour se verser du café), épouse, pour s’en sortir, un homme d’affaires, Stephen Dallas. Le mariage est un échec et après le départ de son mari pour New York, elle doit élever seule sa fille, Laurel. STELLA DALLAS contient un certain nombre de thèmes, de motifs chers à King qu’il conjuguera tout au long de sa carrière : l’amour maternel jusque dans ses égarements, ses excès (King dit s’être souvent inspirée de sa mère, personnage central dans sa vie, dès TOL’ABLE DAVID), le sacrifice qui permet de mesurer l’amour dans un couple – mère/fille, homme/femme (la plus parfaite illustration en étant The Gift of the Magi dans O. HENRY’S FULL HOUSE) -, la dictature de l’étroitesse d’esprit et des préjugés, représentée ici admirablement par la directrice de l’école, Mrs Philiburn qui regarde avec méfiance cette épouse sans mari. Géniale, il n’y a pas d’autres termes, interprétation de Belle Bennet qui surclasse même celle de Stanwyck, traduit dans un même mouvement la bonne volonté, l’amour du personnage, sa myopie intellectuelle, sa vulgarité. Elle nous bouleverse et nous embarrasse. Très beau scénario de Frances Marion.
J’ai découvert le sublime STELLA DALLAS de Henry King qui constitue le bonus de la version du King Vidor (DVD MGM Zone 1), un bonus intitulé featurette. Or, on a le droit à l’intégralité du film, première adaptation du best-seller d’Olive Higgins Pouty et sans doute la meilleure des trois. Stella, une jeune femme honteusement exploitée par son père (des plans fulgurants le montrent incapable de se lever pour se verser du café), épouse, pour s’en sortir, un homme d’affaires, Stephen Dallas. Le mariage est un échec et après le départ de son mari pour New York, elle doit élever seule sa fille, Laurel. STELLA DALLAS contient un certain nombre de thèmes, de motifs chers à King qu’il conjuguera tout au long de sa carrière : l’amour maternel jusque dans ses égarements, ses excès (King dit s’être souvent inspirée de sa mère, personnage central dans sa vie, dès TOL’ABLE DAVID), le sacrifice qui permet de mesurer l’amour dans un couple – mère/fille, homme/femme (la plus parfaite illustration en étant The Gift of the Magi dans O. HENRY’S FULL HOUSE) -, la dictature de l’étroitesse d’esprit et des préjugés, représentée ici admirablement par la directrice de l’école, Mrs Philiburn qui regarde avec méfiance cette épouse sans mari. Géniale, il n’y a pas d’autres termes, interprétation de Belle Bennet qui surclasse même celle de Stanwyck, traduit dans un même mouvement la bonne volonté, l’amour du personnage, sa myopie intellectuelle, sa vulgarité. Elle nous bouleverse et nous embarrasse. Très beau scénario de Frances Marion.
 Je me suis immédiatement rué sur TOL’ABLE DAVID (DVD Zone 1 Flicker Alley). King, roi de l’ “Americana” bien avant que le terme soit inventé, donne un bel exemple du genre avec ce film au titre étrange (c’est la mère du jeune David qui déclare qu’il est “tol’able”, peut-être une contraction de “tolérable”; le titre français, DAVID L’ENDURANT est totalement absurde). Le film écrit par Edmund Goulding et King, d’après une nouvelle dont l’action se passe en Virginie, était la première production de la compagnie “Inspiration Pictures” cofondée par King et l’acteur Richard Barthelmess avec le producteur Charles Duell. King insista pour tourner le film en Virginie, dont il était originaire; après avoir envoyé son assistant en repérages avec ses instructions, il arriva sur place et trouva, dit-il, tous ses extérieurs en une journée et “dans un rayon de dix kilomètres.” (Entretien avec Kevin Brownlow). Encore aujourd’hui un spectateur, même s’il n’a jamais mis les pieds en Virginie, ne peut manquer d’être frappé par l’authenticité de ces extérieurs, et par l’importance dans l’action que leur apporte la mise en scène. King déclara qu’il improvisa beaucoup durant le tournage dans des entretiens avec David Shepard qui restaura ce film magnifique (ainsi que des dizaines d’autres. Je te salue David).
Je me suis immédiatement rué sur TOL’ABLE DAVID (DVD Zone 1 Flicker Alley). King, roi de l’ “Americana” bien avant que le terme soit inventé, donne un bel exemple du genre avec ce film au titre étrange (c’est la mère du jeune David qui déclare qu’il est “tol’able”, peut-être une contraction de “tolérable”; le titre français, DAVID L’ENDURANT est totalement absurde). Le film écrit par Edmund Goulding et King, d’après une nouvelle dont l’action se passe en Virginie, était la première production de la compagnie “Inspiration Pictures” cofondée par King et l’acteur Richard Barthelmess avec le producteur Charles Duell. King insista pour tourner le film en Virginie, dont il était originaire; après avoir envoyé son assistant en repérages avec ses instructions, il arriva sur place et trouva, dit-il, tous ses extérieurs en une journée et “dans un rayon de dix kilomètres.” (Entretien avec Kevin Brownlow). Encore aujourd’hui un spectateur, même s’il n’a jamais mis les pieds en Virginie, ne peut manquer d’être frappé par l’authenticité de ces extérieurs, et par l’importance dans l’action que leur apporte la mise en scène. King déclara qu’il improvisa beaucoup durant le tournage dans des entretiens avec David Shepard qui restaura ce film magnifique (ainsi que des dizaines d’autres. Je te salue David).
THE WINNING OF BARABARA WORTH toujours de King est visuellement tout aussi impressionnant et certaines séquences, tout le début, une tempête de sable, un exode devant une rivière en crue, sont inoubliables. Mais la trame dramatique, pourtant de Frances Marion, est plus traditionnelle et les personnages disparaissent derrière la Nature, comme noyés dans les paysages, ce qui est très rare chez King.
DÉCOUVERTES
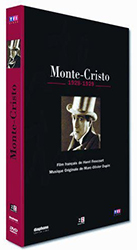 Outre LE COFFRET des films muets de RAYMOND BERNARD avec plusieurs titres mémorables chez Gaumont, je voudrais faire partager une grandiose découverte, celle du COMTE DE MONTE CRISTO, scénario et mise en scène d’Henri Fescourt (Diaphana Video à l’origine), peut-être la meilleure adaptation du génial roman d’Alexandre Dumas et Auguste Maquet que l’on devrait relire tous les cinq ou six ans. Dans cette version, on est ébloui par la beauté des plans d’extérieurs, fort nombreux, transporté par l’invention et la rigueur de la mise en scène avec de nombreux et magnifiques travellings, une utilisation quasi expressionniste de certains décors (l’auberge de Caderousse) sans parler de l’utilisations de flash-backs rapides et percutants surtout durant la deuxième époque (l’évocation du massacre de Jenina). Fescourt garde certains épisodes souvent coupés dans les autres versions : l’engagement de Fernando de Mondego auprès des Grecs qui luttent pour leur indépendance (une cause chère à Dumas et Hugo), puis sa trahison quand il vend une ville aux Turcs. Jean Angelo, en Monte Cristo, a de faux airs de Guitry jeune, Jean Toulut campe un Villefort gravé dans le marbre tout comme le Caderousse d’Henri Debain qui fut aussi assistant réalisateur. Le film est d’ailleurs très bien joué à quelques mini-excès près dans la deuxième partie avec déjà une création mémorable de Germaine Kerjean, de Robert Merin étonnant Benedetto, avec une gestuelle si moderne. Resnais avait été fasciné par la beauté visuelle du film et on le comprend. Ce film n’est hélas plus disponible sur le site de Diaphana contrairement à INTOLÉRANCE de Griffith et je le déplore. On le trouve à un prix prohibitif sur Amazon France. La FNAC ne le recense même pas.
Outre LE COFFRET des films muets de RAYMOND BERNARD avec plusieurs titres mémorables chez Gaumont, je voudrais faire partager une grandiose découverte, celle du COMTE DE MONTE CRISTO, scénario et mise en scène d’Henri Fescourt (Diaphana Video à l’origine), peut-être la meilleure adaptation du génial roman d’Alexandre Dumas et Auguste Maquet que l’on devrait relire tous les cinq ou six ans. Dans cette version, on est ébloui par la beauté des plans d’extérieurs, fort nombreux, transporté par l’invention et la rigueur de la mise en scène avec de nombreux et magnifiques travellings, une utilisation quasi expressionniste de certains décors (l’auberge de Caderousse) sans parler de l’utilisations de flash-backs rapides et percutants surtout durant la deuxième époque (l’évocation du massacre de Jenina). Fescourt garde certains épisodes souvent coupés dans les autres versions : l’engagement de Fernando de Mondego auprès des Grecs qui luttent pour leur indépendance (une cause chère à Dumas et Hugo), puis sa trahison quand il vend une ville aux Turcs. Jean Angelo, en Monte Cristo, a de faux airs de Guitry jeune, Jean Toulut campe un Villefort gravé dans le marbre tout comme le Caderousse d’Henri Debain qui fut aussi assistant réalisateur. Le film est d’ailleurs très bien joué à quelques mini-excès près dans la deuxième partie avec déjà une création mémorable de Germaine Kerjean, de Robert Merin étonnant Benedetto, avec une gestuelle si moderne. Resnais avait été fasciné par la beauté visuelle du film et on le comprend. Ce film n’est hélas plus disponible sur le site de Diaphana contrairement à INTOLÉRANCE de Griffith et je le déplore. On le trouve à un prix prohibitif sur Amazon France. La FNAC ne le recense même pas.
Sur le site de DIAPHANA, j’ai également découvert plusieurs titres qui méritent d’être signalés, rappelés, vantés : à commencer par le très puissant WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN de Lynn Ramsay, l’émouvant THE DEEP BLUE SEA de Terence Davies (n’est ce pas ballantrae ?), le superbe POETRY de Lee Shong Dang, RAPT de Lucas Belvaux qui m’avait beaucoup plu, NEBRASKA, une œuvre si personnelle et à contre courant d’Alexander Payne, somptueux noir et blanc, morceau d’Americana vu avec les yeux d’aujourd’hui et le décontracté et fort agréable MARIAGE À MENDOZA d’Edouard Deluc.
LIVRES
 J’ai redécouvert Andreï Konchalovsky en décorant ses conversations avec Michel Ciment : ANDREÏ KONCHALOVSKY – NI DISSIDENT, NI PARTISAN, NI COURTISAN. Trois termes soigneusement choisis qui expliquent pourquoi ci cinéaste reste si peu étudié malgré plusieurs films admirables. On se souvient de l’éblouissement procuré par LE PREMIER MAÎTRE (se reporter à la magnifique critique de Michel Cournot), du choc que procurait MARIA’S LOVERS et de nombreuses séquences de SIBÉRIADE. Konchalovsky raconte brillamment comment il passa de l’URSS à l’Amérique, évoque les obstacles, les censures qu’il dut affronter dans les deux pays. Malheureusement, l’un de ses derniers films américains qui fut massacré par le producteur, TANGO ET CASH, est l’un des seuls qui soit facilement disponible en DVD, les autres étant pour la plupart indisponibles en France. On ne trouve MARIA’S LOVER que dans un import italien dont trois ou quatre clients ont dit qu’il s’arrêtait en cours de route. SIBÉRIADE est proposé à des prix prohibitifs. LE CERCLE DES INTIMES n’est vraiment trouvable qu’en zone 1 et je l’ai commandé. Reste heureusement LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR que je n’ai jamais vu mais dont on me dit grand bien et CASSE-NOISETTE.
J’ai redécouvert Andreï Konchalovsky en décorant ses conversations avec Michel Ciment : ANDREÏ KONCHALOVSKY – NI DISSIDENT, NI PARTISAN, NI COURTISAN. Trois termes soigneusement choisis qui expliquent pourquoi ci cinéaste reste si peu étudié malgré plusieurs films admirables. On se souvient de l’éblouissement procuré par LE PREMIER MAÎTRE (se reporter à la magnifique critique de Michel Cournot), du choc que procurait MARIA’S LOVERS et de nombreuses séquences de SIBÉRIADE. Konchalovsky raconte brillamment comment il passa de l’URSS à l’Amérique, évoque les obstacles, les censures qu’il dut affronter dans les deux pays. Malheureusement, l’un de ses derniers films américains qui fut massacré par le producteur, TANGO ET CASH, est l’un des seuls qui soit facilement disponible en DVD, les autres étant pour la plupart indisponibles en France. On ne trouve MARIA’S LOVER que dans un import italien dont trois ou quatre clients ont dit qu’il s’arrêtait en cours de route. SIBÉRIADE est proposé à des prix prohibitifs. LE CERCLE DES INTIMES n’est vraiment trouvable qu’en zone 1 et je l’ai commandé. Reste heureusement LES NUITS BLANCHES DU FACTEUR que je n’ai jamais vu mais dont on me dit grand bien et CASSE-NOISETTE.
J’ai adoré GÉRARD, Cinq année dans les pattes de Depardieu, une très savoureuse et roborative BD de Mathieu Sapin qui, au passage, croque admirablement l’originalité, la folie, les contradictions, le gigantesque appétit, la boulimie de tout (à commencer par la nourriture – on ne dévore pas dans ce livre, on engloutit, aussi bien de l’Art que des cotes de porc -) qui fait de Depardieu un personnage unique, épique, exaspérant et sublime, un pétomane métaphysique, un poète dadaïste, un funambule (il peut être parfois si léger) du dérisoire et, accessoirement et quand il le veut, un acteur sublime. Il faut l’avoir vu dans VALLEY OF LOVE ou dans les dernières scènes des CONFINS DU MONDE.
J‘ai dégusté avec délice la série de croquis incisifs signés par Jean Cau dans CROQUIS DE MÉMOIRE où Mitterrand (très bien saisi) croise Queneau, Welles, Ezra Pound, Giscard d’Estaing (désopilant et juste), Pompidou, Mademoiselle Chanel. Beau portrait de Sartre et poignante évocation de Carson McCullers. Il nous montre aussi un Lacan première époque qui, affolé, vient consulter Sartre parce qu’il a surpris sa fille de 8 ans qui marchait dans ses chaussures. Il y voit un acte de haine contre le père et Sartre explique qu’il ne pouvait pas lui dire qu’elle s’amusait normalement, il aurait refusé d’entendre, alors il lui a conseillé de l’écrire : « Le meilleur moyen de se débarrasser des gêneurs ; dites leur d’écrire, vous gagnez trois mois de tranquillité. »
Je voudrais aussi saluer VIVA CINECITTÀ! de Philippe d’Hugues (Editions De Fallois), une série de textes critiques qui réévaluent Soldati, De Sica, Pasolini, Antonioni, Cottafavi, Comencini, Rosi Olmi, Fellini, Visconti et, plus rares, Blasetti. Sur ce dernier cinéastes, Philippe D’Hugues est trop sévère sur le très savoureux DOMMAGE QUE TU SOIS UNE CANAILLE que j’ai défendu ici même et qu’il n’a pas dû revoir tout comme IL BOOM, grande réussite très noire de De Sica. Peccadille car le livre donne envie de revoir nombre de films à commencer par I VINTI d’Antonioni dont j’avais oublié que les dialogues étaient de Roger Nimier.
Pour les amateurs de théâtre, QUATRE ANNÉES SANS RELÂCHE (De Fallois) de Pierre Barillet (oui le Barillet de Barillet et Gredy) est un livre délectable qui évoque avec naturel et passion l’adolescence de l’auteur durant cette période noire. Il poursuit ses études. Sa passion, c’est le théâtre et il rend compte de tous les spectacles qu’il voit, ce qui l’amène à prendre certains risques. Il essaie de se glisser en coulisse, de rencontrer les auteurs, les artistes qu’il admire, Cocteau, Charles Trenet, (qui l’entraine dans des soirées interminables avec Piaf, Johnny Hess) Bérard, Guitry. Il analyse les créations d’Anouilh, note la découverte d’un jeune auteur, Louis Ducreux avec la Part du Feu. Il recopie les critiques dont celles d’Alain Laubreaux qui a ses têtes de turc comme Edouard Bourdet, Cocteau, Marais qu’il assassine sauvagement (Barillet ne partage pas les opinions politiques de son journal). Bref, c’est une partie de la vie intellectuelle qu’il nous fait revivre sans hypocrisie, sans cacher les petitesses de plusieurs de ses idoles mais aussi leur courage.
Emmanuel Burdeau vient d’écrire GRAVITÉ sur Billy Wilder et le début analyse deux scènes iconiques, Joe Gillis flottant dans la piscine (SUNSET BOULEVARD) et Marilyn sur la bouche de métro de 7 ANS DE RÉFLEXION (qui ne figure pas dans mes Wilder favoris). A partir de là, Burdeau analyse le poids, l’importance de l’air, de l’eau dans les films du cinéaste, démarrage accrocheur et intriguant qui permet de cerner certaines obsessions qui traversent l’œuvre du cinéaste. Burdeau remarque que « deux caractères dominent, l’ingénu et l’arriviste, Jack Lemmon d’un côté, Walter Matthau ou William Holden de l’autre ; trois professions l’emportent également : le journalisme, les assurances et le barreau ».
Il faut absolument acheter et lire le numéro 21 de TEMPS NOIR qui contient une série d’analyses précieuses sur le roman policier sous l’Occupation (je conseille spécialement le chapitre « les auteurs dans la tourmente »), plus la première étude, à ma connaissance, sur Louis Chavance où j’ai découvert son compagnonnage avec Prévert, Brunius, le Groupe Octobre, certains surréalistes, ses activités critiques, ses débuts de scénariste avec LA NUIT FANTASTIQUE (co-écrit avec, entre autres, Henri Jeanson qui a été interdit d’écriture par les Allemands et travaille en douce). Suivront LE BARON FANTÔME et surtout le CORBEAU. Puis l’inépuisable UN REVENANT, un de mes films de chevet (René Château), trois Cayatte dont j’ai déjà parlé LE DERNIER SOU, LE CHANTEUR INCONNU, LE DESSOUS DES CARTES (les deux derniers chez René Château).
LIVRES EN ANGLAIS
Patrick McGilligan vient de signer avec FUNNY MAN, une remarquable biographie de Mel Brooks, nous faisant découvrir un personnage ambigu, tourmenté, un bourreau de travail qui a besoin de multiples collaborateurs. Ses premiers films naquirent dans la souffrance et les pressions financières (sujet moteur des PRODUCTEURS) et c’est à la suite de multiples péripéties et désistements que Gene Wilder hérite du rôle principal de YOUNG FRANKENSTEIN (pour moi le chef d’œuvre de Brooks avec l’hilarant BLAZING SADDLES), ce qui se révèle une bénédiction pour le film. Dans la vie privée, Brooks a des côtés noirs (la manière dont il parvient à gruger sa première femme vous fait dresser les cheveux sur la tête) mais il est capable aussi de s’enthousiasmer pour ELEPHANT MAN et de produire le film de David Lynch.
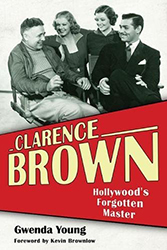 Tout aussi remarquable ce premier ouvrage important consacré à Clarence Brown, CLARENCE BROWN, HOLLYWOOD FORGOTTEN MASTER (Kentucky Press) par Gwenda Young de l’université de Cork. C’est un livre très documenté qui regroupe de nombreux témoignages sur la personnalité de Brown, cinéaste en apparence éclectique. Il est vrai que sous contrat pendant des décennies à la MGM (il n’en sortit que quand il fut prêté à la Fox et Zanuck pour THE RAINS CAME), il dut filmer des produits maisons opulents et creux (l’anodin l’AVENTURE COMMENCE À BOMBAY, qui débuta sans un scénario terminé, THE GEORGOUS HUSSY) des œuvres lessivées par la Censure avant le tournage (le sinistre IDIOT’S DELIGHT qu’il détestait) mais réussit à imposer des films exigeants : L’INTRUS une des meilleures adaptation de Faulkner, THE YEARLING / Jody et le Faon (zone 1) magnifique chronique familiale, souvent âpre et violente. En dehors d’être le réalisateur préféré de Garbo (on ne peut oublier LA CHAIR ET LE DIABLE) qu’il sut apprivoiser en lui parlant en dehors du plateau, il avait une prédilection pour les histoires truffées de détails autobiographiques se déroulants dans des bourgades de la province américaine, ces morceaux d’Americana chers aussi à Henry King, pour les personnages sacrificiels, consacrant plusieurs films à des héroïnes âgées ou vieillissantes, sujets clivant comme on dirait maintenant (SMOULDERING FIRES, GOOSE WOMAN, EMMA, ce dernier disponible en zone 1 sans sous titre). Il savait diriger les actrices et aussi les enfants ou les adolescents qui peuplent son œuvre. Il découvrit des stars (Gable, Myrna Loy). Ce conservateur signa des films audacieux à l’époque du Pré-Code :
Tout aussi remarquable ce premier ouvrage important consacré à Clarence Brown, CLARENCE BROWN, HOLLYWOOD FORGOTTEN MASTER (Kentucky Press) par Gwenda Young de l’université de Cork. C’est un livre très documenté qui regroupe de nombreux témoignages sur la personnalité de Brown, cinéaste en apparence éclectique. Il est vrai que sous contrat pendant des décennies à la MGM (il n’en sortit que quand il fut prêté à la Fox et Zanuck pour THE RAINS CAME), il dut filmer des produits maisons opulents et creux (l’anodin l’AVENTURE COMMENCE À BOMBAY, qui débuta sans un scénario terminé, THE GEORGOUS HUSSY) des œuvres lessivées par la Censure avant le tournage (le sinistre IDIOT’S DELIGHT qu’il détestait) mais réussit à imposer des films exigeants : L’INTRUS une des meilleures adaptation de Faulkner, THE YEARLING / Jody et le Faon (zone 1) magnifique chronique familiale, souvent âpre et violente. En dehors d’être le réalisateur préféré de Garbo (on ne peut oublier LA CHAIR ET LE DIABLE) qu’il sut apprivoiser en lui parlant en dehors du plateau, il avait une prédilection pour les histoires truffées de détails autobiographiques se déroulants dans des bourgades de la province américaine, ces morceaux d’Americana chers aussi à Henry King, pour les personnages sacrificiels, consacrant plusieurs films à des héroïnes âgées ou vieillissantes, sujets clivant comme on dirait maintenant (SMOULDERING FIRES, GOOSE WOMAN, EMMA, ce dernier disponible en zone 1 sans sous titre). Il savait diriger les actrices et aussi les enfants ou les adolescents qui peuplent son œuvre. Il découvrit des stars (Gable, Myrna Loy). Ce conservateur signa des films audacieux à l’époque du Pré-Code :
- l’excellent ÂMES LIBRES qui contient des allusions sexuelles incroyables, à voir dans la collection FORBIDDEN HOLLYWOOD ;
- le très remarquable FASCINATION où l’alchimie entre Gable et Crawford crée des étincelles (il en résultat une histoire d’amour torride que Louis B Mayer s’ingénia à briser) et où les séquences d’ouvertures sont inoubliables), ce réactionnaire réalisa un des films les plus dignes sur la question raciale, INTRUDER IN THE DUST (L’INTRUS, hélas disponible uniquement en zone 1) avec une interprétation inoubliable de Juano Hernande
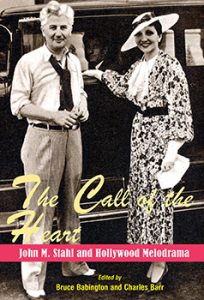 Signalons aussi de Charles Barr (l’un des meilleurs historiens anglais, on n’a pas oublié son livre sur Ealing) et Bruce Babington THE CALL OF THE HEART – John M. Stahl and the Hollywood melodrama. Bonne occasion de rappeler ce cinéaste sous-estimé qui a su bâtir un univers personnel et cohérent aussi bien dans BACK STREET (1932) qui fut éditée dans une collection Universal, dans tous ces mélodrames refaits par Sirk du SECRET MAGNIFIQUE à MIRAGE DE LA VIE et ces remakes, maintenant adulés, ont contribué à effacer les premières versions de Stahl qu’on trouve parfois dans les bonus des Sirk et dans de trop rares éditions françaises comme IMAGES DE LA VIE. Pourtant le très étonnant et remarquable PÉCHÉ MORTEL (Fox Europa Pathé), un des premiers films noirs en couleur a été amplement commenté mais il faudrait revoir des chefs d’œuvres comme ONLY YESTERDAY, toujours absent des catalogues sans oublier HOLY MATRIMONY (comédie caustique) et THE FOXES OF HARROW qu’on trouve dans des DVD espagnols ou italiens (LA SUPERBA CREOLE). Barr signale aussi qu’une des raisons de la semi obscurité qui entoure Stahl tient au fait qu’il n’a réalisé aucun film muet iconique contrairement à ses contemporains Lubitsch, Sternberg.
Signalons aussi de Charles Barr (l’un des meilleurs historiens anglais, on n’a pas oublié son livre sur Ealing) et Bruce Babington THE CALL OF THE HEART – John M. Stahl and the Hollywood melodrama. Bonne occasion de rappeler ce cinéaste sous-estimé qui a su bâtir un univers personnel et cohérent aussi bien dans BACK STREET (1932) qui fut éditée dans une collection Universal, dans tous ces mélodrames refaits par Sirk du SECRET MAGNIFIQUE à MIRAGE DE LA VIE et ces remakes, maintenant adulés, ont contribué à effacer les premières versions de Stahl qu’on trouve parfois dans les bonus des Sirk et dans de trop rares éditions françaises comme IMAGES DE LA VIE. Pourtant le très étonnant et remarquable PÉCHÉ MORTEL (Fox Europa Pathé), un des premiers films noirs en couleur a été amplement commenté mais il faudrait revoir des chefs d’œuvres comme ONLY YESTERDAY, toujours absent des catalogues sans oublier HOLY MATRIMONY (comédie caustique) et THE FOXES OF HARROW qu’on trouve dans des DVD espagnols ou italiens (LA SUPERBA CREOLE). Barr signale aussi qu’une des raisons de la semi obscurité qui entoure Stahl tient au fait qu’il n’a réalisé aucun film muet iconique contrairement à ses contemporains Lubitsch, Sternberg.