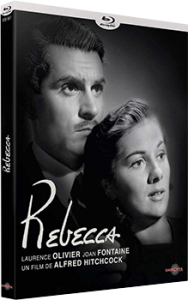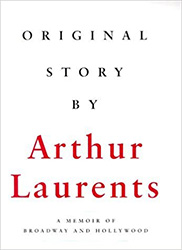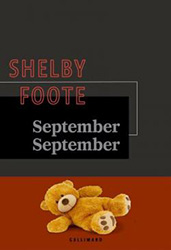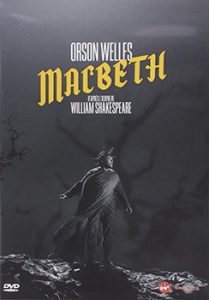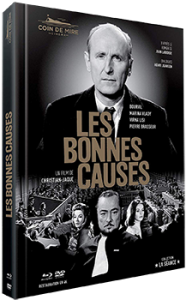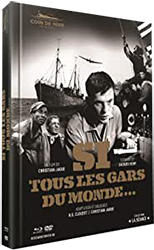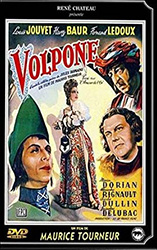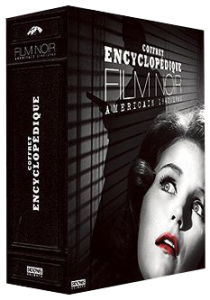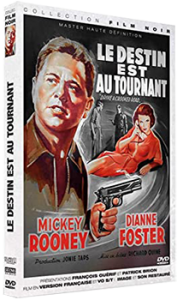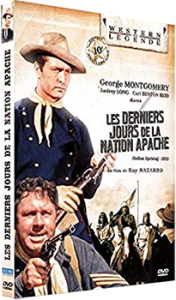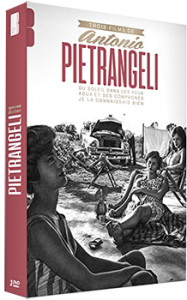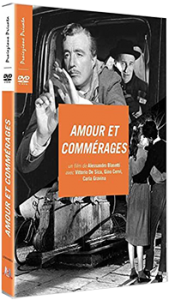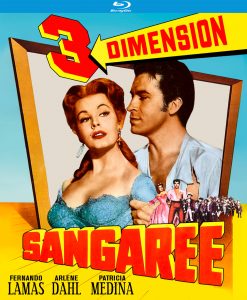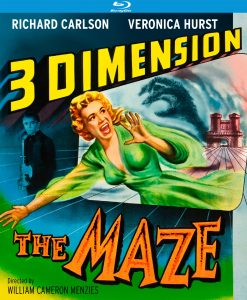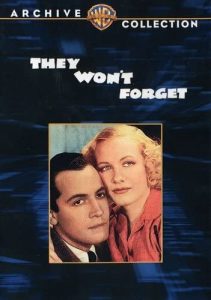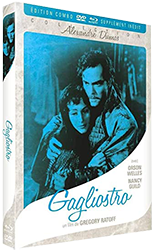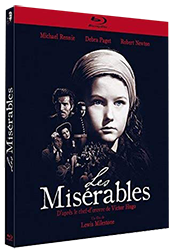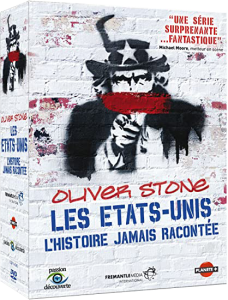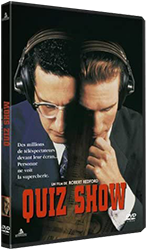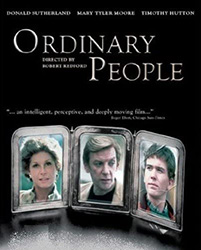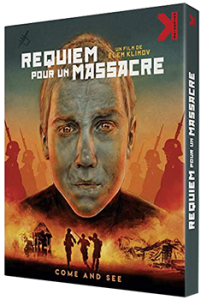LIVRES
 LES LUMIÈRES DE LHOMME est une nouvelle réussite de Luc Beraud. En partant de faits très concrets, il parvient tout d’abord à tracer un portrait attachant de Pierre Lhomme, à faire revivre sa carrière de chef opérateur en nous donnant mille renseignements précieux indispensables, puis, élargissant le propos nous fait réfléchir sur la pratique du cinéma, les rapports entre l’image, le cadre et le sens. Approche personnelle, originale. Chaque chapitre amène une nouvelle strate et on a l’impression de participer à la réflexion de l’auteur, à ses découvertes. Son admiration ne le rend jamais aveugle, par exemple sur Bresson. Ce qu’il écrit est très éclairant, chaleureux, jamais scolaire et en même temps, il pointe certains manques : la méconnaissance gigantesque du théâtre qui l’amène à filmer des caricatures démodées depuis trente ans. Partant de constatations techniques précises et justes, Beraud jette un regard neuf sur la pratique du cinéma et son histoire. Remarquable.
LES LUMIÈRES DE LHOMME est une nouvelle réussite de Luc Beraud. En partant de faits très concrets, il parvient tout d’abord à tracer un portrait attachant de Pierre Lhomme, à faire revivre sa carrière de chef opérateur en nous donnant mille renseignements précieux indispensables, puis, élargissant le propos nous fait réfléchir sur la pratique du cinéma, les rapports entre l’image, le cadre et le sens. Approche personnelle, originale. Chaque chapitre amène une nouvelle strate et on a l’impression de participer à la réflexion de l’auteur, à ses découvertes. Son admiration ne le rend jamais aveugle, par exemple sur Bresson. Ce qu’il écrit est très éclairant, chaleureux, jamais scolaire et en même temps, il pointe certains manques : la méconnaissance gigantesque du théâtre qui l’amène à filmer des caricatures démodées depuis trente ans. Partant de constatations techniques précises et justes, Beraud jette un regard neuf sur la pratique du cinéma et son histoire. Remarquable.
 DANS LES GEÔLES DE SIBÉRIE (Stock) de Yoan Barbereau est un récit puissant, un témoignage terrible sur les mœurs policières qui sévissent toujours en Russie. Rien ne semble avoir changé sinon que les accusations sont plus insidieuses. Le directeur de l’Alliance Française d’Irkoutsk (la ville où doit se rendre Michel Strogoff) se fait arrêter et emprisonner un matin. On l’accuse de pédophilie et il va devoir se battre deux ans pour s’extirper de ce piège infernal. On a fabriqué un dossier énorme et seule la taille compte car, il n’y a aucune preuve, aucun témoin. La plupart des accusations sont absurdes et seront démolies pendant l’enquête sans que cela ne fasse changer l’accusation. Le FSB a lancé une énorme machine qui ne peut plus s’arrêter et qui se nourrit de ses propres divagations. Barbereau relate de manière implacable les conditions de détention, la solidarité qui finit par se créer dans chacune des cellules avec parfois la complicité des directeurs de prison, de certains médecins, l’effrayante passivité du Quai d’Orsay où chacun ne songe qu’à protéger son poste et enfin son extravagante et héroïque évasion en BlaBlaCar. Comme l’écrit Benoir Vitkine dans le Monde : « Le résultat est un ouvrage inclassable. Dans les geôles de Sibérie se lit bel et bien comme un roman d’aventures, angoissant et terrifiant, qui met en scène la prison, l’étouffement, une suite de pièges dont le héros ne sort qu’en comptant sur lui même. »
DANS LES GEÔLES DE SIBÉRIE (Stock) de Yoan Barbereau est un récit puissant, un témoignage terrible sur les mœurs policières qui sévissent toujours en Russie. Rien ne semble avoir changé sinon que les accusations sont plus insidieuses. Le directeur de l’Alliance Française d’Irkoutsk (la ville où doit se rendre Michel Strogoff) se fait arrêter et emprisonner un matin. On l’accuse de pédophilie et il va devoir se battre deux ans pour s’extirper de ce piège infernal. On a fabriqué un dossier énorme et seule la taille compte car, il n’y a aucune preuve, aucun témoin. La plupart des accusations sont absurdes et seront démolies pendant l’enquête sans que cela ne fasse changer l’accusation. Le FSB a lancé une énorme machine qui ne peut plus s’arrêter et qui se nourrit de ses propres divagations. Barbereau relate de manière implacable les conditions de détention, la solidarité qui finit par se créer dans chacune des cellules avec parfois la complicité des directeurs de prison, de certains médecins, l’effrayante passivité du Quai d’Orsay où chacun ne songe qu’à protéger son poste et enfin son extravagante et héroïque évasion en BlaBlaCar. Comme l’écrit Benoir Vitkine dans le Monde : « Le résultat est un ouvrage inclassable. Dans les geôles de Sibérie se lit bel et bien comme un roman d’aventures, angoissant et terrifiant, qui met en scène la prison, l’étouffement, une suite de pièges dont le héros ne sort qu’en comptant sur lui même. »
A lire à la suite du PIÈGE AMÉRICAIN de Frédéric Pierucci avec Matthieu Aron pour voir comment deux grandes puissances peuvent en toute impunité piétiner le droit, les conventions internationales, les règles les plus élémentaires de la justice. Dans les deux cas, les institutions françaises (pas les individus ni quelques journalistes) réagissent avec une frilosité (et dans le cas de Pierucci, une complicité) pitoyable
 SUR MON PÈRE de Tatiana Tolstoï est une évocation touchante des rapports extrêmement complexes qui à la fois unissaient et opposaient le grand écrivain et sa femme. Leurs aspirations, leur vision du monde était radicalement différente : lui était obsédé par ses expériences sociales, sa recherche de la perfection jusqu’à imposer un mode de vie dur et archaïque (mais qu’il pouvait corriger par amour). Elle détestait le peuple, vénérait de manière abstraite la vie de famille, était horriblement jalouse des femmes qu’il avait connues avant elle. De plus Tolstoï se convertit, rejette l’église orthodoxe et veut embrasser la même vie que les paysans. Ce qui déstabilise encore plus sa malheureuse épouse. C’est émouvant et complexe.
SUR MON PÈRE de Tatiana Tolstoï est une évocation touchante des rapports extrêmement complexes qui à la fois unissaient et opposaient le grand écrivain et sa femme. Leurs aspirations, leur vision du monde était radicalement différente : lui était obsédé par ses expériences sociales, sa recherche de la perfection jusqu’à imposer un mode de vie dur et archaïque (mais qu’il pouvait corriger par amour). Elle détestait le peuple, vénérait de manière abstraite la vie de famille, était horriblement jalouse des femmes qu’il avait connues avant elle. De plus Tolstoï se convertit, rejette l’église orthodoxe et veut embrasser la même vie que les paysans. Ce qui déstabilise encore plus sa malheureuse épouse. C’est émouvant et complexe.
 DANIELLE DARRIEUX OU LA TRAVERSÉE D’UN SIÈCLE (Presse universitaire de Bordeaux). Passionnant travail collectif extraordinairement documenté dirigé par Gwénaëlle Le Gras et Geneviève Sellier sur cette géniale actrice, cet ouvrage complète l’excellente biographie critique de Clara Laurent :on y évoque aussi bien l’influence de Henri Decoin dans les années 30 que les comédies musicales de Danielle Darrieux, ses rapports complexes tant filmiques que personnels avec l’Occupation, le voyage à Berlin (curieusement sans citer le travail de Christine Leteux sur cet épisode), la genèse et réception de LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE ou comment le public a boudé un chef d’œuvre, l’identité féminine dans les films de Darrieux avec Max Ophüls, DU HAUT DES MARCHES de Vecchiali. Les auteurs et autrices ne taisent pas les interrogations, les zones d’ombre dans ses rapports avec Rubirosa, notamment, analysent l’évolution des différents scénarios du BON DIEU SANS CONFESSION, film que je trouve prometteur, passionnant mais écrit sans grâce ni inspiration. On a même droit à des recherches sur l’exploitation des films de Darrieux en Moselle soulignant qu’une œuvre pouvait être autorisée dans une ville et interdite dix kilomètres plus loin.
DANIELLE DARRIEUX OU LA TRAVERSÉE D’UN SIÈCLE (Presse universitaire de Bordeaux). Passionnant travail collectif extraordinairement documenté dirigé par Gwénaëlle Le Gras et Geneviève Sellier sur cette géniale actrice, cet ouvrage complète l’excellente biographie critique de Clara Laurent :on y évoque aussi bien l’influence de Henri Decoin dans les années 30 que les comédies musicales de Danielle Darrieux, ses rapports complexes tant filmiques que personnels avec l’Occupation, le voyage à Berlin (curieusement sans citer le travail de Christine Leteux sur cet épisode), la genèse et réception de LA VÉRITÉ SUR BÉBÉ DONGE ou comment le public a boudé un chef d’œuvre, l’identité féminine dans les films de Darrieux avec Max Ophüls, DU HAUT DES MARCHES de Vecchiali. Les auteurs et autrices ne taisent pas les interrogations, les zones d’ombre dans ses rapports avec Rubirosa, notamment, analysent l’évolution des différents scénarios du BON DIEU SANS CONFESSION, film que je trouve prometteur, passionnant mais écrit sans grâce ni inspiration. On a même droit à des recherches sur l’exploitation des films de Darrieux en Moselle soulignant qu’une œuvre pouvait être autorisée dans une ville et interdite dix kilomètres plus loin.
LES TONTONS FLINGUEURS (Temps Noir), somme définitive sur ce « classique » de Georges Lautner qui aura engendré plus de littérature, d’essais que CASQUE D’OR ou REMORQUES. Mais on y apprend cent mille choses, sur l’évolution du scénario, les différentes versions, les changements amenés par Lautner durant le tournage. C’est très amusant et définitif sur la question.
Je me suis beaucoup amusé en lisant SOIT DIT EN PASSANT, l’autobiographie de Woody Allen. Ses chapitres sur ses parents, son enfance, son apprentissage dans les clubs contiennent des passages désopilants, truffés d’hommages, de coups de chapeau à des comédiens qu’il adore dont beaucoup nous sont inconnus. De manière détournée, il finit par donner quelques aperçus précis mais toujours modestes sur les quelques films qu’il considère comme réussis et personnels, CRIMES ET DÉLITS, LA ROSE POURPRE DU CAIRE, HANNAH ET SES SŒURS et deux ou trois autres mais rejette MANHATTAN. On l’a accusé de manière ignominieuse de ne parler des femmes qu’en termes de séduction, de beauté, ce qui est totalement faux. Il répète cent fois que ce sont les femmes, ses épouses, ses amies qui l’ont éduqué, lui ont tout appris, l’ont ouvert à la littérature, à la politique. Il ne tarit pas d’éloges sur elles, question culture et intellect, décrit admirablement Diane Keaton, Scarlett Johansson, rend un hommage appuyé à Dianne Wiest. Et à de nombreux collaborateurs, ses coscénaristes, Gordon Willis (qui lui a tout appris), ses producteurs sans oublier sa dernière épouse. De même, le reproche de consacrer plusieurs chapitres à Mia Farrow est d’une rare sottise. Elle lui a pourri la vie pendant deux décades (quelles que soient ses erreurs, qu’elle devrait partager, et ses décisions imprudentes), en a fait un paria même si deux jugements l’ont blanchi. Il révèle que l’actrice après avoir déclenché la machine judiciaire, l’appelle pour s’étonner qu’elle n’ait pas de rôle dans son nouveau film et le menace de représailles, cite longuement le témoignage remarquable du frère de Dylan, Moses (que la presse française zappe continuellement), devenu psychologue, qui accable Farrow et Dylan, et celui de son épouse sur les violences qu’elle commettait sur certains des enfants adoptés (« elle aimait les adopter, pas les élever »), réfute de multiple contre-vérités. On a pu le lire dans un récent numéro de Positif. Récemment deux autres enquêtes poussées relèvent les incohérences, mensonges, dissimulations du clan Farrow pendant qu’un journaliste du New York Times déniche de multiples erreurs et allégations non prouvées même dans l’enquête contre Weinstein. Tout cela restera comme un témoignage accablant sur la lâcheté d’une partie de la presse et d’une opinion qui se complaît dans les rumeurs plutôt que dans les faits. Cela dit, le livre dans sa version originale est mal édité (on a droit deux fois au même récit d’un tournage) et surtout traduit de manière approximative.
Pour tous les amateurs des compositeurs de l’âge d’or Hollywoodien, signalons le coffret CHARLES GERHARDT CONDUCTS CLASSIC FILM SCORES qu’on peut trouver à moins de 30 euros pour 12 CD où l’on entend Korngold, Hermann, Steiner, Tiomkin, Waxman, Newman : écouter THE BIG SKY, CITIZEN KANE, L’AIGLE DES MERS, LE GRAND SOMMEIL, AUTANT EN EMPORTE LE VENT et tant d’autres fait passer des frissons
FILMS
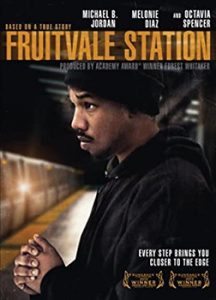 FRUITVALE STATION marque les débuts assez remarquables de Ryan Coogler, jeune cinéaste noir avec cette chronique d’une bavure policière qui annonce celle qui causa la mort de George Floyd. Coogler ne veut pas faire une œuvre à thèse où tout soit donné avant que d’être montré. Il relate les heures qui précèdent le meurtre du héros, sa vie familiale, décrite avec une grande justesse, une absence d’effets, son passé tumultueux, ses rapports parfois conflictuels avec sa copine. Il ne prêche jamais, laisse les faits parler par eux-mêmes, sans les dramatiser outre mesure et nous fait bien sentir tout ce qui provoquer ce drame : une série de décisions malheureuses, prises avec des bonnes intentions, le racisme qui prévaut de marnière organique dans la police et qui se traduisent par des décisions violentes, injustes (dans un groupe de suspects, on s’en prend d’abord aux Noirs), le manque d’éducation, de sang froid, la peur qui lancent un engrenage qu’on ne peut arrêter. Le constat est accablant sans qu’il soit besoin de le charger. Le film fut accueilli avec une condescendance stupéfiante en France, comme beaucoup d’œuvres progressistes. Le revoir maintenant souligne ses qualités prophétiques, la générosité du regard, l’attention portée à des personnages simples qu’on ne cherche jamais à idéaliser. Lui reprocher de mêler de vraies archives au début et à la fin à des personnages de fiction (ce qui a été refait 150 fois par la suite) relève de la bêtise la plus myope.
FRUITVALE STATION marque les débuts assez remarquables de Ryan Coogler, jeune cinéaste noir avec cette chronique d’une bavure policière qui annonce celle qui causa la mort de George Floyd. Coogler ne veut pas faire une œuvre à thèse où tout soit donné avant que d’être montré. Il relate les heures qui précèdent le meurtre du héros, sa vie familiale, décrite avec une grande justesse, une absence d’effets, son passé tumultueux, ses rapports parfois conflictuels avec sa copine. Il ne prêche jamais, laisse les faits parler par eux-mêmes, sans les dramatiser outre mesure et nous fait bien sentir tout ce qui provoquer ce drame : une série de décisions malheureuses, prises avec des bonnes intentions, le racisme qui prévaut de marnière organique dans la police et qui se traduisent par des décisions violentes, injustes (dans un groupe de suspects, on s’en prend d’abord aux Noirs), le manque d’éducation, de sang froid, la peur qui lancent un engrenage qu’on ne peut arrêter. Le constat est accablant sans qu’il soit besoin de le charger. Le film fut accueilli avec une condescendance stupéfiante en France, comme beaucoup d’œuvres progressistes. Le revoir maintenant souligne ses qualités prophétiques, la générosité du regard, l’attention portée à des personnages simples qu’on ne cherche jamais à idéaliser. Lui reprocher de mêler de vraies archives au début et à la fin à des personnages de fiction (ce qui a été refait 150 fois par la suite) relève de la bêtise la plus myope.
COFFRETS DVD
Carlotta vient de consacrer un coffret somptueux à TOOTSIE qui se revoit avec un plaisir, voire une jubilation intense. Nous étions un peu trop condescendants dans 50 ANS, ce qui a été corrigé. On salue une éblouissante interprétation (et donc direction d’acteur de Hoffman à Jessica Lange, lumineuse en passant par Bill Murray). Mais ce qui donne encore plus de poids à ce film qui évite avec élégance tout ce qui pourrait être graveleux pour atteindre même une certaine gravité, c’est l’osmose entre l’accumulation des péripéties et le cadre où elles se déroulent : l’univers du feuilleton, du soap. La brusque et délirante confession de Tootsie dans un studio de télévision, devant ces caméras pourrait donner lieu à une ou deux années de soap. Passionnant bonus qui évoquent la myriade de scénaristes qui collabora au projet dont Elaine May (ses apports sont intelligents et payants), laisse entendre à mots couverts que Hoffman, acteur super doué mais auto-centré et obstiné, fit de ce tournage un cauchemar. Pollack m’avait dit qu’il avait du recourir à une thérapie de plusieurs mois pour retrouver le sommeil.
Et Wild Side en sort un autre, splendide, sur VOYAGE À DEUX cette merveille d’intelligence, de sophistication, concoctée dans une harmonie absolue par Stanley Donen et le scénariste Frederic Raphael. Cette autopsie d’un mariage qui mêle ironie, tendresse et amertume gagne à chaque vision. Et quel couple d’acteurs. Pas encore vu les bonus qui doivent être de première classe.
Je ne sais pas si j’avais signalé le coffret Ida Lupino édité par Kino qui comprend presque tous ses premiers films dont NOT WANTED, NEVER FEAR.
Signalons aussi l’indispensable coffret consacré aux FORBANS DE LA NUIT par Wild Side qui nous permet de découvrir la version anglais de ce film où de nombreuses scènes sont tournées sous un autre angle et avec un un dialogue différent.
Et, toujours chez Wild Side, TROIS FEMMES de Robert Altman.
RARETÉS
 Potemkine vient de sortir le très méconnu MOSCOU NE CROIT PAS AUX LARMES de Vladimir Menshov, pourtant Oscar du meilleur film étranger en 1979. Il s’agit d’une chronique intimiste tournant autour de trois personnages populaires qui fait penser à des films italiens de par la liberté de ton, l’absence de solennité et de raideur. Dès le début on est conquis par la modestie et la justesse du propos, à l’écart de tout formatage narratif. Comme l’écrit le Bleu du Miroir : « Tourné en 1979 et produit par la prestigieuse société cinématographique Mosfilm, MOSCOU NE CROIT PAS AUX LARMES est un superbe mélodrame qui se constitue de deux parties. Dans la première, qui se déroule en 1958 dans l’U.R.S.S. de Nikita Khroutchev, on fait la connaissance de trois amies qui vivent dans un foyer de travailleuses. Katia, Lioudmila et Antonina, malgré leurs différences de tempérament, ont en commun le rêve d’une vie meilleure et des aspirations amoureuses qui prennent une grande place dans leurs existences. Si Katia qui est ajusteuse monteuse s’implique beaucoup dans son travail, Lioudmila, elle, se montre plus arriviste et ne craint pas de mentir sur sa condition pour essayer de séduire un homme riche qui la sortira de sa vie terne et pauvre en promesses. Antonina sera la première à faire un mariage lui apportant une certaine stabilité.
Potemkine vient de sortir le très méconnu MOSCOU NE CROIT PAS AUX LARMES de Vladimir Menshov, pourtant Oscar du meilleur film étranger en 1979. Il s’agit d’une chronique intimiste tournant autour de trois personnages populaires qui fait penser à des films italiens de par la liberté de ton, l’absence de solennité et de raideur. Dès le début on est conquis par la modestie et la justesse du propos, à l’écart de tout formatage narratif. Comme l’écrit le Bleu du Miroir : « Tourné en 1979 et produit par la prestigieuse société cinématographique Mosfilm, MOSCOU NE CROIT PAS AUX LARMES est un superbe mélodrame qui se constitue de deux parties. Dans la première, qui se déroule en 1958 dans l’U.R.S.S. de Nikita Khroutchev, on fait la connaissance de trois amies qui vivent dans un foyer de travailleuses. Katia, Lioudmila et Antonina, malgré leurs différences de tempérament, ont en commun le rêve d’une vie meilleure et des aspirations amoureuses qui prennent une grande place dans leurs existences. Si Katia qui est ajusteuse monteuse s’implique beaucoup dans son travail, Lioudmila, elle, se montre plus arriviste et ne craint pas de mentir sur sa condition pour essayer de séduire un homme riche qui la sortira de sa vie terne et pauvre en promesses. Antonina sera la première à faire un mariage lui apportant une certaine stabilité.
Dans cette première partie, Vladimir Menchov, par petites touches discrètes, au détour d’une courte scène ou d’une réplique, en dit beaucoup sur le climat de son pays à cette époque. Un couple qui s’embrasse dans la rue se fait rappeler à l’ordre par des représentants du pouvoir, la propagande dans les usines cherche à donner une vision idyllique du monde du travail et l’incompréhension règne entre ancienne et nouvelle générations.
Les différences de classes apparaissent également au grand jour. C’est l’époque où l’image d’une société égalitaire commence à s’effriter et à laisser place à un antagonisme entre les ouvriers, les travailleurs et les intellectuels, plus privilégiés, qui constituent une élite à laquelle Lioudmila aimerait appartenir en faisant un beau mariage. Elle n’hésite pas à manipuler les hommes pour faire croire qu’elle appartient déjà à ce milieu. Car elle sait déjà que ces différentes strates ne se mélangent que très rarement. Katia et Lioudmila vont elles aussi faire une rencontre importante pour leur avenir. »
Là encore, les bonus si fouillés (et qui sont totalement absents si vous voyez le film sur Netflix qui de toutes les façons ne s’intéresse pas à ce genre de cinéma) font de ce DVD un objet indispensable.
 7 WOMEN, le chant du cygne si personnel, si loin de toutes les modes, de Ford n’est disponible que dans un DVD espagnol (le mien souffre de défauts de synchronisme dans la VO) de qualité correcte avec un petit bonus où on voir Ford examinant son décor avec son chef opérateur. Ce film paradoxal, est à la fois daté avec sa Chine en studio, ses seigneurs de la guerre incarnés par Woody Strode et l’impressionnant Mile Mazurki (qui fait la blague), son sujet peu en prise avec l’Amérique des années 60, qui revisite le très beau THE BITTER TEA OF GENERAL YEN de Capra, avec un regard décapant et anarchiste (On imagine guère comment on pouvait rêver à un quelconque succès) et contemporain (ou intemporel) de par sa morale, l’urgence dégraissée, rapide, concise de la narration, plus nerveuse que celle des CHEYENNES. Mais surtout, Ford semble prendre un plaisir extrême à remettre en cause des valeurs qu’il semblait défendre, à valoriser son héroïne libre penseuse, anti-cléricale (« A l’hôpital, je n’ai jamais vu Dieu »), à dénoncer l’oppression d’une religion mal assimilée qui engendre une intolérance raciste. Margaret Leighton, personnage maléfique (qu’Anne Bancroft traite de dictateur), s’apparente au Colonel raciste de FORT APACHE (et à la mère impitoyable de PILGRIMAGE) mais sans son courage puisqu’au premier choc, elle perd pied. Interprétation remarquable de Flora Robson, Mildred Dunnock, Eddie Albert. La scène finale, avec une fastueuse dernière réplique, bat tous les records de concision elliptique.
7 WOMEN, le chant du cygne si personnel, si loin de toutes les modes, de Ford n’est disponible que dans un DVD espagnol (le mien souffre de défauts de synchronisme dans la VO) de qualité correcte avec un petit bonus où on voir Ford examinant son décor avec son chef opérateur. Ce film paradoxal, est à la fois daté avec sa Chine en studio, ses seigneurs de la guerre incarnés par Woody Strode et l’impressionnant Mile Mazurki (qui fait la blague), son sujet peu en prise avec l’Amérique des années 60, qui revisite le très beau THE BITTER TEA OF GENERAL YEN de Capra, avec un regard décapant et anarchiste (On imagine guère comment on pouvait rêver à un quelconque succès) et contemporain (ou intemporel) de par sa morale, l’urgence dégraissée, rapide, concise de la narration, plus nerveuse que celle des CHEYENNES. Mais surtout, Ford semble prendre un plaisir extrême à remettre en cause des valeurs qu’il semblait défendre, à valoriser son héroïne libre penseuse, anti-cléricale (« A l’hôpital, je n’ai jamais vu Dieu »), à dénoncer l’oppression d’une religion mal assimilée qui engendre une intolérance raciste. Margaret Leighton, personnage maléfique (qu’Anne Bancroft traite de dictateur), s’apparente au Colonel raciste de FORT APACHE (et à la mère impitoyable de PILGRIMAGE) mais sans son courage puisqu’au premier choc, elle perd pied. Interprétation remarquable de Flora Robson, Mildred Dunnock, Eddie Albert. La scène finale, avec une fastueuse dernière réplique, bat tous les records de concision elliptique.
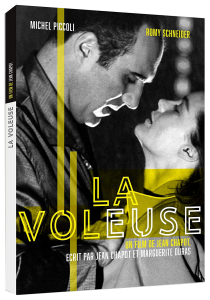 Doriane a eu la bonne idée de sortir un film qui avait disparu de la circulation depuis des années, LA VOLEUSE de Jean Chapot, restauré en 4K, récit austère, douloureux du combat que mène une femme pour récupérer l’enfant qu’elle avait abandonné quelques semaines après sa naissance. Et qui veut le récupérer 6 ans après d’une manière assez hystérique et égoïste. Le film marque la première rencontre cinématographique entre Michel Piccoli et Romy Schneider, absolument magnifique dans un rôle ingrat. Elle s’empare de la pellicule et impose sans effort un tragique quotidien. L’action se déroule dans une zone industrielle, ce qui nous vaut des extérieurs impressionnants mais le scénario, dialogué sobrement par Marguerite Duras, n’est pas très bien construit et l’enjeu de ce combat, le petit garçon, est traité comme un objet. Belle partition d’Antoine Duhamel. Après ce coup d’essai qui sera un échec commercial, le malheureux Chapot sera littéralement exécuté par Alain Delon dans LES GRANGES BRÛLÉES. A voir pour Romy et Christian Blech si puissant en ouvrier polonais mutique et accroché à son gamin. Bonus chaleureux de Jean-Pierre Lavoignat.
Doriane a eu la bonne idée de sortir un film qui avait disparu de la circulation depuis des années, LA VOLEUSE de Jean Chapot, restauré en 4K, récit austère, douloureux du combat que mène une femme pour récupérer l’enfant qu’elle avait abandonné quelques semaines après sa naissance. Et qui veut le récupérer 6 ans après d’une manière assez hystérique et égoïste. Le film marque la première rencontre cinématographique entre Michel Piccoli et Romy Schneider, absolument magnifique dans un rôle ingrat. Elle s’empare de la pellicule et impose sans effort un tragique quotidien. L’action se déroule dans une zone industrielle, ce qui nous vaut des extérieurs impressionnants mais le scénario, dialogué sobrement par Marguerite Duras, n’est pas très bien construit et l’enjeu de ce combat, le petit garçon, est traité comme un objet. Belle partition d’Antoine Duhamel. Après ce coup d’essai qui sera un échec commercial, le malheureux Chapot sera littéralement exécuté par Alain Delon dans LES GRANGES BRÛLÉES. A voir pour Romy et Christian Blech si puissant en ouvrier polonais mutique et accroché à son gamin. Bonus chaleureux de Jean-Pierre Lavoignat.
Encore Christian Jaque
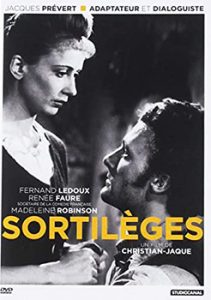 Je parlais de SORTILÈGES en disant que j’en avais gardé un bon souvenir. J’ai acheté le DVD qui vient de sortir et l’ai encore plus apprécié. Christian Jaque parvient à créer un climat envoûtant, oppressant, et Prévert, très inspiré, signe un dialogue souvent mémorable. Ironique avec ces attaques que des villageois obtus dont Marcel Peres, lancent contre les étrangers (« D’accord t’es né à 20 kilomètres, d’accord, t’habites ici depuis trente ans, mais t’es un étranger »), allusion précise à la xénophobie de Vichy. Et dans la galerie de ces personnages noirs, hantés, maléfiques, Jean-Baptiste, dit le Campagnier, est une des figures les plus puissantes, les plus complexes, les plus réussies (infiniment plus que le Diable des VISITEURS ou que Brasseur dans LES AMANTS DE VÉRONE). Il faut dire que Lucien Coeldel, génial, d’une incroyable modernité, lui donne une urgence évoquant Gérard Depardieu. Ses séquences avec Ledoux sont admirables. A deux trois reprises, le film frôle la mièvrerie (lors de la belle chanson, Aux marches du Palais, filmée de manière trop apprêtée avec un raccord de mouvement totalement raté), mais la contourne. Le personnage que joue finement Renée Faure, se révèle plus fort qu’on le pensait. Idem pour Pigaut. Tous les autres sont à louer notamment Madeleine Robinson et Sinoel, hilarant en vieille femme. Remarquable et instructif bonus avec notamment Olivier Barrot. Il faut découvrir cette œuvre méconnue.
Je parlais de SORTILÈGES en disant que j’en avais gardé un bon souvenir. J’ai acheté le DVD qui vient de sortir et l’ai encore plus apprécié. Christian Jaque parvient à créer un climat envoûtant, oppressant, et Prévert, très inspiré, signe un dialogue souvent mémorable. Ironique avec ces attaques que des villageois obtus dont Marcel Peres, lancent contre les étrangers (« D’accord t’es né à 20 kilomètres, d’accord, t’habites ici depuis trente ans, mais t’es un étranger »), allusion précise à la xénophobie de Vichy. Et dans la galerie de ces personnages noirs, hantés, maléfiques, Jean-Baptiste, dit le Campagnier, est une des figures les plus puissantes, les plus complexes, les plus réussies (infiniment plus que le Diable des VISITEURS ou que Brasseur dans LES AMANTS DE VÉRONE). Il faut dire que Lucien Coeldel, génial, d’une incroyable modernité, lui donne une urgence évoquant Gérard Depardieu. Ses séquences avec Ledoux sont admirables. A deux trois reprises, le film frôle la mièvrerie (lors de la belle chanson, Aux marches du Palais, filmée de manière trop apprêtée avec un raccord de mouvement totalement raté), mais la contourne. Le personnage que joue finement Renée Faure, se révèle plus fort qu’on le pensait. Idem pour Pigaut. Tous les autres sont à louer notamment Madeleine Robinson et Sinoel, hilarant en vieille femme. Remarquable et instructif bonus avec notamment Olivier Barrot. Il faut découvrir cette œuvre méconnue.
Signalons à rouxel que Gaumont vient de sortir en Blu-ray plusieurs films que j’ai soutenu ici même, parfois appuyé par Dumonteil : JUSTICE EST FAITE, UN SINGE EN HIVER, LE PRÉSIDENT avant qu’il écrive un long texte. J’ajouterai le WEEK END de Godard qui est plus rare et que je vais revoir.
PLUS RÉCENT
 SAINT-CYR de Patricia Mazuy (vous n’avez pas oublié, je l’espère, TRAVOLTA ET MOI) est une évocation assez décapante de Madame de Maintenon et de l’institution qu’elle voulut créer pour les filles et jeunes filles appartenant à la noblesse pauvre. Il s’agissait au départ de leur donner une éducation pour leur offrir une chance mais peu à peu l’entreprise se pervertit. Madame de Maintenon, devenue la maîtresse du roi, est tiraillée entre le désir d’affranchir les femmes de la tyrannie des hommes et un puritanisme qui la culpabilise. Elle sait qu’elle doit sa position aux faveurs sexuelles qu’elle a consenties et du coup se rigidifie et changeant du tout au tout veut pousser ses pensionnaires vers le couvent. Isabelle Huppert est géniale dans ce personnage double, sans cesse changeant, qui affirme tout et son contraire et finit par brûler les livres et les cahiers. Elle est à la fois belle, sexy et terrifiante dans ce FULL METAL JACKET en jupons comme le définit la réalisatrice qui déclare avoir voulu filmer cette histoire comme un film de guerre. Avec une folle audace, Patricia Mazuy fait parler ses enfants en dialecte de la Basse Normandie à qui le français paraît une langue étrangère. Jean-Pierre Kalfon est impeccable en Louis XIV vieillissant et Jean-François Balmer fignole un portrait de Racine qui me semble profondément juste. Dans les bonus, Patricia Mazuy donne une interview nature et savoureuse. Je ne conteste que ses propos infiniment superficiels non sur la musique (il fallait rester loin du XIXème) mais sur le baroque qu’elle rejette d’un bloc, demandant en fait à John Cale de le recréer, ce que j’avais fait dans DES ENFANTS GÂTÉS.
SAINT-CYR de Patricia Mazuy (vous n’avez pas oublié, je l’espère, TRAVOLTA ET MOI) est une évocation assez décapante de Madame de Maintenon et de l’institution qu’elle voulut créer pour les filles et jeunes filles appartenant à la noblesse pauvre. Il s’agissait au départ de leur donner une éducation pour leur offrir une chance mais peu à peu l’entreprise se pervertit. Madame de Maintenon, devenue la maîtresse du roi, est tiraillée entre le désir d’affranchir les femmes de la tyrannie des hommes et un puritanisme qui la culpabilise. Elle sait qu’elle doit sa position aux faveurs sexuelles qu’elle a consenties et du coup se rigidifie et changeant du tout au tout veut pousser ses pensionnaires vers le couvent. Isabelle Huppert est géniale dans ce personnage double, sans cesse changeant, qui affirme tout et son contraire et finit par brûler les livres et les cahiers. Elle est à la fois belle, sexy et terrifiante dans ce FULL METAL JACKET en jupons comme le définit la réalisatrice qui déclare avoir voulu filmer cette histoire comme un film de guerre. Avec une folle audace, Patricia Mazuy fait parler ses enfants en dialecte de la Basse Normandie à qui le français paraît une langue étrangère. Jean-Pierre Kalfon est impeccable en Louis XIV vieillissant et Jean-François Balmer fignole un portrait de Racine qui me semble profondément juste. Dans les bonus, Patricia Mazuy donne une interview nature et savoureuse. Je ne conteste que ses propos infiniment superficiels non sur la musique (il fallait rester loin du XIXème) mais sur le baroque qu’elle rejette d’un bloc, demandant en fait à John Cale de le recréer, ce que j’avais fait dans DES ENFANTS GÂTÉS.
Gaumont vient de ressortir en Blu-ray le bouleversant LE PETIT PRINCE A DIT de Christine Pascal. Ne le manquez pas.
Lire la suite »









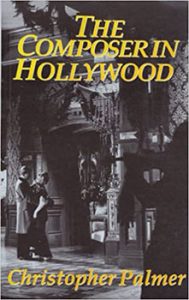 Avec l’arrivée du parlant, les studios vont s’intéresser à la musique de film de manière moins anarchique que durant le muet comme le montre très bien Christopher Palmer dans son excellent et indispensable The Composer in Hollywood. Ils vont engager des compositeurs ou plutôt des chefs d’orchestre, des arrangeurs qui ont surtout dirigé ou travaillé sur de la musique dite légère, opérettes européennes, musicals, conçue par d’autres, Les Strauss, Lehár, Friml, Romberg, Victor Herbert, voire Gershwin. Comme l’écrit Palmer « on choisissait Tin Pan Alley contre Carnegie Hall ». Par peur que de vrais musiciens soient trop intellectuels, trop audacieux. Contrairement au cinéma français qui très tôt a fait appel à de vrais compositeurs reconnus ou prometteurs, souvent choisis par les metteurs en scène, Camille Saint-Saëns, Arthur Honegger, Darius Milhaud, George Auric voire Maurice Jaubert.
Avec l’arrivée du parlant, les studios vont s’intéresser à la musique de film de manière moins anarchique que durant le muet comme le montre très bien Christopher Palmer dans son excellent et indispensable The Composer in Hollywood. Ils vont engager des compositeurs ou plutôt des chefs d’orchestre, des arrangeurs qui ont surtout dirigé ou travaillé sur de la musique dite légère, opérettes européennes, musicals, conçue par d’autres, Les Strauss, Lehár, Friml, Romberg, Victor Herbert, voire Gershwin. Comme l’écrit Palmer « on choisissait Tin Pan Alley contre Carnegie Hall ». Par peur que de vrais musiciens soient trop intellectuels, trop audacieux. Contrairement au cinéma français qui très tôt a fait appel à de vrais compositeurs reconnus ou prometteurs, souvent choisis par les metteurs en scène, Camille Saint-Saëns, Arthur Honegger, Darius Milhaud, George Auric voire Maurice Jaubert.