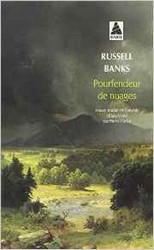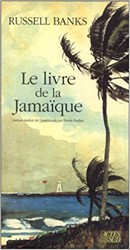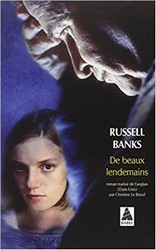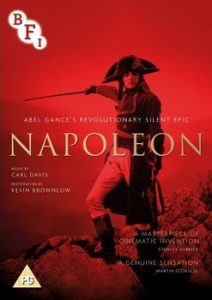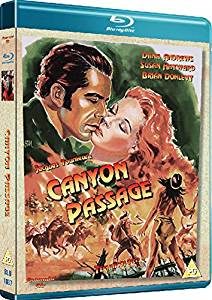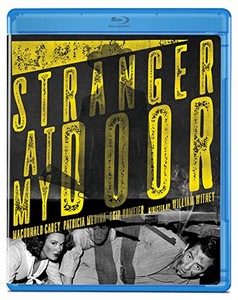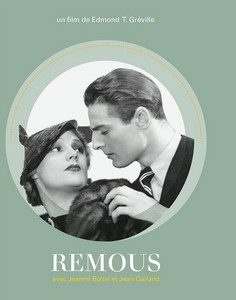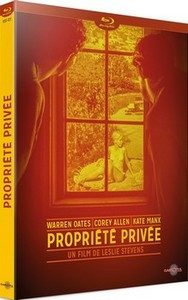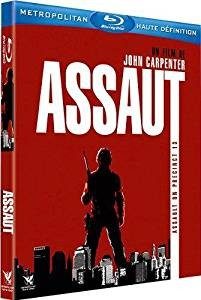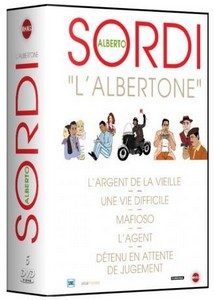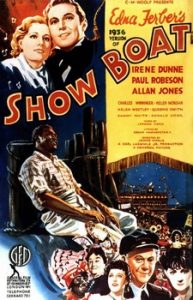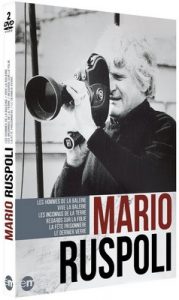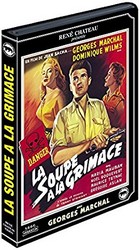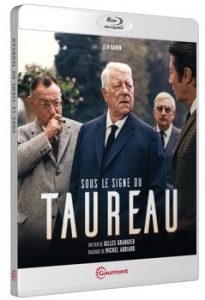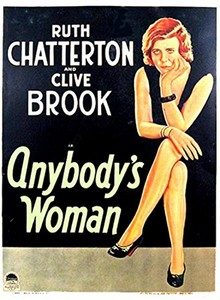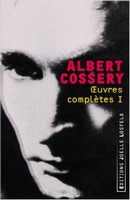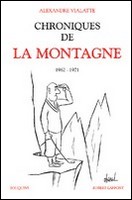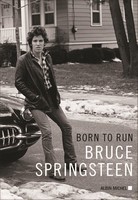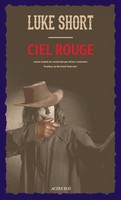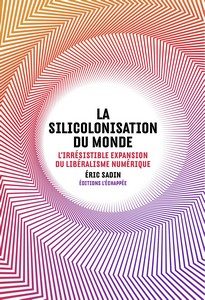DOROTHY ARZNER
Pour beaucoup l’hommage à Lumière consacré à Dorothy Arzner fut une révélation. Pour moi aussi, qui n’avais vu que DANCE GIRL, DANCE sur le monde du « burlesque » qui m’avait paru timide et conventionnel. Une tirade revendicatrice de Maureen O’Hara avait permis au mouvement féministe de s’emparer du film et de le surestimer. On est à des lieues de GRAIG’S WIFE, MERRILY WE GO TO HELL, ANYBODY’S WOMAN ou WORKING GIRLS.
Malheureusement, c’est l’un de ses seuls titres qui est disponible en DVD avec le banal et languissant CHRISTOPHER STRONG, pourtant écrit par sa scénariste de prédilection, Zoe Akins, que rachète partiellement l’interprétation lumineuse, élégante et totalement maitrisée de Katharine Hepburn dont ce n’est que le second film et celle touchante de Helen Chandler.
 MERRILY WE GO TO HELL que l’on trouve soit dans un coffret consacré aux films Universal pre-Code soit séparément, compte en revanche parmi les meilleures réussites de Dorothy Arzner qui, comme l’écrit Antoine Royer, dans DVDClassik « aura été l’une des plus remarquables marginalités issues du giron des studios hollywoodiens durant les années 20 : en premier lieu, c’était une femme, et probablement la première réalisatrice à avoir obtenu une place de cette envergure à Hollywood. Plus encore, c’était une lesbienne, qui portait des pantalons et assumait ses amours, notamment avec la danseuse et chorégraphe Marion Morgan, dont elle partagea la vie pendant des décennies où cela ne se faisait pas encore. Et la plupart des films de Dorothy Arzner, sans pour autant être des pamphlets revendicatifs, portent ainsi en eux quelque chose de cette identité singulière, tant dans les thèmes abordés (notamment autour de la condition féminine, avec des personnages qui décident de prendre en main la direction de leur existence plutôt que de subir la pression de l’ordre social) que dans la manière de les appréhender. »
MERRILY WE GO TO HELL que l’on trouve soit dans un coffret consacré aux films Universal pre-Code soit séparément, compte en revanche parmi les meilleures réussites de Dorothy Arzner qui, comme l’écrit Antoine Royer, dans DVDClassik « aura été l’une des plus remarquables marginalités issues du giron des studios hollywoodiens durant les années 20 : en premier lieu, c’était une femme, et probablement la première réalisatrice à avoir obtenu une place de cette envergure à Hollywood. Plus encore, c’était une lesbienne, qui portait des pantalons et assumait ses amours, notamment avec la danseuse et chorégraphe Marion Morgan, dont elle partagea la vie pendant des décennies où cela ne se faisait pas encore. Et la plupart des films de Dorothy Arzner, sans pour autant être des pamphlets revendicatifs, portent ainsi en eux quelque chose de cette identité singulière, tant dans les thèmes abordés (notamment autour de la condition féminine, avec des personnages qui décident de prendre en main la direction de leur existence plutôt que de subir la pression de l’ordre social) que dans la manière de les appréhender. »
Je discuterai simplement et très légèrement « l’identité singulière » car aucun des films d’Arzner ne trahit vraiment ses préférences sexuelles (elle-même les vivait discrètement comme le rappelait Philippe Garnier) contrairement à ce que ressassent les universitaires américains. Même s’il lui arrive de dénoncer des conduites phallocratiques dans les couples, comme dans un certain nombre de mélodrames (BACK STREET de Stahl). De même que Cukor faisait attention à dissimuler son homosexualité dans ses films. On peut en effet noter l’attention que porte Arzner à ses personnages féminins – ici Sylvia Sidney qui a rarement été plus belle, plus délicate et ailleurs la sidérante Ruth Chatterton sans oublier Rosalind Russell extraordinaire dans CRAIG’S WIFE : attention aux visages, aux costumes, aux cadrages. Mais dans MERRILY WE GO TO HELL (c’est le toast qui ponctue chaque libation de Jeremy Corbett), Fredric March est exceptionnel, tout comme John Boles dans CRAIG’S WIFE, voire Clive Brooks et surtout Paul Lukas dans ANYBODY’S WOMAN, ce qui contredisait un peu l’assertion de Garnier selon laquelle, elle sacrifiait parfois les personnages masculins.
Il y a un thème qui court à travers tous ses films : les couples mal assortis ou dysfonctionnels pour des différences de classe, de milieu, de caractère. Parfois les protagonistes surmontent ces différences, après bien des souffrances comme dans ce film, parfois non comme dans CRAIG’S WIFE. Toujours Antoine Royer : « MERRILY WE GO TO HELL (1932) est un film admirable, à de nombreux points de vue. Stimulant, troublant, émouvant, léger tout en étant empreint de gravité et de subversion, le film témoigne d’une excellence de production assez généralisée qu’il convient de souligner ici. Avec le recul conféré par quelques décennies de mélodrames plus ou moins honnêtes autour de l’alcoolisme – et parmi eux, de bien rares chefs-d’œuvre – on pourrait trouver le déroulé du film un peu attendu, somme toute prévisible. Quatre contre-arguments, au moins, invitent à modérer le constat critique. Premièrement : avant 1932, la figure de l’alcoolique n’avait que rarement été traitée en tant que telle au cinéma, si ce n’est pour donner l’occasion de scènes d’ivresse comique et/ou bagarreuse, et des ressorts dramaturgiques qui peuvent aujourd’hui paraître obligés ne l’étaient pas forcément, loin de là, à l’époque. Deuxièmement – et pour revenir à cet admirable titre – : certes, le couple central va être mis à mal par la dépendance à l’alcool de Jerry, et ce qui est attendu survient… mais peut-on finalement reprocher à un film de se tenir au programme annoncé sur son affiche ? Troisièmement, le scénario d’un film ne se limite pas, loin de là, au déroulé de son intrigue, et le film contient suffisamment de singularités périphériques, dans son approche de son sujet ou dans le traitement de ses personnages secondaires, pour attiser la curiosité. Et enfin, quatrièmement : il ne faudrait pas confondre le moyen et la fin, et MERRILY WE GO TO HELL n’est en réalité pas tant un film sur l’alcoolisme qu’une œuvre sur les obsessions individuelles et les pulsions destructrices qu’il engendre souvent. »
Le ton oscille entre la cocasserie et la gravité, la légèreté et le drame et l’action avance comme suspendue dans un nuage d’alcool, ce qui dramatise les chutes et les faux pas. Corbett va se remettre à boire sous l’influence de son ancienne petite amie qui l’avait pourtant maltraité :« Pourquoi me considères tu avec cette dévotion ? », lui demande-t-elle quand ils se retrouvent, « celle qu’on accorderait à un boa constrictor ». « C’est vrai, j’étais jeune et égocentrique » – « Et maintenant ? » – « Maintenant, je suis jeune et égocentrique ». Et il va entraîner provisoirement sa femme dans sa chute. Il y a des parenthèses surprenantes : la recherche d’un baryton occupe pendant quelques scènes les déambulations d’un trio de fêtards dont March (« il n’est ni baryton ni gentleman », dit il après avoir testé un barman vocaliste et après qu’un autre barman ait répondu « je n’autorise pas les barytons ici ») et tout à coup une réplique poignante, quand Sylvia Sidney qui vient elle aussi de boire, déclare : « Je vous donne l’état sacré du mariage moderne : on vit seul, dans des lits jumeaux avec trois Alka Seltzer le matin. » Remarquable dialogue, brillant, moderne et rapide d’Edwin Justus Mayer (March découvrant que Sidney est la fille de Prentice, le roi de la conserve : « Ah, celui qui met des objets dans une boîte que moi j’ouvre pour les en retirer »). Arzner parvient à contourner tous les clichés, nous faisant sentir la muflerie de March mais aussi sa fragilité, la souffrance. Elle maitrise tous les changements de ton avec une grâce infinie.
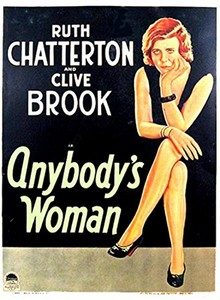 ANYBODY’S WOMAN (1930) est dans la même veine et débute par un moment anthologique. Clive Brook surprend par la fenêtre dans une chambre voisine, deux chorus girls dont l’une joue de l’ukulele. C’est Ruth Chatterton qui est absolument inoubliable. Ils vont se marier. Toujours un de ces couples mal assortis qui peuplent les films d’Arzner avec tous les incidents que cela entraine : les gaffes de la jeune femme, ses manières plébéiennes, l’arrogance des amis du marié, imbus des privilèges de leur caste. Mais avec l’aide de la scénariste Zoe Akins (qui adapte une histoire de Gouverneur Morris, l’auteur pulp de EAST OF JAVA), Arzner triomphe de tous les pièges et réussit à constamment nous surprendre. Tous les personnages à commencer par celui que joue si délicatement Paul Lukas, révèlent des facettes inattendues, une couleur qu’on n’avait pas repéré, une surprenante véracité (notamment celui que joue Lukas qui prend tout le monde à contre pied) et le scénario évite tous les stéréotypes. La Pansy de Ruth Chatterton est une fille naturelle, décente, loyale qui reconnaît ses erreurs et refuse qu’elles la plombent. Elle peut aussi être rude quand il le faut, n’hésitant pas à gifler un soupirant trop insistant, ce qui se retourne contre elle. Le scénario est ponctué par des intertitres : un Mois Après, le Lendemain, comme un film muet mais ce qui paraît ailleurs une béquille, devient ici une manière dynamique de raconter l’histoire, faisant saliver le spectateur. D’autant qu’Arzner utilise admirablement l’espace (les personnages coincés dans des chambres proches ou de très grandes pièces) et le son : un ventilateur permet de réverbérer des conversations et de les faire entendre à une autre personne, astuce digne du Dumas des TROIS MOUSQUETAIRES avec la fameuse cheminée.
ANYBODY’S WOMAN (1930) est dans la même veine et débute par un moment anthologique. Clive Brook surprend par la fenêtre dans une chambre voisine, deux chorus girls dont l’une joue de l’ukulele. C’est Ruth Chatterton qui est absolument inoubliable. Ils vont se marier. Toujours un de ces couples mal assortis qui peuplent les films d’Arzner avec tous les incidents que cela entraine : les gaffes de la jeune femme, ses manières plébéiennes, l’arrogance des amis du marié, imbus des privilèges de leur caste. Mais avec l’aide de la scénariste Zoe Akins (qui adapte une histoire de Gouverneur Morris, l’auteur pulp de EAST OF JAVA), Arzner triomphe de tous les pièges et réussit à constamment nous surprendre. Tous les personnages à commencer par celui que joue si délicatement Paul Lukas, révèlent des facettes inattendues, une couleur qu’on n’avait pas repéré, une surprenante véracité (notamment celui que joue Lukas qui prend tout le monde à contre pied) et le scénario évite tous les stéréotypes. La Pansy de Ruth Chatterton est une fille naturelle, décente, loyale qui reconnaît ses erreurs et refuse qu’elles la plombent. Elle peut aussi être rude quand il le faut, n’hésitant pas à gifler un soupirant trop insistant, ce qui se retourne contre elle. Le scénario est ponctué par des intertitres : un Mois Après, le Lendemain, comme un film muet mais ce qui paraît ailleurs une béquille, devient ici une manière dynamique de raconter l’histoire, faisant saliver le spectateur. D’autant qu’Arzner utilise admirablement l’espace (les personnages coincés dans des chambres proches ou de très grandes pièces) et le son : un ventilateur permet de réverbérer des conversations et de les faire entendre à une autre personne, astuce digne du Dumas des TROIS MOUSQUETAIRES avec la fameuse cheminée.
WORKING GIRLS (1931) ne se situe pas au même niveau en partie à cause du matériau de base, une pièce de Vera Caspary se déroulant à l’origine dans une chambre d’hôtel de femmes, avec une distribution entièrement féminine. Zoe Akins rajouta donc les personnages d’hommes et tous les extérieurs. Et surtout, avec la réalisatrice, elle noie l’intrigue sous une foule détails, de personnages, de notations si bien que la trame a moins d’importance que l’atmosphère. Parmi les « working girls » (c’est à dire plus ou moins des prostituées dans l’argot de l’époque, l’équivalent des « travailleuses » chères au Milieu français) du titre, figurent deux sœurs et là Arzner va montrer peu à peu que celle qui paraît flirter le plus est en fait la plus posée, la plus pragmatique. Et Dorothy Hall est d’ailleurs assez convaincante alors que le jeu de Judith Wood se révèle assez exaspérant et forcé. Autre faiblesse, Charles Buddy Rogers distribué ici à contre emploi (il est frivole, égoïste, oublieux de toutes ses promesses), ce qui ne dynamise pas son talent. Heureusement la mise en scène d’Azner, son attention à de petits détails surmontent les faiblesses du sujet et de l’interprétation.. Elle dynamise par ses plans, ses cadrages des moments où pourtant rien ne paraît se passer qu’elle soigne particulièrement, souligne la caractère prolétarien de certains personnages, réussit plusieurs séquences de montage et dirige remarquable Paul Lukas, personnage complexe et touchant. Les premières séquences se déroulant dans l’hôtel ont suscité des exégèses soulignant leur côté lesbien qui nous semble pourtant indéchiffrable. Certes, on voit une fille cligner de l’œil vers une copine mais cela paraît davantage un gag qu’une tentative de séduction. Et quant aux filles qui dansent ensemble, on en voit beaucoup dans les films de la Dépression, voire plus tard, quand leurs copains ou maris étaient de mauvais danseurs, sans que cela trahisse la moindre influence homosexuelle. Ce film passionnant fut malheureusement un échec commercial.
CRAIG’S WIFE (1936)
 Pour Edward Chodorov qui produisit le film et déclare avoir travaillé au scénario, c’est la dernière réussite de Dorothy Arzner et sans doute son chef d’œuvre. L’Histoire semble lui donner raison. Inspiré d’une pièce de George Kelly, l’oncle de Grace, qui reçut le prix Pulitzer, le scénario est crédité à Mary McCall qui accomplit (sous la supervision ou avec l’aide de Chodorov ?) un travail remarquable, supprimant les digressions de la pièce, ses longueurs, réduisant les trois actes à 71 minutes. Bien sur, on peut penser que vu le laps de temps (identique dans la pièce) l’évolution du mari et sa soudaine lucidité sont un peu précipitées mais John Boles et la mise en scène parviennent à faire accepter la convention. Le couple dysfonctionnel qu’il forme avec Rosalind Russel (le choix de l’actrice est revendiqué par Chodorov mais sa direction, rigoureuse, tendue, semble être le fait de la réalisatrice), femme parfaite, ménagère perfectionniste qui aime davantage sa maison que son mari ou le monde extérieur, est l’un des plus forts, des plus originaux de toute l’œuvre d’Arzner qui en compte pourtant pas mal. Elle est froide, calculatrice, obsédée plus par les apparences, par ce que vont dire les gens que par les ennuis judiciaires qui peuvent tomber sur son mari. Sa recherche de l’indépendance à tout prix, sa volonté d’autonomie la conduisent à nier le monde extérieur, à ne privilégier que sa maison : elle se montre d’une incroyable dureté envers une de ses plus fidèles domestiques (Jane Darwell), coupable d’avoir invité quelqu’un à la cuisine ; elle méprise sa voisine qui lui amène sans cesse des roses (délicieuse Billie Burke), ment de manière éhontée à sa jeune nièce à qui elle déclare que le « mariage est le seul moyen d’acquérir sa liberté ». Et peu à peu va se retrouver seule, abandonnée par tous. Rosalind Russel sait combiner la froideur et la fausse gentillesse qu’elle exhibe pour la galerie et qui sont les deux faces de la même pièce. Elle arrache son interprétation sans jamais avoir l’air de juger son personnage, de le commenter et l’on sent qu’elle est non pas un monstre mais le produit parfait d’une société. Arzner transforme sa maison avec l’aide d’un de ses amis, le décorateur d’intérieur William Haines qui remplaça Stephen Goosson qu’elle avait renvoyé, en une sorte de mausolée, un tombeau pour sa propre gloire qui finit par devenir suffoquant. Elle joue sur les verticales pour augmenter ce sentiment d’oppression et le moment où Boles fracasse le vase qu’elle essuie et repositionne constamment, résonne comme un sacrilège libérateur. Il l’avoue avec une certaine jubilation, conquérant ainsi sa liberté.
Pour Edward Chodorov qui produisit le film et déclare avoir travaillé au scénario, c’est la dernière réussite de Dorothy Arzner et sans doute son chef d’œuvre. L’Histoire semble lui donner raison. Inspiré d’une pièce de George Kelly, l’oncle de Grace, qui reçut le prix Pulitzer, le scénario est crédité à Mary McCall qui accomplit (sous la supervision ou avec l’aide de Chodorov ?) un travail remarquable, supprimant les digressions de la pièce, ses longueurs, réduisant les trois actes à 71 minutes. Bien sur, on peut penser que vu le laps de temps (identique dans la pièce) l’évolution du mari et sa soudaine lucidité sont un peu précipitées mais John Boles et la mise en scène parviennent à faire accepter la convention. Le couple dysfonctionnel qu’il forme avec Rosalind Russel (le choix de l’actrice est revendiqué par Chodorov mais sa direction, rigoureuse, tendue, semble être le fait de la réalisatrice), femme parfaite, ménagère perfectionniste qui aime davantage sa maison que son mari ou le monde extérieur, est l’un des plus forts, des plus originaux de toute l’œuvre d’Arzner qui en compte pourtant pas mal. Elle est froide, calculatrice, obsédée plus par les apparences, par ce que vont dire les gens que par les ennuis judiciaires qui peuvent tomber sur son mari. Sa recherche de l’indépendance à tout prix, sa volonté d’autonomie la conduisent à nier le monde extérieur, à ne privilégier que sa maison : elle se montre d’une incroyable dureté envers une de ses plus fidèles domestiques (Jane Darwell), coupable d’avoir invité quelqu’un à la cuisine ; elle méprise sa voisine qui lui amène sans cesse des roses (délicieuse Billie Burke), ment de manière éhontée à sa jeune nièce à qui elle déclare que le « mariage est le seul moyen d’acquérir sa liberté ». Et peu à peu va se retrouver seule, abandonnée par tous. Rosalind Russel sait combiner la froideur et la fausse gentillesse qu’elle exhibe pour la galerie et qui sont les deux faces de la même pièce. Elle arrache son interprétation sans jamais avoir l’air de juger son personnage, de le commenter et l’on sent qu’elle est non pas un monstre mais le produit parfait d’une société. Arzner transforme sa maison avec l’aide d’un de ses amis, le décorateur d’intérieur William Haines qui remplaça Stephen Goosson qu’elle avait renvoyé, en une sorte de mausolée, un tombeau pour sa propre gloire qui finit par devenir suffoquant. Elle joue sur les verticales pour augmenter ce sentiment d’oppression et le moment où Boles fracasse le vase qu’elle essuie et repositionne constamment, résonne comme un sacrilège libérateur. Il l’avoue avec une certaine jubilation, conquérant ainsi sa liberté.
 HARRIET CRAIG, le remake qu’en fit Vincent Sherman, est vraiment intéressant pendant plus de la première moitié, surtout par rapport à ce que l’on a appris de Crawford par la suite, ses obsessions, sa maniaquerie, son coté tyrannique avec ses proches. Le film incorpore certains de ses traits et ce, alors que Crawford avait une histoire d’amour avec Vincent Sherman qui dura 3 ans. Est-ce que ceci explique cela, est-ce que Sherman qui disait que les Noël chez Crawford était une torture ne les a pas ajoutés dans le script ? Le fait que Crawford les ait acceptés, connaissant le voile qui dissimulait sa conduite avec ses enfants et ses proches, laisse rêveur. Masochisme, sentiment d’invulnérabilité ? Cela renforce l’intérêt du film, filmé avec une vrai fluidité et un sens certain de la direction d’acteur. Le dernier tiers trahit son origine théâtrale et les coups de théâtre sont assénés sans subtilité malgré l’interprétation très convaincante de Wendell Corey. Le film est plus long que le Arzner, plus psychologie et Crawford paraît plus ambitieuse dans ce qu’elle recherche et plus perverse avec son mari.
HARRIET CRAIG, le remake qu’en fit Vincent Sherman, est vraiment intéressant pendant plus de la première moitié, surtout par rapport à ce que l’on a appris de Crawford par la suite, ses obsessions, sa maniaquerie, son coté tyrannique avec ses proches. Le film incorpore certains de ses traits et ce, alors que Crawford avait une histoire d’amour avec Vincent Sherman qui dura 3 ans. Est-ce que ceci explique cela, est-ce que Sherman qui disait que les Noël chez Crawford était une torture ne les a pas ajoutés dans le script ? Le fait que Crawford les ait acceptés, connaissant le voile qui dissimulait sa conduite avec ses enfants et ses proches, laisse rêveur. Masochisme, sentiment d’invulnérabilité ? Cela renforce l’intérêt du film, filmé avec une vrai fluidité et un sens certain de la direction d’acteur. Le dernier tiers trahit son origine théâtrale et les coups de théâtre sont assénés sans subtilité malgré l’interprétation très convaincante de Wendell Corey. Le film est plus long que le Arzner, plus psychologie et Crawford paraît plus ambitieuse dans ce qu’elle recherche et plus perverse avec son mari.
Autres films vus à Lumière
BUTCH CASSIDY ET LE KID tient très bien le coup même si un des passages ultra-célèbres grâce à la chanson de Bacharach prend des airs de vidéo clip. J’ai été très sensible au scénario et surtout au remarquable dialogue de William Goldman (avec cette brusque irruption d’un type qui veut placer la bicyclette au milieu du recrutement d’une milice) auquel George Roy Hill contribua et aussi à la manière dont ce dernier passe dans sa réalisation de la comédie, de la désinvolture à la gravité. Il y a deux monologues extrêmement touchants de Katharine Ross, notamment le dernier quand ils vont se séparer qui s’enchaine sur une ellipse très émouvante. Roy Hill a très souvent raconté l’histoire de types instables, pas très mûrs, inadaptés psychologiquement (pensez à THE WORLD OF HENRY ORIENT). Tarantino disait à Lyon que dans tous ses films, il y a un affabulateur et un idéaliste. Ce qui n’est pas faux.



Dans le programme préparé par Quentin TARENTINO, j’ai pu enfin voir LA DAME DANS L’AUTO AVEC DES LUNETTES ET UN FUSIL de Litvak qui est plaisant et bien mené (Samantha Eggar est fort bonne de même que Fresson) et comme le dit Tarantino « hip et cool ». Mais comme beaucoup d’adaptations de Japrisot, le récit et le suspense sont tellement alambiqués qu’ils réclament 25 minutes d’explications.
THE LIBERATION OF L.B. JONES (ON N’ACHÈTE PAS LE SILENCE) tient très bien le coup et nous étions injustes dans 50 ANS avec ce film. Nous allions jusqu’à mettre en doute, erreur inexcusable et ne s’appuyant sur rien, les convictions personnelles de Wyler. Or on apprend dans FIVE CAME BACK de Mark Harris que Wyler avait demandé à Capra de réaliser le film sur les soldats noirs. Capra l’envoya dans le Sud avec un scénariste noir Carleton Moss et là, Wyler fut horrifié par tout ce qu’il découvrit : un racisme omniprésent, violent, y compris à l’intérieur de l’armée qui l’empêchait de travailler avec son co-auteur : ils ne pouvaient pas être ensemble dans les restaurants, les hôtels, les trains. Ecœuré, Wyler abandonna le projet en déclarant qu’il haïssait le Sud. Et cette violence, on la sent tout au long de THE LIBERATION OF L.B. JONES. Ce que nous qualifions de cynique est en fait une lucidité qui refuse les compromis et l’ordre établi. Et le jeune avocat qui quitte le pays est la réincarnation de Wyler, touche profondément personnelle. Le projet, évidemment, a bénéficié du succès de IN THE HEAT OF THE NIGHT, mais il n’en a pas la roublardise (inconsciente ?). Nulle réconciliation, nulle main tendue entre les Noirs et les Blancs à la fin, qui mettait tellement en colère James Baldwin. Seul bémol, Wyler se livre à tout un montage de plans cut, ultra rapides, sur le visage d’une jeune noire, concession inutile à l’air du temps qui jure par son pseudo modernisme. Belle musique d’Elmer Bernstein.
LECTURES
 SAINT FRANÇOIS D’ASSISE (Éditions Le Bruit du Temps du Temps) est une magnifique et revigorante biographie écrite par l’immense GK Chesterton (dans tous les sens du termes, il mesurait 1 mètre 96 et était un colosse). Bien qu’il se soit converti au catholicisme, Chesterton n’est pas un auteur paralysé par les dévotions. Comme l’écrit Anne Weber dans sa belle préface et qui parle de l’éblouissement que l’on ressent à la lecture : « nul besoin pour cela d’être soi-même catholique orthodoxe comme Chesterton, ni même catholique tout court, ni même croyant. Du moment qu’on est un être humain, comment ne pas être ébloui face au merveilleux personnage que l’on découvre et qui ressemble si peu à l’idée qu’on se fait communément d’un saint, ni d’ailleurs à rien de ce qu’on a jamais connu. On suppose qu’on va avoir affaire à quelque ascète sinistre et l’on se retrouve face au plus joyeux des hommes. » Chesterton trace le portrait d’un François qui a d’abord voulu s’illustrer à la guerre avant que la maladie le terrasse, un homme profondément démocratique, voire révolutionnaire et l’on y apprend une foule de détails savoureux, cocasses ou bouleversants. « Toute l’explication de Saint François, écrit-il, c’est qu’il était certes ascétique et qu’il n’était certes pas sombre… Il se jeta dans le jeûne et les vigiles aussi furieusement qu’il s’était jeté dans la bataille. Il avait fait faire à son coursier volte-face complète mais il n’y avait ni arrêt ni ralentissement dans la foudroyante impétuosité de sa charge. Elle ne présentait rien de négatif ; ce n’était ni un régime ni une simplification stoïque de la vie. » On admirera au passage l’écriture de Chesterton que vénérait Borges. J’ai été fasciné par les rapports entre le monde des troubadours, voire des jongleurs et François.
SAINT FRANÇOIS D’ASSISE (Éditions Le Bruit du Temps du Temps) est une magnifique et revigorante biographie écrite par l’immense GK Chesterton (dans tous les sens du termes, il mesurait 1 mètre 96 et était un colosse). Bien qu’il se soit converti au catholicisme, Chesterton n’est pas un auteur paralysé par les dévotions. Comme l’écrit Anne Weber dans sa belle préface et qui parle de l’éblouissement que l’on ressent à la lecture : « nul besoin pour cela d’être soi-même catholique orthodoxe comme Chesterton, ni même catholique tout court, ni même croyant. Du moment qu’on est un être humain, comment ne pas être ébloui face au merveilleux personnage que l’on découvre et qui ressemble si peu à l’idée qu’on se fait communément d’un saint, ni d’ailleurs à rien de ce qu’on a jamais connu. On suppose qu’on va avoir affaire à quelque ascète sinistre et l’on se retrouve face au plus joyeux des hommes. » Chesterton trace le portrait d’un François qui a d’abord voulu s’illustrer à la guerre avant que la maladie le terrasse, un homme profondément démocratique, voire révolutionnaire et l’on y apprend une foule de détails savoureux, cocasses ou bouleversants. « Toute l’explication de Saint François, écrit-il, c’est qu’il était certes ascétique et qu’il n’était certes pas sombre… Il se jeta dans le jeûne et les vigiles aussi furieusement qu’il s’était jeté dans la bataille. Il avait fait faire à son coursier volte-face complète mais il n’y avait ni arrêt ni ralentissement dans la foudroyante impétuosité de sa charge. Elle ne présentait rien de négatif ; ce n’était ni un régime ni une simplification stoïque de la vie. » On admirera au passage l’écriture de Chesterton que vénérait Borges. J’ai été fasciné par les rapports entre le monde des troubadours, voire des jongleurs et François.
De Chesterton, il faut absolument lire UN NOMMÉ JEUDI, cette fable sarcastique, LES ENQUÊTES DU PÈRE BROWN et si vous le trouvez d’occasion, son prodigieux essai sur Dickens dont certaines pages constituent le plus beau texte jamais écrit sur John Ford. Je vais aussi commander chez le même éditeur sa vie de Robert Browning.
Je me suis replongé avec délices dans certains livres d’Albert Cossery, ce romancier égyptien qui écrivait en français et en anglais : LES HOMMES OUBLIÉS DE DIEU fut préfacé par Henry Miller. Il faut absolument découvrir LES FAINÉANTS DE LA VALLÉE FERTILE, LA VIOLENCE ET LA DÉRAISON, MENDIANTS ET ORGUEILLEUX.
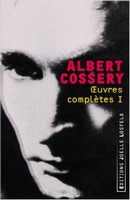

Petite promo familiale, ma fille Tiffany vient d’écrire une belle biographie sur Isabelle Eberhardt, UN DESTIN DANS L’ISLAM (Tallandier). C’est passionnant, touchant et très actuel. Quel destin.
Bouquins a eu la fort bonne idée de réunir en deux volumes les chroniques d’Alexandre Vialatte parues dans La Montagne au temps béni où les journaux s’offraient de vrais et grands écrivains. C’est un éblouissant festival, sublimement écrit, jubilatoire. Du bonheur à chaque ligne. En l’ouvrant au hasard, je suis tombé sur ce que Vialatte écrivait sur BONJOUR TRISTESSE. C’est splendide. Il trace un portrait si élégant, si profond de Sagan, si drôle où il a déjà tout senti, tout compris. Voilà un bon remède face aux tonnes de langue de bois qui se déversent.
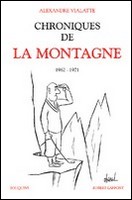
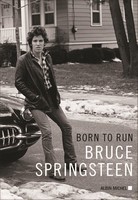
L’autobiographie de Bruce Springsteen BORN TO RUN (Albin Michel) est un livre émouvant, un vrai portrait de l’Amérique populaire, ouvrière, pauvre (il y a des pages formidables sur la manière dont il vivait). Il parle avec honnêteté de ses crises de dépression, des doutes qui le ravagent : un an et demi pour mixer THE RIVER. Les rapports ambigus, douloureux avec son père, son évocation chaleureuse de sa mère, ses luttes pour conquérir sa liberté, la description de la disparition du saxophoniste Clarence constituent des pages bouleversantes comme tout ce qu’il écrit sur Elvis, Dylan, Pete Seeger. Du coup je me suis replongé dans certains de ses albums, NEBRASKA qui fut méconnu, BORN IN THE USA qui lui valut des félicitations de Reagan, THE SEEGER SESSION, THE GHOST OF TOM JOAD inspiré par LES RAISINS DE LA COLÈRE et Woody Guthrie.
Dans ma collection western, chez Actes Sud, je signale la parution de CIEL ROUGE, un roman de Luke Short, auteur totalement ignoré en France, où il introduit avec brio les principes du roman noir dans le western. Robert Wise en tira un fort bon film, nocturne, à peine gâché par de mauvaises transparences et que rachetaient Mitchum, déjà génial, et une scène de bagarre incroyablement violente. Sans oublier la sublime photo noir et blanc de Nicholas Musuracca. Luke Short participa au scénario, ce qui explique la fidélité du film au roman. Une partie des qualités que MB trouve fort justement dans TON HEURE A SONNÉ, viennent du livre de Short, CORONER CREEK, même si le scénario de Kenneth Gamet le simplifie quelque peu. Toutes les scènes de violence sadique proviennent du roman.
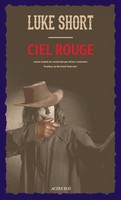

L’ÉTRANGE INCIDENT (the Ox Bow Incident) de Van Tilburg Clark est un admirable roman, profond, âpre, fort. A lire d’urgence. Voilà un immense écrivain qui influença des dizaines d’auteurs. Il s’agit sans doute du premier livre de fiction sur le lynchage.

THE COLOR LINE est une riche exposition au Musée du Quai Branly et aussi un très beau triple CD sorti par Frémaux & associés : chansons de travail, de protestation, blues urbains ou campagnards, Come Sunday d’Ellington.
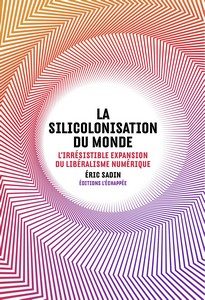
Lisez aussi LA SILICOLONISATION DU MONDE, un essai qui fait parfois froid dans le dos. Eric Sadin est l’un des rares intellectuels à penser la numérisation de notre monde. Voilà 10 ans maintenant qu’il interroge d’un point de vue philosophique l’impact du numérique sur nos sociétés. Cette fois-ci il parle de « silicolonisation » du monde, contraction de deux mots : la Silicon Valley, lieu mythique du développement du numérique aux Etats Unis, et colonisation tant la réussite industrielle de ces produits colonise le monde selon lui. Cet essai est une charge contre les Facebook, Apple et autres Amazon qui contrôlent subrepticement nos vies pour en tirer des services via les applications et générer des profits à une échelle jamais atteinte auparavant.
Lire la suite »